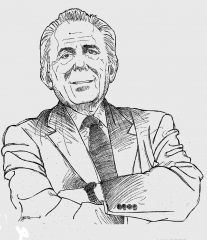 Dans son article sur mon ouvrage, Le Procès de l’Europe (PUF, 2011)*, Pierre de Meuse** soulève une question difficile sur le statut de l’universel, cet objet de pensée inventé et diffusé par les Européens et qui est aujourd’hui le partage de tous les peuples. Qu’il s’agisse de l’universel théorique, disons la vérité, recherchée dans toutes les universités et les laboratoires du monde sous forme de théories scientifiques, ou de l’universel pratique, disons la justice, imposé par toutes les institutions juridiques sous la forme éthique des « droits de l’homme », et la forme politique de la « démocratie », cette double forme de l’universel, c’est-à-dire la rationalité, régit le monde actuel sans que l’on puisse imaginer un autre modèle de connaissance et d’action.
Dans son article sur mon ouvrage, Le Procès de l’Europe (PUF, 2011)*, Pierre de Meuse** soulève une question difficile sur le statut de l’universel, cet objet de pensée inventé et diffusé par les Européens et qui est aujourd’hui le partage de tous les peuples. Qu’il s’agisse de l’universel théorique, disons la vérité, recherchée dans toutes les universités et les laboratoires du monde sous forme de théories scientifiques, ou de l’universel pratique, disons la justice, imposé par toutes les institutions juridiques sous la forme éthique des « droits de l’homme », et la forme politique de la « démocratie », cette double forme de l’universel, c’est-à-dire la rationalité, régit le monde actuel sans que l’on puisse imaginer un autre modèle de connaissance et d’action.
Pierre de Meuse en convient, mais m’oppose une objection redoutable : « Si, comme le dit Mattéi, “la raison européenne s’est toujours identifiée à son ouverture vers l’Universel” (p. 182), si la culture européenne n’est pas une culture mais une métaculture, alors elles ne nous appartiennent pas ». Les critiques de l’idée européenne, de Jacques Derrida qui veut déconstruire l’« européocentrisme » à Ulrich Beck qui voit dans l’Europe une « vacuité substantielle » (comment d’ailleurs le « vide » pourrait-il avoir une « substance » ?), auraient donc raison de condamner l’impérialisme européen. Son mode de pensée et d’action, s’il est véritablement universel, ne lui appartient pas puisqu’il est commun à toutes les civilisations. L’universel est un partage et non une possession et aucun peuple, ni aucune culture, ne saurait prétendre le posséder.
Présenté sous cette forme logique, qui s’appuie d’ailleurs sur un raisonnement rationnel de type européen depuis les Grecs, cette objection est justifiée. Personne, serait-ce Galilée, Descartes, Newton ou Einstein, n’a l’exclusivité de l’universel, et le théorème de Pythagore est commun aux Grecs, aux Égyptiens et aux Mayas. Parallèlement, la dignité de l’homme affirmée par la tradition philosophique européenne, qu’elle soit religieuse ou laïque, ne concerne pas les seuls Européens, blancs et chrétiens, héritiers des Grecs et des Romains, mais tous les peuples et toutes les races de la terre. L’humanité est le partage égal de tous les hommes.
Le nœud du problème, que ne semblent pas voir les adversaires d’une identité ou d’une spécificité de l’Europe, tient à ce que l’Europe, un continent particulier, a inventé au cours des siècles l’idée de civilisation. Or, la civilisation, définie par l’établissement des sciences, de la philosophie, de la culture, de la politique et de la morale, donc d’un monde de civilité opposé à la sauvagerie et à la barbarie, est l’avènement de l’universel. Comment concilier la particularité de l’Europe, soulignée par Herder et l’universalité de son message, démontrée par Hegel ? Le paradoxe n’est qu’apparent et se trouve résolu par l’histoire elle-même. L’Europe, ce « petit cap du continent asiatique » selon la formule de Valéry, a mis en œuvre de façon systématique l’universel présent dans toute l’humanité et l’a enseigné, parfois imposé, aux autres peuples, tout aussi particuliers que les peuples européens. La civilisation européenne est donc à la fois particulière et universelle au même titre que les autres civilisations, ainsi nommées par les Européens qui ont inventé le terme au XVIIIe siècle, sont à la fois universelles et particulières.
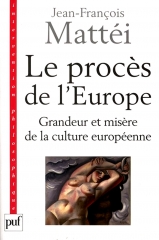
Il se trouve que la condition humaine tient à ces trois pôles de l’universel, du particulier et du singulier. Je suis un homme singulier, distinct des autres hommes singuliers, mais appartenant à une communauté particulière, la culture française. Cela ne m’empêche en rien de posséder, comme tout autre homme, la caractéristique universelle de l’humanité. Les droits qui s’y attachent, la dignité et la liberté parmi d’autres, en concernant les hommes singuliers et leurs attaches particulières, sont néanmoins inscrits dans l’universalité de l’homme. Ce qui justifie d’emblée la possibilité d’une Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Si Joseph de Maistre, comme le rappelle Pierre de Meuse, n’avait jamais rencontré « l’homme », c’est-à-dire le concept ou l’idée abstraite d’humanité, mais seulement ces individus particuliers que sont les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, etc., cela n’empêchait pas de Maistre de savoir qu’il partageait son humanité avec les autres hommes. Telle est bien l’invention de l’Europe : l’humanisme qui fonde son universalité dans l’universalité du cosmos, comme on le voit avec l’Uomo universale de la Renaissance italienne, par exemple chez Léonard de Vinci. Les lois universelles de la nature, appréhendées par la science théorique, se reflètent dans les lois universelles de l’homme, appréhendées par l’action pratique, dans le droit, la politique et la morale.
Pierre de Meuse se demande si l’Europe, à force d’ouverture vers l’universel, ne s’est pas empoisonnée avec ses propres concepts. C’est bien ce que je soutiens dans mon livre. L’ouverture aux autres peuples, qui a permis de créer l’ethnologie, une invention purement européenne, tend toujours à se perdre dans ces autres peuples pour mieux critiquer, de leur point de vue, les défauts de la raison européenne ou ses perversions (guerres de religion, massacres, colonialisme, guerres mondiales, et j’en oublie !). Quand Montesquieu fait appel à un Persan, et Diderot à un Tahitien, c’est sans doute pour connaître d’autres peuples et reconnaître leur existence. Mais c’est surtout pour dénoncer l’infidélité des Européens à leurs principes humanistes. Au demeurant, qui parle dans Les Lettres persanes ou dans le Supplément au voyage de Bougainville ? L’indigène, de son point de vue particulier, ou l’Européen, de son point de vie universel ?
Ce n’est pas seulement l’Europe qui a joué sur les deux tableaux, l’universalité de son exigence et la particularité de son enracinement. Toutes les autres cultures, dès qu’elles ont accédé à l’’universel par la mondialisation (communication, échange, enseignement, économie, politique), se sont trouvé confrontées au même problème de la coexistence de l’universel avec leurs particularités irréductibles. Comme l’universel est encore plus irréductible, car le théorème de Fermat est aussi valide pour le mathématicien de Montauban que pour le mathématicien de Tombouctou, chaque peuple, y compris les peuples européens, se sent tiraillé entre la fidélité à son héritage spécifique et la nécessité de se plier au mode de vie universel, c’est-à-dire rationnel.
Le paradoxe sur lequel butte Pierre de Meuse est celui de la critique des concepts européens, en clair la critique de la culture de l’Europe, qui s’est ouverte exagérément et peut-être illusoirement. Cette critique n’est-elle même possible, qu’elle vienne d’un Européen ou d’un non-Européen, d’un chrétien, d’un musulman ou d’un athée, que si elle se fonde sur des outils conceptuels européens (identité, contradiction, méthode, expérimentation, bref usage d’une démonstration rationnelle). La raison, comme le disait Descartes du « bon sens », est la chose du monde la mieux partagée. On ne peut donc la mettre en cause qu’à partir de ses propres postulats, et non à partir de ses applications qui peuvent être erronées ou condamnables. La raison européenne a fait beaucoup de mal, et d’abord à l’Europe elle-même, cette « Europe qui n’aime plus la vie » comme l’écrivait Camus dans L’Homme révolté. Mais le même auteur n’hésitait pas à reconnaître que l’Europe était, malgré tout, « cette terre de l’esprit où depuis vingt siècles se poursuit la plus étonnante aventure de l’esprit humain » (Lettres à un ami allemand, III, 1945). Camus, comme Pierre de Meuse qui termine son article sur un appel au tragique de l’existence, était sensible au « sentiment tragique de la vie », pour parler avec Unamuno. Je le suis également et ne crois pas que la raison épuise toutes les ressources de la pensée et de l’existence. Il reste que, depuis des siècles, l’homme n’a pas réussi à trouver un autre universel que celui de la raison, théorique et pratique, et que, pour l’instant, cette même raison est à la fois juge et partie du litige, comme l’Europe particulière est à la fois juge et partie de l’ouverture aux cultures particulières. Il nous faut vivre avec ce paradoxe qui est peut-être, effectivement, plus tragique que rationnel.
Jean-François Mattéi
20 février 2013
___________________
* Jean-François Mattéi, Procès de l’Europe, Grandeur et misère de la culture européenne, PUF, 22 €, 264 p.
** Pierre de Meuse, « Le procès de l’Europe de Jean-François Mattéi » (Lafautearousseau, jeudi 27 décembre 2012)












Edmund Husserl prononçait à Vienne le 7 mai 1935, sa célèbre conférence sur La crise de l’humanité européenne et la philosophie.
Il y exposait que l’Europe a d’abord un sens spirituel, dont il faisait une idée régulatrice à portée universelle. L’identité de l’Europe, selon lui, est moins un fait qu’une valeur spécifique, moins une donnée géographique qu’un horizon de sens lié à son émergence et à sa construction.
Comme bien d’autres avant lui, Husserl situe le « lieu de naissance spirituel » de l’Europe dans la Grèce antique. A partir de l’étonnement, du regard étonné porté sur le monde à partir de la liberté prenant conscience d’elle-même, les Grecs vont développer une attitude philosophique, c’est-à-dire une attitude questionnante où la réponse n’est pas donnée par avance par la religion, les moeurs ou la tradition. Le résultat de cette démarche va être une donation de sens constitutive d’un monde, donation qui possède aussi une dimension politique. Husserl appelait l’Europe à « renaître de l’esprit de la philosophie par un héroïsme de la raison ».
« Le plus grand péril qui menace l’Europe, disait encore Husserl, c’est la lassitude ». La perte d’énergie, la fatigue d’être soi. Le désir d’oubli de soi, non pour retrouver une innocence perdue, qui pourrait être la condition d’un nouveau départ, mais pour s’endormir plus aisément dans le nihilisme bruyant, le repli sur la sphère privée et le confort narcissique de la consommation.
Les propos de Jean François Mattéi sont particulièrement
éclairants dans sa réponse à Pierre de Meuse.