
(Tiré de « Lectures », Fayard, pages 193 à 196)
 La margrave de Bayreuth, ou, comme on disait alors et comme elle disait elle-même, de Bareith, vient d’être mise au théâtre. Ses mémoires, devenus introuvables, vont être réédités. C’est d’ailleurs le type du livre dont la réputation repose sur un malentendu. Célèbre et peu lu, on le prend pour ce qu’il n’est pas. Sur la foi de lettres et de quelques vers de Voltaire, on croirait y trouver le miroir des élégances du dix-huitième siècle alors que les souvenirs de cette princesse royale, fille du roi-sergent et sœur de Frédéric (1) sont d’un réalisme brutal.
La margrave de Bayreuth, ou, comme on disait alors et comme elle disait elle-même, de Bareith, vient d’être mise au théâtre. Ses mémoires, devenus introuvables, vont être réédités. C’est d’ailleurs le type du livre dont la réputation repose sur un malentendu. Célèbre et peu lu, on le prend pour ce qu’il n’est pas. Sur la foi de lettres et de quelques vers de Voltaire, on croirait y trouver le miroir des élégances du dix-huitième siècle alors que les souvenirs de cette princesse royale, fille du roi-sergent et sœur de Frédéric (1) sont d’un réalisme brutal.
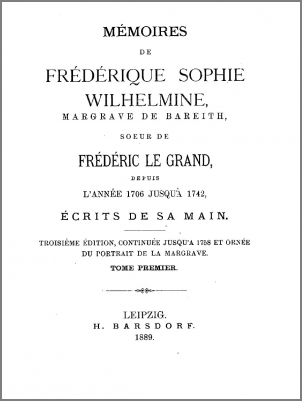 Cependant la margrave écrivait en français. Elle a droit de cité dans notre littérature. Elle est un autre témoin de l’âge où Grimm et l’abbé Galiani rivalisaient avec nos auteurs, où le napolitain Caracioli composait un livre à la gloire de l’Europe française. Les mémoires de Frédrique Sophie Wilhelmine, princesse de Prusse, font revivre une Allemagne presque francisée dans ses classes supérieures et dont les derniers vestiges n’ont disparu qu’après Sedan. En 1914, un prince de Salm, se souvenant d’un de ses ancêtres, celui qui avait construit à Paris l’hôtel qui est devenu le palais de la Légion d’honneur, répugnait encore à se battre contre la France. Il demanda à être envoyé sur le front russe où le sort voulut qu’il fût tué. Il y a plus d’internationalisme derrière nous que devant nous.
Cependant la margrave écrivait en français. Elle a droit de cité dans notre littérature. Elle est un autre témoin de l’âge où Grimm et l’abbé Galiani rivalisaient avec nos auteurs, où le napolitain Caracioli composait un livre à la gloire de l’Europe française. Les mémoires de Frédrique Sophie Wilhelmine, princesse de Prusse, font revivre une Allemagne presque francisée dans ses classes supérieures et dont les derniers vestiges n’ont disparu qu’après Sedan. En 1914, un prince de Salm, se souvenant d’un de ses ancêtres, celui qui avait construit à Paris l’hôtel qui est devenu le palais de la Légion d’honneur, répugnait encore à se battre contre la France. Il demanda à être envoyé sur le front russe où le sort voulut qu’il fût tué. Il y a plus d’internationalisme derrière nous que devant nous.
Le miracles des mémoires de la margrave, c’est qu’ils sont de la langue la plus coulante, au point d’en paraître native, et, de surcroît, presque toujours pure. Qui croirait que cette femme n’est jamais venue à Paris, qu’elle a vécu dans de petites cours grossières, dont elle a laissé des tableaux comiques avec un sentiment du ridicule aussi vif qu’inattendu ? On y retrouve en vingt endroits le château du baron Thunder-ten-Tronckh et le baron lui-même. Ce mouvement, cette couleur, ce style et cette syntaxe si rarement prise en défaut, où les a-t-elle pris ?
 Il faut le savoir pour comprendre la merveille de cette naturalisation à distance. Wilhelmine avait partagé avec son frère Frédéric (ci contre, âgé d’une soixante d’années) une éducation à la française, donnée par des Français. L’un s’appelait Jacques Duhan, l’autre Mme de Rocoulles. Et tous les deux étaient des réfugiés.
Il faut le savoir pour comprendre la merveille de cette naturalisation à distance. Wilhelmine avait partagé avec son frère Frédéric (ci contre, âgé d’une soixante d’années) une éducation à la française, donnée par des Français. L’un s’appelait Jacques Duhan, l’autre Mme de Rocoulles. Et tous les deux étaient des réfugiés.
Les protestants émigrés à la révocation de l’Edit de Nantes ont porté beaucoup de choses à l’étranger. Ils y ont porté aussi notre parler et nos lettres, y étant venus tels qu’ils étaient et tout entiers. Duhan de Jandun, le père, sorti de son pays en 1687, s’était rendu à Berlin. Il y devint secrétaire du grand électeur. Il ne voulut même pas confier son fils au collège des réfugiés et se chargea lui-même de son éducation, assisté de deux coreligionnaires, lettrés et savants, dont l’un La Croze, fut connu de Frédéric II enfant. Jacques Duhan, entré au service de la Prusse, n’en était pas moins Français jusqu’au bout des ongles. Pour sa bravoure il fut remarqué du roi-sergent au siège de Stralsund. « Il est rare – disait Frédéric – qu’on prenne un précepteur dans une tranchée. » C’est pourtant ce qui arriva.
Quand à Mme de Rocoulle, jeune veuve au moment de la révocation, elle avait quitté la France avec les siens, à tous risques, et trouvé un asile auprès de Sophie-Charlotte, femme du premier roi de Prusse. Il y avait trente ans que Mme de Rocoulle vivait à Berlin, qu’elle y tenait un salon, et elle ne savait pas un mot d’allemand. Elle parlait comme Mme de Sévigné, elle avait de l’esprit, ne craignait pas les plaisanteries gaillardes, rimait volontiers de petits vers. Tout cela s’est retrouvé chez ses élèves, car, en 1714, elle avait été nommée « gouvernante auprès du prince et des princesses royales ».
Voilà le mystère expliqué. Nous savons ainsi comment Frédéric et sa soeur avaient pris le goût d’écrire en français. Elle y réussit du reste encore mieux que lui. Chose curieuse, le style de la soeur est relevé auatnt que celui du frère est sec, pédant et fade. On a souvent comparé les souvenirs de la margrave au récit de l’Ecossais Hamilton, les Mémoires du chevalier de Grammont. Elle raconte plutôt comme Lesage, dont elle n’a pu manquer de lire les romans, alors dans leur vogue. Tout le récit de l’entrée à Bareith, la peinture des lieux, des gens, des costumes, des façons d evivre, ont le même genre de verve que Gil Blas. De Mme de Rocoulle, elle tenait le franc-parler et la verdeur du grand siècle, si peu bégueule. La visite à Berlin de Pierre le Grand et de la tsarine, les orgies de Dresde, sont d’un écrivain haut en couleur et qui, à chaque instant, a des trouvailles. Parfois le réalisme est presque choquant et l’on ne songe plus à comparer la margrave aux précieuses lorsqu’on lit le portrait du prince du Neustedt :
« La qualité des rats qui logeaient dans sa cervelle exigeait beaucoup de place; aussi y en avait-il beaucoup dans sa caboche qui était copieusement grande. Deux petits yeux de cochon d’un bleu pâle remplaçaient assez mal le vide de cette tête; sa bouche carrée était un gouffre dont les lèvres retirées laissaient voir les gencives et deux rangées de dents noires et dégoûtantes; cette gueule était toujours béante; un menton à triple étage ornait ces charmes; un emplâtre servait d’agrément à la partie inférieure de ce menton; il y était flanqué pour cacher une fistule, mais comme il tombait souvent on avait le plaisir de la contempler à son aise. »
A une plume aussi libre, il fallait un sujet extraordinaire. La margrave l’a eu puisque c’est le drame de la cour de Prusse, la querelle tragique du roi-sergent et du prince royal. Elle a été hardie à le traiter. Il est pourtant resté d’elle l’image d’une précieuse, ce qui fait un chapitre à ajouter à l’histoire des réputations littéraires, des oublis et des erreurs dont elle est remplie. ■ Jacques Bainville, « Lectures », Fayard, 1937.
Mieux que de longs discours… : au XVIIIe siècle, alors que son pays a commencé son ascension, le roi de Prusse grave sur la pierre, en français, le nom de son château ! Impensable aujourd’hui, et symbole du déclassement de la France par la Révolution et par la République idéologique qui en est issue et s’en revendique.
(1) : Dans une autre de ses notes, Bainville rappelle que le roi de Prusse, à l’époque de Voltaire, ne s’exprimait qu’en français, ne lisait aucun livre d’auteur allemand et, lorsque le cas – rarissime – se présentait, se faisait d’abord… traduire le livre en français ! : un tel engouement pour notre langue, notre civilisation, notre pays; et une telle prépondérance – on peut même dire une telle hégémonie française… – serait tout simplement inimaginable de nos jours…
Publié le 1er août 2017 – Actualisé le 18 février 2023.













« uelle différence entre les Allemands tels qu’on les a vus depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe et tels que nous les voyons aujourd’hui ! Aussi souples, aussi empressés à se former à notre école, à imiter nos moeurs et à parler notre langue que nous les trouvons orgueilleux, insociables, infatués de leur « culture », convaincus de la supériorité de leur race. Les Allemagnes, à partir de 1650, furent comme une sorte de « province » où le peuple parlait encore un patois grossier, mais où les gens comme il faut ne se servaient que de notre langage. Les arts, les sciences, tout y était devenu français. Le nationalisme germanique du XIXe siècle s’est scandalisé de ce reniement de l’Allemagne par elle-même. Ses historiens rappellent comme un honteux souvenir le long règne de l’influence et de la civilisation françaises au delà du Rhin. « Le patriote allemand, dit Biedermann, ne peut qu’en rougissant reporter son regard sur l’époque où, tandis que Louis XIV annexait des terres d’Empire avec une ambition altière, la fleur de la noblesse allemande lui rendait hommage et se sentait très honorée lorsque le dernier de ses courtisans daignait approuver tant d’efforts pour singer la cour de France. » La princesse palatine trouva à Paris sept princes, quatre comtes, dix gentilshommes de son pays. Par la suite le nombre de ces courtisans s’accrut… »
Jacques Bainville, Histoire de deux peuples.
Erratum : « Quelle différence… »