Par Mathieu Bock-Côté

Cette tribune de Mathieu Bock-Côté – de celles que nous reprenons souvent pour leur pertinence – est parue dans le Journal de Montréal du 27 avril. Qu’on le lise ! Tout simplement. LFAR

« Il incarnait un homme ne doutant pas d’être un homme »
Jean-Pierre Marielle est mort cette semaine.
Pour les plus jeunes, ce nom ne veut probablement rien dire. Hélas ! Mais pour ceux qui se souviennent d’un temps où les Québécois s’intéressaient autant à ce qui passait en France qu’aux États-Unis, c’est autre chose. Avec Jean Rochefort et Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle incarnait de la plus belle manière le style français. On se souvient ainsi du film Les Grands Ducs. On pourrait en nommer d’autres.
Marielle
Le cinéma de l’époque permettait d’accéder à la part la plus vivante de la culture française. Avec sa voix inoubliable, Marielle a lancé quelques-unes des grandes répliques qui ont fait l’histoire du cinéma français. En fait, il représentait un monde d’avant le puritanisme qui rend fou. Il incarnait un homme ne doutant pas d’être un homme, et ne doutant pas non plus de son amour des femmes. Il incarnait, autrement dit, une certaine manière d’être français, qui peut nous sembler incompréhensible à notre époque où progresse une forme d’uniformité culturelle déprimante, où tout le monde doit ressembler à tout le monde. Une manière joyeuse et râleuse, gouailleuse et querelleuse. Une manière qui donne du sel à l’existence !
Apparemment, il faudrait aimer notre monde fade, tiède et beige, où les discussions des uns et des autres semblent de plus en plus préformatées. Même la langue populaire se moule de plus en plus sur la langue publicitaire.
Mais qui se tourne vers le cinéma de Jean-Pierre Marielle découvre un type d’humanité d’avant le conformisme mondialisé, qui assèche la vie. Un tel acteur serait-il même possible aujourd’hui ?
France
En fait, encore une fois, devant l’impérialisme médiatique américain, le détour par le cinéma français des belles années nous permet de découvrir un univers avec lequel nous ne sommes plus familiers : celui de la liberté.
On pourrait aussi parler plus simplement du détour par la France. ■
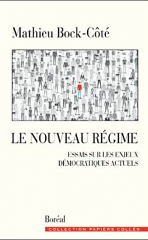












Il était le dernier survivant d’un trio somptueux qu’il formait avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, de qui, dans les mémoires, il était presque inséparable. Et pourtant les trois comédiens n’ont joué ensemble que deux fois : « Que la fête commence » de Bertrand Tavernier en 1975 et « Les grands ducs » de Patrice Leconte en 1996. Mais ce trio, qui a empli de talent les écrans français, représente, d’une certaine façon, le meilleur du cinéma du dernier tiers du siècle passé.
Mais combien, aussi, de grands rôles en solo, depuis un sketch parmi les meilleurs des inégales « Dragées au poivre » de Jacques Baratier en 1963 jusqu’aux douloureuses « Âmes grises » d’Yves Angelo en 2005 ? Jean-Pierre Marielle pouvait jouer des personnages extraordinairement différents, mais sa voix, sa prestance, sa présence l’imposaient de façon naturelle et évidente.
Bien sûr Henri Serin des fastueuses « Galettes de Pont-Aven » de Joël Séria en 1975, mais aussi l’exténué Paul Dufour dans « Calmos » de Bertrand Blier en 1976 et le janséniste grave Sainte-Colombe dans « Tous les matins du monde » d’Alain Corneau en 1991… Et tant d’autres créations fascinantes.
Mais ce qui me restera en tête, sans doute, c’est le docteur René Meinthe, du « Parfum d’Yvonne » de Patrice Leconte en 1994, où il joue un médecin homosexuel flamboyant et fatigué. Qui ne l’a vu, portant une chéchia et se proclamant la reine des Belges exiger qu’on lui baise la main a perdu un grand moment de pur talent… La meilleure adaptation jamais réalisée d’un Modiano (« Villa triste »)
Je me souviens il y a quelques années, alors que je passais devant Notre-Dame, l’avoir vu sortir des jardins de l’Archevêché qui avait un air des plus sombres ; il a remarqué que je l’avais reconnu et, sans doute de crainte que je veuille l’aborder (du type J’aime beaucoup ce que vous faites !), il m’a lancé un regard noir incandescent qui m’aurait coupé, si j’en avais eu, toute velléité de lui adresser la parole. Mais sans doute a-t-il lu aussi dans mon regard toute mon admiration