
Par Francis Venciton.
Cet article fait partie d’une suite de neuf. Les 9 articles paraissent en feuilleton, à dater du mercredi 22 septembre et les jours suivants. Fil conducteur : l’écologie. Les auteurs sont de jeunes cadres du mouvement royaliste, engagés à l’Action française. Vous apprécierez leur réflexion. Au besoin, vous en débattrez. Ces articles seront constitués en dossier, toujours consultable ici. 
J’AI UNE JOIE DANS LA VIE. Elle consiste à lire la presse parler de la croissance économique française.
Autant dire que je me pâme lorsqu’elle s’intéresse à l’un de nos politiques nous promettant des lendemains qui chantent grâce à la croissance économique. Chaque année se termine pourtant de la même manière : nous peinons à dépasser le 1 % de croissance. Cela fait un peu minable comparé au Rwanda et ses 12 % de croissance en 2019. Comme quoi, même un génocide africain ne peut arrêter la déesse Croissance et ses cornes d’abondance.
Blague à part, il est toujours fascinant de voir à quel point nos sociétés sont obsédées par la croissance et le progrès illimité. A écouter les économistes, il semble que les arbres peuvent pousser jusqu’au ciel et que la disparition du capital naturel n’est qu’un point de détail que le temps réglera petit à petit grâce au pouvoir de la science. Définitivement, l’optimisme de notre époque est une imbécillité heureuse, car il est évident qu’il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini.
C’est normalement ici que quelques pessimistes hurleront après moi en me qualifiant à raison de décroissant et en m’accusant à tort de vouloir nous faire marcher à quatre pattes. Lâchons le gros mot : il faut une décroissance de l’économie mondiale. Acceptons de connaître quelques décroissances ; cela serait même bon pour nos économies. Nos coeurs ont bien besoin d’alterner diastole et systole. Cependant, cela serait surtout positif en ce que nous serions délivrés de l’angoisse de ne pas parvenir à la croissance, et nous permettrait de nous intéresser à notre voisin, de renouer avec cette convivialité qui si longtemps était au cœur de nos sociétés. Elle était charmante comme une petite vieille.
Une alternative traditionaliste
Evidemment, lorsqu’on parle de décroissance, les gens se méprennent. Il faut dire que le mot est de mauvais français, qu’il est négatif et pas très encourageant. En l’entendant, il ne faudrait pas en faire l’inverse de la croissance. A la croyance que le ciel est la limite, il ne faut pas imposer l’idée tout aussi folle qu’il faut aller toujours plus loin dans la négation. Nietzsche est un bon enseignant pour savoir qu’une théorie saine, vraie, est quelque chose qui dit oui à la vie. Elle accepte le réel tel qu’il est. Juger ce qui est comme étant en deçà de nos attentes est quelque chose de très humain ; s’en contenter, du pur infantilisme. Le catastrophiste, ou collapsologue quand il est érudit, n’est jamais qu’un enfant, et c’est d’ailleurs une jeune fille qu’il a prise pour idole. Alors, posons avec soin les pôles : la décroissance n’est pas le pôle absolu contre la croissance, elle est une alternative. Une alternative qui – surprise ! – est traditionaliste, car toute la pensée de la décroissance tient à la protection du capital, et en particulier du capital spirituel. L’enjeu clef de la décroissance est la survie des sociétés dans la durée. La décroissance, à bien des égards, est l’application de nos devoirs envers nos descendants.
L’ennui de la question de la croissance ou de la décroissance, c’est qu’elle est posée au niveau global. Il ne saurait être question de protéger les capitaux de la planète seulement à un échelon individuel ou à l’échelle mondiale. Qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore, l’échelon national reste encore l’échelon essentiel des décisions politiques. Dès lors, pour qu’une décroissance ait quelque chance, il ne s’agit pas tant de transformer un pays en paradis terrestre du « décroissantisme » que de coordonner une révolution « décroissantiste » au niveau mondial, en opérant des modifications décroissantes dans les nations.
Un post-silloniste pourrait objecter que le simple fait d’être un exemple serait suffisant pour changer chaque acteur. Les prophètes désarmés finissent mal et l’histoire ne manque pas d’exemples pour voir qu’influencer ses voisins ne dépend pas toujours de l’exemple ou de l’intelligence proposés. C’est pour cela qu’il ne faut pas séparer la décroissance de la question de la puissance. Car sans capacité de rallier à notre drapeau, à quoi bon agir et se sacrifier ? Mourir de faim pour engraisser le voisin est une déraison qui ne peut que répugner aux gens bien nés. Mais il y a pire encore : le scénario peut être envisagé d’un voisin profitant d’une politique de décroissance pour nous mettre à bas, ce qui donnerait ce paradoxe qu’en voulant participer à la décroissance, on finit par renforcer la secte de la croissance. C’est pour cela que la décroissance n’a de sens que dans des rapports de puissance. Ce qui importe, ce n’est pas la disparition de toute nation par la création d’un super-empire, mais au contraire de mener une géopolitique capétienne d’équilibre des puissances.
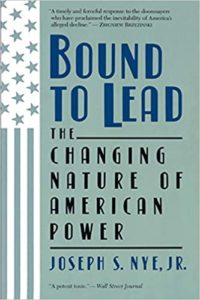 Ce serait une vision un peu courte de penser que la puissance d’une nation dépend de sa croissance économique. Depuis le classique Bound to Lead de Joseph Nye, nous savons bien que l’on peut distinguer le soft power du hard power. C’est-à-dire les outils de la puissance classique d’un Etat – l’armée, la diplomatie, les pressions économiques – et la puissance de contrainte à travers la réputation de l’Etat, sa production culturelle, son art de vivre. Si le second peut n’être que marginalement touché par la décroissance, le premier le serait davantage, sauf que ce qui importe n’est pas la quantité mais la bonne utilisation des ressources. L’Allemagne a su longuement tenir durant la Première Guerre mondiale malgré des ressources inférieures, grâce à une bonne optimisation des ressources et un écart technologique acceptable.
Ce serait une vision un peu courte de penser que la puissance d’une nation dépend de sa croissance économique. Depuis le classique Bound to Lead de Joseph Nye, nous savons bien que l’on peut distinguer le soft power du hard power. C’est-à-dire les outils de la puissance classique d’un Etat – l’armée, la diplomatie, les pressions économiques – et la puissance de contrainte à travers la réputation de l’Etat, sa production culturelle, son art de vivre. Si le second peut n’être que marginalement touché par la décroissance, le premier le serait davantage, sauf que ce qui importe n’est pas la quantité mais la bonne utilisation des ressources. L’Allemagne a su longuement tenir durant la Première Guerre mondiale malgré des ressources inférieures, grâce à une bonne optimisation des ressources et un écart technologique acceptable.
 Il est passionnant de voir que les grandes puissances industrielles qu’étaient la France et les Etats-Unis ont chacune perdu contre le Vietnam qui n’était qu’une puissance faiblement industrialisée.
Il est passionnant de voir que les grandes puissances industrielles qu’étaient la France et les Etats-Unis ont chacune perdu contre le Vietnam qui n’était qu’une puissance faiblement industrialisée.
Et puis, notre pays a cette chance de se permettre la décroissance sous le parapluie atomique. En fait, s’il faut imaginer un obstacle majeur à la décroissance, ce ne serait pas tant la doctrine elle-même ou le reste du monde que notre régime politique : la démocratie. (Série à suivre) ■
À lire dans cette série Écologie …
Écologie : feu la gauche
Écologie : Pouvoirs et écologies
Écologie : Bête comme un homme antispéciste
Écologie : Les angoissés du climat
Écologie : Le salut par les machines
Article précédemment paru dans Présent [18 février 2020]
© JSF – Peut être repris à condition de citer la source
Publié le 17 avril 2020 – Actualisé le 28 septembre 2021












Un beau texte de Michel Maffesoli qui aborde, quoique sous une autre perspective les problèmes soulevés par l’article d’aujourd’hui
Le divertissement est, on le sait, une des échappatoires habituelles de notre paresse intellectuelle. Mais comme cela n’est pas très convenable, on va le parer de rationalisations, de légitimations toutes plus pédantes les unes que les autres. L’esprit de sérieux est, en général, fort frivole. Ce qu’il s’emploie à masquer par un affairement sans horizon.
2Pauvres animaux domestiques qui, suite à une atrophie de leurs sens, sont abasourdis par ce que le poète appelle, bellement, « le clapotis des causes secondes » (Claudel) ! En bref, ils sont incapables d’écouter, a fortiori d’entendre, le bruit de fond du monde. Voire le vacarme que fait le courant central d’un fleuve, ayant, de ses flots, irrigué, sur la longue durée, l’ensemble d’une contrée. À l’image du bassin hydrographique, il existe ce que l’anthropologue Gilbert Durand nomme un « bassin sémantique » où, stricto sensu, le sens se constitue. Ce qui permet de comprendre l’aboutissement des causes secondes, ce mainstream autour duquel, progressivement, tout va s’organiser et s’ordonner.
3Allons donc à l’essentiel. Voilà à quoi s’emploie Martin Heidegger dans « La question de la technique » : questionner, dit-il, « c’est travailler à un chemin, le construire ». Et cette question essentielle il tente de l’illustrer par ce qui, dans la tradition occidentale, et plus particulièrement à partir des racines sémitiques, va être à l’origine de toutes choses : le mépris de ce monde-ci. Pour citer, toujours et à nouveau, saint Augustin : mundus est immundus. Le monde est immonde. Et il convient donc de traverser le plus rapidement possible in hac lacrimarum valle, dans cette vallée de larmes, afin d’accéder, plus tard, à la béatitude dans un monde à venir.
4C’est ce mépris que, au-delà de sa forme religieuse, l’on va retrouver, sous son aspect profane, dans la grande construction marxiste. Puis il va se diffuser, subrepticement, dans toutes les militances partisanes : cette terre-ci n’est pas bien. Il faut soit la nier, la dénier, la changer, la réformer, la révolutionner. Mépris, ai-je dit, qui est cause et effet d’une conception représentative, métaphysique du monde. Prenons ce dernier terme stricto sensu : au-delà de la physique. Phusis, nature. Nature bien trop sauvage et qu’il faut donc brider, forcer, canaliser.
5Mépris, qui est refus de ce qui est. Et de l’être en général. Peut-être de ce Grand Être dont parlait ce fou génial d’Auguste Comte. Grand Être : non le Dieu abstrait et séparé des monothéismes sémites, celui que Lautréamont appelait ironiquement le Grand Objet Extérieur, mais Être rassemblant, organiquement, l’ensemble des vivants et des morts, la faune, la flore et autres expressions de « l’élan vital ».
6Mais voilà le point d’inversion auquel fait référence Heidegger : une autre conception de la technique, à savoir le retour de la puissance destinale. Puissance venant de fort loin et retrouvant une nouvelle vitalité dans les pratiques juvéniles, dans les afoulements sportifs, dans les hystéries musicales et autres rassemblements religieux. Au travers de tous ces phénomènes, c’est la sauvagerie de la nature qui s’exprime. Attitudes radicales, c’est-à-dire renouant avec ces racines profondes constituant la chaîne sans fin reliant un siècle à l’autre. Chaîne que le progressisme avait cru rompre : le XIXe siècle étant, ne l’oublions pas, le triomphe de celui que Karl Marx célébrait comme étant Prométhée déchaîné !
7À cette figure est en train de se substituer celle de Dionysos. Dieu chtonien, dieu de cette terre-ci, dieu autochtone. Archétype de la sensibilité écologique, Dionysos a de la glèbe aux pieds. Il sait jouir de ce qui se présente et des fruits offerts par ce monde, ici et maintenant. On a pu qualifier cette figure emblématique de « divinité arbustive ». Un dieu enraciné ! C’est ainsi que l’on peut comprendre ce véritable « Manifeste » qu’est cette essentielle question heideggérienne.
8Voilà un curieux paradoxe. Les dieux ne sont-ils pas ouraniens tournés vers le céleste et le ciel des idées ? Détachés de ce monde et de ses plaisirs ? Il s’agit là d’un symbole instructif. Métaphore permettant d’éclairer de nombreux phénomènes de la société postmoderne. Il y a dans la jouissance du présent propre à l’hédonisme mondain quelque chose rattachant à un passé ancestral, à une mémoire immémoriale. En son sens strict un ordre traditionnel.
9C’est l’historien Philippe Ariès qui rappelait que le passé est la « pierre de notre présent » [1]
[1]
P. Ariès, Un historien du dimanche, Seuil, Paris, 1980, p. 36.. On pourrait poursuivre en signalant que le présent n’est que la cristallisation du passé et de l’avenir. L’intensité (in tendere) vécue maintenant prend sa source dans ce qui est antérieur et permet que se développe une énergie future. Chaîne du temps. Enracinement dynamique. Ce qui à l’opposé de l’anthropocentrisme rend attentif à ce qui en l’homme « passe l’homme ». C’est ainsi que Pascal définissait le fameux « roseau pensant » dont on a négligé le fait que tout en étant « pensant » il n’en est pas moins « roseau ». On peut, même, dire qu’il ne peut penser qu’en se souvenant de ses racines. Autre manière de rappeler la structurelle communion avec la nature.
10On retrouve là l’animisme de longue mémoire. Un paganisme revêtant une forme contemporaine. La deep ecology pourrait en être la version paroxystique. Paganus. Il y a, en effet, quelque chose de païen dans le succès des produits « bio » et la recrudescence de l’attachement aux diverses valeurs liées au terroir, au territoire et autres formes spatiales. Le présent, c’est du temps qui se cristallise en espace, qui ne projette plus le divin dans l’au-delà, mais au contraire l’insère dans le terrestre. À l’opposé de ce qu’il nommera plus tard la « dévastation du monde », Heidegger souligne la nécessité de se réenraciner.
11Voilà bien à l’opposé du progressisme la spécificité du progressif. Celui-là met l’accent sur le pouvoir du faire, sur l’action brutale et le développement sans frein des forces prométhéennes. Celui-ci, au contraire, s’attache à mouvoir de l’intérieur, à mettre en œuvre une puissance naturelle. Encore Prométhée et Dionysos ! Il s’agit là de figures spirituelles. Mais ce sont aussi des symboles opératoires en ce qu’ils permettent de voir sous un jour nouveau une vie quotidienne où le bien-être n’est rien au regard du mieux-être. Vie courante où, dans le rythme des travaux et des jours, le qualitatif retrouve une place primordiale. Qualité de vie. Expression un peu passe-partout mais définissant bien l’esprit du temps.
12C’est ce que nous indique le penseur : « La loi cachée de la terre conserve celle-ci dans la modération qui se contente de la naissance et de la mort de toutes choses dans le cercle assigné du possible [2]
[2]
M. Heidegger, Essais et conférences, Gallimard, Paris, 1958,…. » Sagesse de la modération issue de l’acceptation tragique d’un présent que l’on pressent précaire et qui, dès lors, nécessite de l’intensité. Du plaisir d’être à partir de l’être des choses. C’est ce qui semble en jeu dans la socialité propre à la « progressivité » contemporaine. Mais on ne pourra bien l’apprécier que si l’on sait faire la généalogie du mythe du Progrès qui, trouvant sa source dans la culture judéo-chrétienne, s’est épanoui à l’époque moderne.
13On est là au cœur battant de ce que l’historien des sciences Thomas Kuhn a appelé la structure des révolutions scientifiques [3]
[3]
T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, traduit de…. À savoir, grâce à l’analyse scientifique, la possibilité pour une civilisation d’emprunter la via recta de la raison. Et pour ce faire, afin d’aller droit au but, de laisser sur le bord de la route tous ces « impedimenta », bagages inutiles, alourdissant la démarche : l’onirique, le ludique, le festif et autres paramètres humains n’entrant pas dans le dessein providentiel de la Déesse Raison. Droit au but, certes, mais la Marche Royale du Progrès semble, quelque peu marquer le pas tant, pour le dire d’une autre manière quelque peu sophistiquée, on est en pleine hétérotélie. On a atteint un autre but (heteron telos) que ce qui était prévu : un non-monde, une dévastation du monde. Effet pervers, s’il en est, mais effet prévisible.
14Ne l’oublions pas, après la séparation inaugurale, le jardin d’Éden est donné à l’homme à cultiver (Genèse 2, 15). Celui-ci doit soumettre la terre. Il a la mainmise sur la faune et la flore. Il est, essentiellement, mû par une logique de domination. L’animal humain est programmé pour s’ériger en maître de toutes les autres espèces animales. Ou, pour le dire d’une manière imagée, notre cerveau reptilien ne peut que répondre à l’injonction divine : « Que l’homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles… » (Genèse 1, 26-28).
15Séparation – domination. Voilà les deux caractéristiques du mythe du Progrès. Voilà les racines du paradigme moderne. La nature devient un « ob-jet » [4]
[4]
Cf. M. Heidegger, L’affaire de la pensée : pour aborder la… (ce qui est jeté devant nous) dominé par un « su-jet » (substantiel) autosuffisant et, surtout, metteur en scène d’une Raison souveraine fondement du développement scientifique, puis technologique. C’est par et grâce à cette rationalisation généralisée de l’existence (Max Weber) qu’est rompue la participation magique, la correspondance mystique que l’homme, dans les sociétés prémodernes, entretenait avec son environnement naturel. En restant dans une perspective wébérienne, c’est un tel désenchantement du monde qui a conduit la modernité à l’idée monomaniaque d’une nature inerte à exploiter.
16Idée monomaniaque ne manquant pas de devenir destructrice. Le rationalisme sans contrepoids, aboutissant, inéluctablement, à la morbidité. En effet, le propre de l’action rationnelle est de privilégier la volonté extérieure. Le monde n’est plus laissé à sa croissance naturelle : le monde qui abonde en lui-même, mais est assujetti, en totalité, à une action extérieure. Action légitime quand elle est pondérée par d’autres facteurs spirituels ou symboliques. C’est-à-dire quand cette action s’inscrit dans une conception ou une préconception de la totalité. Mais action qui devient activisme quand le « faire », l’utilité, l’ustentilarité sont les seuls éléments qui, en dernier ressort, sont pris en considération. On est au cœur même du productivisme moderne [5]
[5]
Cf. J. Baudrillard, Le miroir de la production, Casterman,….
17« La question de la technique » de Heidegger rompt avec une telle conception paranoïaque du monde. Ainsi qu’il l’indique, à la fin de son essai : « Plus nous approchons du danger, et plus clairement les chemins menant vers “ce qui sauve” commencent à s’éclairer [6]
[6]
M. Heidegger, « La question de la technique », in Essais et…. » C’est bien la leçon que semblent retenir tous ces « techno-magiciens » que sont les utilisateurs des nouveaux moyens de communication interactifs qui par leur action participent à un véritable réenchantement du monde.
Un bau texte de Heidegger, de 1935 qui montre la nature de la modernité, technolâtre, productiviste, qui ne connaît plus rien que le toujours plus, de biens, de consommation, de déplacements frénétiques à travers la planète.
Cette Europe qui, dans un aveuglement sans salut, se trouve toujours sur le point de se poignarder elle-même est prise aujourd’hui dans un étau entre la Russie d’une part et l’Amérique de l’autre. La Russie et l’Amérique sont toutes deux, au point de vue métaphysique, la même chose : la même frénésie sinistre de la technique déchaînée, et de l’organisation sans racine de l’homme normalisé.
En un temps où le dernier petit coin du globe terrestre a été soumis à la domination de la technique, et est devenu exploitable économiquement, où toute occurrence qu’on voudra, est devenue accessible aussi vite qu’on voudra, et où l’on peut vivre simultanément un attentat contre un roi en France et un concert symphonique à Tokyo, lorsque le temps n’est plus que vitesse et simultanéité, et que le temps comme histoire a disparu du Dasein de tous les peuples, alors vraiment à une telle époque, la question : » Pour quel but, où allons-nous, et quoi ensuite ? » est toujours présente et, à la façon d’un spectre, traverse toute cette sorcellerie.
Il est une plaisante expression : ceci ou cela se démocratise ; ainsi ( liste non limitative ) les automobiles , les piscines , les téléphones portables , les voyages .
Tout ceci favorise la croissance mais s’ accompagne d’une baisse de la qualité : pour produire plus et à moindre coût , il faut souvent moins regarder à la dite qualité en accélérant les cadences de production , en baissant les niveaux de contrôle , en utilisant des éléments moins nobles ( matière plastique plaquée alu au lieu du métal par exemple j) , il faut aussi baisser la qualité du service ( le » libre service « devient la règle jusque dans les aéroports )
Cette démocratisation masque la médiocrité par des certifications lesquelles ne représentent rien qu’ d’autre qu’ une qualité minimum garantie . un » SMIG « des produits et services en quelque sorte .
Refuser ceci , passe pour du passéisme , de l’élitisme y compris auprés des tenants du libéral capitalisme ; c’est que l’on s’est rendu compte qu’il y avait plus à gagner à vendre du médiocre à la multitude que de l’ excellent à quelques favorisés .
Il sera difficile de » sortir de l’auberge «
Le mot croissance est devenu un totem, un fétiche, un gri-gri auquel chacun confie ses pensées secrètes. Son lustre quasi-scientifique, engourdissant l’esprit critique, confond des réalités diverses, engendre des envolées ridicules, occulte les projets politiques, pour citer quelques uns de ses « signifiés ».
Brièvement, donc
La croissance mesure le volume des échanges monétaires. Comparer les croissances du Rwanda et de la France n’a aucun sens. les deux pays sont à des niveaux de développement très éloignés, tant au niveau de la richesse globale que de l’abondance des échanges monétaires (comparés aux trocs en nature et à l’auto-consommation). Il s’y ajoute une composante démographique évidente. Il est donc logique que le Rwanda « croisse » beaucoup plus vite, de même qu’il est normal que le nourrisson croisse plus vite que le presqu’adulte. Et chez l’adulte, la croissance concernera souvent plus la ceinture de mauvaise graisse que la stature et la muscle.
Au chapitre des bêtises, je mettrai toutes ces formules journalistiques sur la croissance négative, l’accélération de la croissance ou son ralentissement (des dérivées secondes !) alors qu’il ne s’agit, en fait, que de parler de l’activité commerciale et industrielle. Cette croissance-là, c’est comme le tarmac des aéroports, un mot magique pour initiés : celui-qui dirait la piste ou le terrain d’aviation risque d’être classé parmi les populistes rétrogrades.
La croissance comme slogan politique, outre sa dangereuse myopie largement soulignée dans les réflexions écologique, comporte un tiroir sub-liminal : détourner les esprits de l’idée d’un partage, même raisonnable, même physiquement inévitable. Une idée voisine, plus bucolique, propose le « ruissellement ». Trop précise pourtant, cette dernière est chaque jour invalidée par la statistique.; La croissance c’est tellement plus vague et nettement plus « parlant ». Ça vous pose un guru !