
![]() Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?
Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?
 Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre.
Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre. ![]()
* Henri Massis – Wikipédia
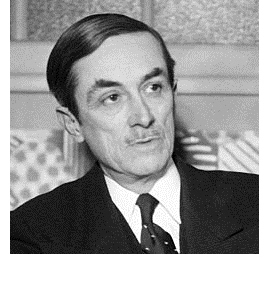 Une Antigone juive.
Une Antigone juive.
Rien de plus significatif à cet égard* que la rencontre de Georges Bernanos avec Simone Weil, cette Antigone juive.
 C’était au temps de la guerre d’Espagne. D’abord favorable à la cause de José Antonio — son fils Yves ne s’était-il pas battu clans les rangs phalangistes, quand les Rouges débarquèrent à Majorque ? — mais bouleversé ensuite par les horreurs de la guerre civile tout autant que par l’attitude du clergé de l’île, Bernanos fit alors monter, dans les Grands Cimetières sous la Lune, la protestation solitaire qui devait le classer parmi les ennemis de Franco.
C’était au temps de la guerre d’Espagne. D’abord favorable à la cause de José Antonio — son fils Yves ne s’était-il pas battu clans les rangs phalangistes, quand les Rouges débarquèrent à Majorque ? — mais bouleversé ensuite par les horreurs de la guerre civile tout autant que par l’attitude du clergé de l’île, Bernanos fit alors monter, dans les Grands Cimetières sous la Lune, la protestation solitaire qui devait le classer parmi les ennemis de Franco.
Simone Weil fut peut-être la seule à comprendre le sens d’un tel message, qui exprimait avec passion ce qu’elle-même avait ressenti de l’autre côté, du côté des Rouges, la même immense déception, la même soif enragée d’absolu. Comme elle lui ressemblait! Ce que Simone Weil espérait de la guerre d’Espagne, c’était la victoire de la justice et l’affranchissement des malheureux : elle ne s’était engagée dans le rang des Rouges que par devoir, y voyant une occasion de tout risquer pour son idéal.
 Animatrice plutôt que combattante, elle eut à cœur, nous disent ses amis, de ne jamais se servir de ses armes, et l’un d’eux nous rapportait naguère cette histoire admirable : un jour, l’un de ses camarades miliciens voulut qu’elle fît partie du peloton qui allait fusiller un condamné à mort. « Qu’a-t-il fait ? lui demanda Simone Weil. — Je n’en sais rien, répondit l’autre. mais c’est un curé, ça suffit. Simone Weil prit sur le champ le parti de se joindre à la petite troupe de miliciens commandés pour l’exécution, décidée qu’elle était à se mettre devant les fusils, à couvrir le prêtre de son corps. Ce sacrifice lui fut épargné, car le condamné avait pu s’enfuir avant qu’on ne l’exécutât…
Animatrice plutôt que combattante, elle eut à cœur, nous disent ses amis, de ne jamais se servir de ses armes, et l’un d’eux nous rapportait naguère cette histoire admirable : un jour, l’un de ses camarades miliciens voulut qu’elle fît partie du peloton qui allait fusiller un condamné à mort. « Qu’a-t-il fait ? lui demanda Simone Weil. — Je n’en sais rien, répondit l’autre. mais c’est un curé, ça suffit. Simone Weil prit sur le champ le parti de se joindre à la petite troupe de miliciens commandés pour l’exécution, décidée qu’elle était à se mettre devant les fusils, à couvrir le prêtre de son corps. Ce sacrifice lui fut épargné, car le condamné avait pu s’enfuir avant qu’on ne l’exécutât…
Quand Simone Weil parlait de ces événements de sa vie — mais elle n’en parlait guère — c’était pour rendre témoignage à tel ou tel de ses compagnons d’armes, mais pour déplorer l’évanouissement de, ses rêves. La lettre qu’elle écrivit alors à Bernanos est la confidence de cette immense déception : « J’ai rencontré, lui dit-elle, des Français paisibles que jusque-là je ne. méprisais pas, qui n’auraient pas eu l’idée d’aller eux-mêmes tuer, mais qui baignaient dans cette atmosphère baignée de sang avec un véritable plaisir. Pour ceux-là, je ne pourrai jamais à l’avenir avoir aucune estime. Une telle atmosphère efface aussitôt le but même de la lutte. Car on ne peut formuler le but qu’en le ramenant au bien public, au bien des hommes, et les hommes ici sont de nulle valeur. »
Et Simone Weil d’ajouter avec tristesse : « On part en volontaire, avec des idées de sacrifice, et on tombe dans une guerre de mercenaires, avec beaucoup de cruauté en plus et le sens des égards dus à l’humanité en moins. »
La voilà bien, cette Simone Weil, telle que Gustave Thibon nous l’a peinte. Prompte à mettre dans ses engagements politiques la passion qu’elle apportait à toute chose, mais loin de se faire une « idole » d’une idée, d’une nation ou d’une classe, Simone Weil savait « que le social est par excellence le domaine du relatif et du mal, et que, dans cet ordre, le devoir de l’âme
surnaturelle ne consiste pas à embrasser un parti, mais à essayer sans cesse de rétablir l’équilibre, en se portant du côté des vaincus et des opprimés ».
N’est-ce pas ce mouvement de l’âme qui la fit écrire à Georges Bernanos, s’ouvrir à cet homme dont ses « idées politiques » la séparaient, et lui dire sa « vive admiration »?
 « Depuis que j’ai été en Espagne, lui écrivit-elle ensuite, depuis que j’entends, que je lis toutes sortes de considérations sur l’Espagne, je ne puis citer personne hors vous seul, qui, à ma connaissance, ait baigné dans l’atmosphère de la guerre espagnole, et y ait résisté. Vous êtes royaliste, disciple de Drumont, que m’importe ? Vous m’êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d’Aragon — ces camarades que pourtant j’aimais. »
« Depuis que j’ai été en Espagne, lui écrivit-elle ensuite, depuis que j’entends, que je lis toutes sortes de considérations sur l’Espagne, je ne puis citer personne hors vous seul, qui, à ma connaissance, ait baigné dans l’atmosphère de la guerre espagnole, et y ait résisté. Vous êtes royaliste, disciple de Drumont, que m’importe ? Vous m’êtes plus proche, sans comparaison, que mes camarades des milices d’Aragon — ces camarades que pourtant j’aimais. »
Et bien qu’elle ne voulût point prolonger de telles confidences, Simone Weil ajoutait : « Ce que vous dites du nationalisme, de la guerre, de la politique extérieure française après la guerre, m’ est également allé au cœur, J’avais dix ans lors du traité de Versailles. Jusque-là, j’avais été patriote avec toute l’exaltation des enfants en période de guerre. La volonté d’humilier l’ennemi vaincu, qui déborda partout à ce moment (et dans les années qui suivirent), d’une manière si répugnante, me guérit une fois pour toutes de ce patriotisme naïf. Les humiliations infligées par mon pays sont plus douloureuses que celles qu’il peut subir. »
Ainsi Bernanos et Simone Weil s’étaient-ils fraternellement rejoints dans un même besoin de se ranger du côté des humiliés, des faibles, du peuple, des enfants. Ô terrible et divine passion ! Cette image-là, c’est celle que nous voudrions garder de Georges Bernanos. De lui, comme d’une Simone Weil, nul parti, aucune faction, aucune idéologie n’a le droit de se réclamer. Nul ne peut davantage les prendre comme des maîtres à penser ou des directeurs de conscience — ils ne l’auraient d’ailleurs pas voulu. Mais leur dialogue, lui, s’établit à la hauteur d’un ordre consacré.
 Comment, en effet, penser la justice sans rétablir un certain ordre, un ordre véritable, celui de ces « lois non écrites » qu’Antigone symbolise ? Antigone vierge et mère de l’ordre, c’est ainsi que Maurras nomme la sœur de Polynice — ce Maurras contre qui Bernanos croyait pointer, quand il disait : « je préfère le désordre qui s’avoue comme désordre au désordre qui se définit comme un ordre. » A penser révolution, Bernanos avait fini par ne plus entendre la parole de Maurras, sa plus profonde parole : « Non, enseigne tout Maurras, non, ce n’est pas Créon qui fait de l’ordre, qui a la passion de l’ordre… C’est Antigone» — car Maurras tient pour « impies » les paroles d’un chef qui prétend qu’ « il faut en exécuter tous les ordres, petits ou grands, justes ou non La justice n’est-elle pas l’un des principes et l’une des fins de son autorité ? « Voilà, nous dit Maurras, l’indiscipline et l’anarchie, et cela sous le couvert de l’Autorité et de l’Etat. Qui viole les conditions de l’homme, des dieux, de la cité, et qui les défie toutes ? Ce n’est pas Antigone, c’est Créon ; l’anarchiste, c’est lui. Ce n’est que lui... » Et c’est sur ces hauteurs divines que nous laisserons Bernanos et Maurras enfin unis, réconciliés… (FIN) ■
Comment, en effet, penser la justice sans rétablir un certain ordre, un ordre véritable, celui de ces « lois non écrites » qu’Antigone symbolise ? Antigone vierge et mère de l’ordre, c’est ainsi que Maurras nomme la sœur de Polynice — ce Maurras contre qui Bernanos croyait pointer, quand il disait : « je préfère le désordre qui s’avoue comme désordre au désordre qui se définit comme un ordre. » A penser révolution, Bernanos avait fini par ne plus entendre la parole de Maurras, sa plus profonde parole : « Non, enseigne tout Maurras, non, ce n’est pas Créon qui fait de l’ordre, qui a la passion de l’ordre… C’est Antigone» — car Maurras tient pour « impies » les paroles d’un chef qui prétend qu’ « il faut en exécuter tous les ordres, petits ou grands, justes ou non La justice n’est-elle pas l’un des principes et l’une des fins de son autorité ? « Voilà, nous dit Maurras, l’indiscipline et l’anarchie, et cela sous le couvert de l’Autorité et de l’Etat. Qui viole les conditions de l’homme, des dieux, de la cité, et qui les défie toutes ? Ce n’est pas Antigone, c’est Créon ; l’anarchiste, c’est lui. Ce n’est que lui... » Et c’est sur ces hauteurs divines que nous laisserons Bernanos et Maurras enfin unis, réconciliés… (FIN) ■












Ne pas oublier l’amitié profonde de Simone
Weil la philosophe et de Gustave
Thibon le royaliste ( admirateur de Maurras)
à l’opposé du parcours politique de Simone
Weil,mais qui se retrouvaient spirituellent !