
 C’est sur Sens critique – un site qui réunit plusieurs dizaines de milliers de lecteurs – qu’a été publié sous la signature d’Antrustion , ce bien intéressant avis sur livre de Guillaume Travers, Pourquoi tant d’inégalités ? récemment paru à la « Nouvelle librairie » de François Bousquet. Ce livre est lui-même comme une réponse aux analyses de Thomas Piketty (Photo ci-dessus) sur la question redevenue brûlante des inégalités. La réflexion d’Antrustion sur ce même sujet est intéressante en soi-même et il se trouve que nous en partageons largement le fond. Cet auteur a accepté avec plaisir u’elle soit éventuellement publiée sur un site maurrassien. C’est chose faite au bénéfice des lecteurs de Je Suis Français. et nous l’en remercions.
C’est sur Sens critique – un site qui réunit plusieurs dizaines de milliers de lecteurs – qu’a été publié sous la signature d’Antrustion , ce bien intéressant avis sur livre de Guillaume Travers, Pourquoi tant d’inégalités ? récemment paru à la « Nouvelle librairie » de François Bousquet. Ce livre est lui-même comme une réponse aux analyses de Thomas Piketty (Photo ci-dessus) sur la question redevenue brûlante des inégalités. La réflexion d’Antrustion sur ce même sujet est intéressante en soi-même et il se trouve que nous en partageons largement le fond. Cet auteur a accepté avec plaisir u’elle soit éventuellement publiée sur un site maurrassien. C’est chose faite au bénéfice des lecteurs de Je Suis Français. et nous l’en remercions. ![]()
 Un petit opuscule (une cinquantaine de pages) brillant qui, en répondant aux contresens historiques de l’économiste Thomas Piketty, tente de reposer le problème des inégalités économiques sur des bases neuves et plus assurées.
Un petit opuscule (une cinquantaine de pages) brillant qui, en répondant aux contresens historiques de l’économiste Thomas Piketty, tente de reposer le problème des inégalités économiques sur des bases neuves et plus assurées.
La notion d’inégalité, rappelle Guillaume Travers, est une notion moderne : là réside le fond du problème.
Les « inégalités » sont des distinctions quantitatives qui s’opposent aux « différences », qui sont avant tout qualitatives. « Si notre époque insiste considérablement sur la question des inégalités (monétaires), c’est parce que les différences (de fonction ou de statut, donc non monétaires) ont presque complètement disparu. » Dans une société organique traditionnelle, l’intérêt de la communauté prime sur celui des individus, qui sont hiérarchisés selon des différences de statut. « Nul n’est exclu : chacun a un statut protégé au sein de la hiérarchie sociale. » A contrario, dans une société moderne, le désir d’égalité et d’universalité conduit à vouloir supprimer les distinctions de statut : c’est le sens profond de l’abolition des privilèges du 4 août 1789. Mais, en conséquence, ce qui distingue les individus n’est plus mesurable que par des données quantitatives : les individus ne sont réduits qu’à des agents économiques motivés par leurs intérêts égoïstes et dont le marché devient le principal médiateur des liens sociaux. C’est paradoxalement l’égalitarisme libéral qui est à l’origine des inégalités et de l’exclusion.
Thomas Piketty commet une erreur historique fondamentale lorsqu’il perçoit la société d’ordres d’Ancien Régime comme « un schéma de justification de l’inégalité. » L’inégalité ni l’égalité ne sont le problème de telles sociétés ; l’organisation trifonctionnelle a au contraire pour but d’ordonner et de hiérarchiser le corps social de façon organique (chaque ordre est dépendant des deux autres) en tâchant de contenir l’importance des seuls intérêts économiques : le but poursuivi par une telle société est le bien commun, ce qui constitue encore un objectif qualitatif là où l’aspiration à l’enrichissement, dans les sociétés modernes, est quantitatif.
Aussi, l’essor de l’idéologie de la propriété privée n’est-elle pas la cause des inégalités à l’époque moderne ; il s’agit plutôt de la conséquence d’une redéfinition anthropologique plus profonde : l’anthropologie moderne est une anthropologie individualiste qui souhaite l’avènement d’un individu abstrait et auto-suffisant, c’est-à-dire déraciné de tout sentiment d’appartenance collective. En conséquence, on souhaite ne réduire la société qu’à un agrégats d’individus mus uniquement par leurs intérêts égoïstes, c’est-à-dire par rien d’autres qu’eux-mêmes. C’est cet idéal qui a motivé en premier lieu les réformes économiques de la Révolution française, notamment la suppression des corporations (loi Le Chapelier de 1792) ; c’est encore au nom de cette vision de l’homme, politiquement fondée sur l’idée de la volonté générale en France, que les syndicats seront longtemps restés interdits.
Or, le désir d’égalité abstraite et universelle poussant à la suppression des communautés d’appartenance, le marché croît à son tour, et ce de deux manières : d’une part en supprimant les limites politiques et géographiques du marché (droits de douane etc.) ; d’autre part en faisant entrer dans le domaine du marché des objets qui y échappaient auparavant (tout devient susceptible d’être commercialisable). Et c’est précisément cet accroissement de la taille du marché qui permet l’augmentation considérable des inégalités, ce que Guillaume Travers explique avec la notion de « superstar » prise chez Sherwin Rosen :
« Prenons un exemple simple. Un comédien de théâtre ne jouera jamais que pour quelques centaines de spectateurs, tandis qu’un acteur de cinéma joue potentiellement pour des centaines de millions de personnes : son « marché » est beaucoup plus large. Ainsi, de petits écarts de talent au théâtre ne causent pas d’inégalités considérables des salaires, tandis que les mêmes différences feront naître des inégalités considérables pour les acteurs de cinéma : les « superstars » sont richissimes.»
De là l’augmentation jamais vue des inégalités depuis une quarantaine d’années, inégalités qui ont encore explosé avec les nouvelles technologies, permettant la constitution de monopoles mondiaux sur à peu près tout (Amazon ou Google). Or, dans la période dite des Trente Glorieuses, les gouvernements ont su réduire l’accroissement des inégalités grâce à l’État providence, entretenant ainsi l’illusion que l’extension de l’économie de marché pouvait se faire indéfiniment sans conséquences sociales majeures. Mais l’État providence était condamné à disparaître sous l’effet de sa propre logique. Cette redistribution, en effet, suppose deux prérequis : d’une part la capacité de taxer les hauts revenus et d’autre part la volonté politique de pratiquer une telle redistribution. Or, la suppression des frontières ont rendu l’exil fiscal de plus en plus simple et, en conséquence, répandu, ce qui rend inopérante toute tentative de taxation des plus riches. Et le système de redistribution motive lui-même une immigration qui contribue à saper tout sentiment d’appartenance collective : en conséquence, les plus riches ne se sentant plus appartenir à la même société que les plus pauvres (ce sont des citoyens du monde, après tout) perdent toute volonté politique de redistribution, qui n’est plus pensée qu’en termes de « gouvernabilité. » D’un autre côté, l’immigration augmente la part des bénéficiaires de la redistribution par rapport à la population assujettie à l’impôt. En conséquence, le déficit public se creuse irrésistiblement, d’autant plus que le poids de l’impôt tend à ne plus être supporté que par la classe moyenne, c’est-à-dire les sédentaires, en raison de la défection des plus riches. C’est donc cette classe moyenne qui est victime des politiques destinées à « faire des économies. »
Mais finalement, quand bien même les inégalités s’accroissent-elles, « le mal-être contemporain se résume-t-il aux seules inégalités ? Faut-il placer la réduction des inégalités de revenus et de patrimoine au sommet des objectifs politiques à atteindre ? »
« (…) La vie n’est pas faite que de chiffres et d’argent. Avec l’essor de la modernité, la vie humaine a aussi subi des changements qualitatifs considérables, que la seule mesure des inégalités ne peut prendre en compte. Par exemple, si les économistes s’accordent à reconnaître que la révolution industrielle au XIXe siècle a fait monter les revenus monétaires, les historiens signalent qu’elle a néanmoins été perçue comme un traumatisme par une grande partie de la population ouvrière. Par exemple, Edward P. Thomson (…) a montré que la dislocation des communautés villageoises, le déracinement , la disparition des fêtes communautaires, des solidarités, des mécanismes de don et de contre-don, ont été un déchirement pour la population ouvrière anglaise. Les statistiques économiques masquent donc une part de la réalité : par nature, elles ne mesurent que ce qui est marchand, ce qui s’échange en espèces sonnantes et trébuchantes, et négligent tout le reste, ce qui a de la valeur mais n’a pas de prix. »
Guillaume Travers exprime ainsi son incompréhension pour la position de Thomas Piketty :
« À nouveau, Piketty est bien incapable de voir cela, puisqu’il reste prisonnier d’une logique essentiellement individualiste : toute tentative visant à réintroduire des éléments de vie communautaire, sur la base d’une vision spécifique du bien commun dépassant les seuls intérêts individuels, mènerait presque automatiquement à ses yeux à un dangereux « repli identitaire » ! En un sens, ce n’est pas totalement faux. Les identités communes ont été les principales victimes de processus de marchandisation, qui n’a laissé subsister que des individus déracinés. (…) Si Piketty se trompe, c’est parce que le retour des identités collectives ne constitue pas un « danger », mais le seul espoir tant pour réduire les inégalités que pour redonner sens et qualité à l’existence individuelle. »
Paradoxe logique, c’est bien le désir d’égalité qui est à l’origine des inégalités. C’est donc notre façon entière de penser l’homme, la société et l’économie qui est à refonder. Un petit essai, quoi qu’il en soit, qui rétablit une évidente clarté sur ces problèmes complexes. Une pensée originale qui regorge d’idées stimulantes pour bâtir l’avenir ; pour dépasser ce marasme intellectuel (réactionnaire ?) par trop attaché à l’universalisme du XVIIIe siècle. ■

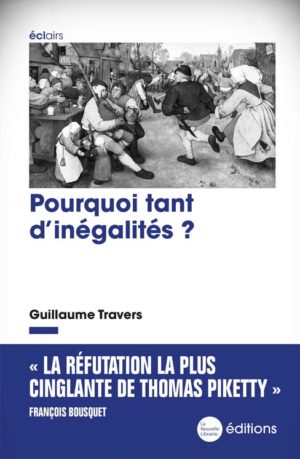












Au delà des précieux rappels et exemples exposés, l’auteur a tort prendre M. Piketty pour punching-ball. Il est quelque peu injuste de parler de ses erreurs quand celui-ci fonde son analyse sur la longue existence des sociétés communautaires ou organiques, la plupart plus ou moins trifonctionnelles, reconnaissant ainsi leur raison d’être et leur relative harmonie. Il ne fait qu’analyser les conditions de l’épuisement de leur ciment idéologique. Outre l’accumulation des dérives et abus, individuels ou collectifs, que ces sociétés échouaient à contenir, ce sont la force des appétits, l’évolution des esprits, notamment du fait de la diffusion du message chrétien par l’imprimerie, et les nouvelles possibilités techniques qui sont la cause de cet épuisement. L’épanouissement de l’idéologie « propriétariste » que Piketty voit après 1789 ne serait ainsi que le résultat de l’impuissance des contre-pouvoirs (de nature idéologiques eux-aussi) que les sociétés traditionnelles opposaient à l’individualisme débridé.
J’ai, à ce sujet, un vague souvenir de considération de Fustel de Coulanges sur les deux traditions idéologiques, romaine et germanique, relatives au droit de propriété. La première autorisant explicitement l' »abusus », la seconde le soumettant à des exigences de type utilité commune, comme Thomas d’Aquin d’ailleurs…
L’esclavage est un exemple paroxystique de société à assignation de fonctions et pourtant caricaturalement propriétariste. Sur sa disparition progressive, Piketty propose une analyse éclairante des contradictions et luttes idéologiques à l’oeuvre. De même, l’Inde reste aujourd’hui une société à ordres où l’égoisme de caste, quand il n’est pas tempéré par les religions minoritaires, tolère et justifie les misères les plus effarantes.
Les communautés villageoises, quant à elles, auraient probablement survécu à l’individualisme effréné si les machines agricoles et les productions industrielles n’avaient pas totalement privé de leur valeur des millions de travailleurs manuels et d’artisans.
Il est finalement injuste de prêter à Piketty une adhésion inconditionnelle à l’individualisme intégral quand l’objet principal de son travail est de reconstruire des solidarités compatibles avec la société d’aujourd’hui.