
Par François Schwerer.
![]() Il n’est ici question ni de religion ni de politique ou d’économie, mais d’histoire de la Marine française, en particulier dans le cours de la Grande Guerre. Il ne s’agit pas davantage d’une histoire exhaustive de la Marine française dans cette guerre, mais plutôt d’évocations de personnalités d’exception, d’épisodes, qui ont marqué le cours des événements. C’est-là un domaine malheureusement peu connu. D’où justement l’intérêt d’en traiter : pour nombre d’entre nous, ce sera une découverte. François Schwerer* a préparé et mis à jour, pour les lecteurs de Je Suis Français, une série de textes rédigés par ses soins. Nous les publions sous forme de suite, au fil des jours de cet été. Bonne lecture !
Il n’est ici question ni de religion ni de politique ou d’économie, mais d’histoire de la Marine française, en particulier dans le cours de la Grande Guerre. Il ne s’agit pas davantage d’une histoire exhaustive de la Marine française dans cette guerre, mais plutôt d’évocations de personnalités d’exception, d’épisodes, qui ont marqué le cours des événements. C’est-là un domaine malheureusement peu connu. D’où justement l’intérêt d’en traiter : pour nombre d’entre nous, ce sera une découverte. François Schwerer* a préparé et mis à jour, pour les lecteurs de Je Suis Français, une série de textes rédigés par ses soins. Nous les publions sous forme de suite, au fil des jours de cet été. Bonne lecture ! ![]()
C’est en effet en rade de Makung, qu’à bord du Bayard, le 11 juin 1885, l’amiral Courbet mourut « de travail excessif, d’écœurement aussi et de déception de toute sorte du résultat nul que ses belles victoires ont obtenu pour la France »[1].
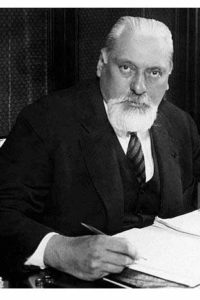 Claude Farrère, pour sa part, explique sobrement : « Il était souffrant depuis plus de deux ans, et se soignait peu… Il souffrait naturellement du foie, comme tous les marins fatigués par les longues campagnes dans des régions insalubres, et parmi des changements de température fréquents et brutaux »[2]. En fait, ces deux témoignages se complètent car, si l’amiral Courbet a véritablement été écœuré de la politique menée à Paris, et sa correspondance avec Jules Ferry en témoigne encore aujourd’hui, son délabrement physique était alors tout aussi réel. Au cours des semaines qui précédèrent son décès il avait fait plusieurs syncopes et les médecins de l’escadre l’avaient plusieurs fois pressé de rentrer en France.
Claude Farrère, pour sa part, explique sobrement : « Il était souffrant depuis plus de deux ans, et se soignait peu… Il souffrait naturellement du foie, comme tous les marins fatigués par les longues campagnes dans des régions insalubres, et parmi des changements de température fréquents et brutaux »[2]. En fait, ces deux témoignages se complètent car, si l’amiral Courbet a véritablement été écœuré de la politique menée à Paris, et sa correspondance avec Jules Ferry en témoigne encore aujourd’hui, son délabrement physique était alors tout aussi réel. Au cours des semaines qui précédèrent son décès il avait fait plusieurs syncopes et les médecins de l’escadre l’avaient plusieurs fois pressé de rentrer en France.
Mais Courbet n’avait jamais cru en la parole des Chinois et il ne voulait pas abandonner le théâtre des opérations tant que la paix n’aurait pas été signée. « Mon devoir est de rester ici, répétait-il. J’y resterai jusqu’au bout ». C’est cette attitude que son biographe, Jacques de La Faye résume en quelques mots éloquents : « Son devoir, telle est la règle inflexible de sa vie »[3].
Sa mort survint juste deux jours avant que n’arriva l’ordre d’évacuation conformément au traité de paix signé entre Paris et Pékin le 9 juin et dont l’article IX précise: « Dès que le présent traité aura été signé, les forces françaises recevront l’ordre de se retirer de Keelung ».
 Pierre Loti a laissé un témoignage émouvant de la façon dont fut ressentie la mort de cet homme de cœur : « Les gens qui sont en France ne peuvent guère comprendre ces choses, ni la consternation jetée par cette nouvelle, ni le prestige qu’il avait, cet amiral, sur son escadre. Dans les journaux, on lira des éloges de lui plus ou moins bien faits : on lui élèvera quelque part une statue ; on en parlera huit jours dans notre France oublieuse ; mais assurément on ne comprendra jamais tout ce que nous perdons en lui, nous, les marins. Je crois d’ailleurs que, pour sa mémoire, rien ne sera si glorieux que ce silence spontané et cet abattement de ses équipages »[4].
Pierre Loti a laissé un témoignage émouvant de la façon dont fut ressentie la mort de cet homme de cœur : « Les gens qui sont en France ne peuvent guère comprendre ces choses, ni la consternation jetée par cette nouvelle, ni le prestige qu’il avait, cet amiral, sur son escadre. Dans les journaux, on lira des éloges de lui plus ou moins bien faits : on lui élèvera quelque part une statue ; on en parlera huit jours dans notre France oublieuse ; mais assurément on ne comprendra jamais tout ce que nous perdons en lui, nous, les marins. Je crois d’ailleurs que, pour sa mémoire, rien ne sera si glorieux que ce silence spontané et cet abattement de ses équipages »[4].
Jacques de La Faye résume encore une fois l’essentiel : « Soins, attention, dévouement, il leur donnait tout, et les marins reconnaissants avaient pour lui un véritable fanatisme ». Et il ajoute un peu plus loin que ce chef bien aimé était aussi un « craignant Dieu », comme on disait alors. Il avait placé sa flotte et il s’était placé lui-même sous la protection de Sainte Anne d’Auray, « montrant partout et toujours l’union indissoluble qui existait dans son cœur entre Dieu et la Patrie, la religion et l’honneur »[5].
 Lors de la mise en terre du corps de l’amiral, dans le cimetière d’Abbeville, le 1er septembre 1885, Mgr Freppel, le célèbre évêque d’Angers, tint à rappeler quelques vérités essentielles. « Réduite à ses seules ressources, la société civile est impuissante à égaler la reconnaissance au mérite ; pour honorer ses morts, elle a beau multiplier les démonstrations publiques, faire appel aux splendeurs de l’éloquence et des arts, mettre un peuple entier en mouvement autour de leurs cendres, tant que la religion reste absente d’une solennité funèbre, il y manque ce qu’il y a de plus important et de plus auguste. Il y manque la prière, l’espérance chrétienne, le regard du côté de l’infini, les aspirations vers une destinée plus haute, tout ce qui emporte l’homme au-delà des horizons de la matière, et l’élève au-dessus des choses passagères de ce monde, pour marquer sa vie et ses œuvres du sceau de l’immortalité. La religion, sans laquelle toutes les pompes humaines ne sont qu’un vain spectacle, devait donc se rencontrer avec la patrie devant le cercueil du héros chrétien qui, dans tout le cours de sa vie et à son heure dernière, avait rendu à Dieu l’hommage de sa foi ». Puis, s’adressant aux personnalités d’Abbeville et à la population massée devant le cimetière, il ajouta : « Après l’honneur d’avoir donné le jour à celui dont nous pleurons la perte, il ne pouvait échoir à votre cité de plus grande faveur que de recevoir ses restes au milieu d’elle, pour les garder comme un dépôt précieux, auprès duquel les générations futures viendront apprendre comment on peut devenir un grand serviteur du pays sans cesser d’être un fils dévoué de l’Eglise, et par quel lien la religion et le patriotisme s’unissent dans une âme d’élite pour l’élever à la hauteur du héros chrétien ».
Lors de la mise en terre du corps de l’amiral, dans le cimetière d’Abbeville, le 1er septembre 1885, Mgr Freppel, le célèbre évêque d’Angers, tint à rappeler quelques vérités essentielles. « Réduite à ses seules ressources, la société civile est impuissante à égaler la reconnaissance au mérite ; pour honorer ses morts, elle a beau multiplier les démonstrations publiques, faire appel aux splendeurs de l’éloquence et des arts, mettre un peuple entier en mouvement autour de leurs cendres, tant que la religion reste absente d’une solennité funèbre, il y manque ce qu’il y a de plus important et de plus auguste. Il y manque la prière, l’espérance chrétienne, le regard du côté de l’infini, les aspirations vers une destinée plus haute, tout ce qui emporte l’homme au-delà des horizons de la matière, et l’élève au-dessus des choses passagères de ce monde, pour marquer sa vie et ses œuvres du sceau de l’immortalité. La religion, sans laquelle toutes les pompes humaines ne sont qu’un vain spectacle, devait donc se rencontrer avec la patrie devant le cercueil du héros chrétien qui, dans tout le cours de sa vie et à son heure dernière, avait rendu à Dieu l’hommage de sa foi ». Puis, s’adressant aux personnalités d’Abbeville et à la population massée devant le cimetière, il ajouta : « Après l’honneur d’avoir donné le jour à celui dont nous pleurons la perte, il ne pouvait échoir à votre cité de plus grande faveur que de recevoir ses restes au milieu d’elle, pour les garder comme un dépôt précieux, auprès duquel les générations futures viendront apprendre comment on peut devenir un grand serviteur du pays sans cesser d’être un fils dévoué de l’Eglise, et par quel lien la religion et le patriotisme s’unissent dans une âme d’élite pour l’élever à la hauteur du héros chrétien ».
Au cours de cette campagne de Chine, tous les jeunes officiers qui devinrent en 1914 les principaux amiraux de la Grande guerre, furent amenés à s’interroger sur la façon dont les hommes politiques dirigent notre pays ; sur la connaissance qu’ils ont de leurs dossiers et sur l’intérêt qu’ils portent aux hommes qu’ils envoient au feu. Si l’on en croit Claude Farrère, « Jules Ferry comprit à merveille la situation. Mais il n’essaya nullement de la faire apercevoir au pays. Nos défaites de 1870 étaient comme des œillères qui pointaient vers le Rhin toutes les vigilances et toutes les clairvoyances de la nation. Il eût fallu du courage pour persuader au pays qu’une expédition outre-mer grandissait notre force au lieu de la diminuer. Jules Ferry n’avait pas de courage. Il crut venir à bout de tout par des demi-mesures. Escamoter aux yeux du Parlement et de la nation toutes les difficultés gênantes, tel fut son plan »[6]. Mais, pour les marins français, qui étaient alors en première ligne, cette attitude de Jules Ferry ne pouvait pas leur donner une bonne opinion des hommes politiques, ni du régime qu’ils représentaient. D’autant que ce manque de courage se traduisait aussi en actes : les renforts envoyés en Orient furent très insuffisants ; le matériel était hétérogène et obsolète. Tout autre qu’un génie ne s’en serait jamais tiré. Mais, justement, Courbet a fait preuve de génie.
« Les opérations qu’il a préparées et dirigées lui-même ont toujours abouti à un succès. Des envieux pourront dire qu’il a eu simplement de la chance. En réalité il avait le talent dans tout ce qu’il préparait de ne laisser au hasard qu’une part infime sinon nulle »[7]. (À suivre, demain vendredi) ■
* Articles précédents …
■ Marine française : Amiral Pierre-Alexis Ronarc’h [1] [2] [3]
■ Marine française : Amiral Marie Jean Lucien Lacaze (1860 – 1955) [1] [2]
■ Marine française : En 1915, les canonnières fluviales aux Faux de Verzy
■ Marine française. En mer de Chine : à l’école de l’Amiral Courbet [1] [2] [3]













