
Par Pierre Debray.*
Cette étude reprise de Je Suis Français (1983) est une suite à paraître ici au fil des jours de la semaine sauf le week-end. Une fois opérés les correctifs contextuels qui découlent du changement d’époque, elle constitue selon nous une contribution magistrale à la réflexion historique, économique, sociale politique et stratégique de l’école d’Action Française. ![]()
Il.- Production de masse, société de consommation et capitalisme populaire.
Nous venons de vérifier la distinction qu’opère Maurras entre le capital et la finance.
Il défend le capital, puisqu’il constitue du travail épargné donc accumulé, au lieu d’être dépensé sur le moment. Plus le capital augmente et plus la société s’enrichit. La société (y compris ceux de ses membres qui ne possèdent personnellement aucun capital), et non pas le seul capitaliste, dispose du surplus de biens que permet l’accumulation des machines et des installations industrielles. Maurrassiens, nous osons l’affirmer hautement, alors que les libéraux et les démo-chrétiens le taisent ou, s’ils ne peuvent faire autrement, l’avouent à voix basse, comme un péché : nous sommes les défenseurs du capital, à l’exemple de notre maître. Nous luttons pour que l’Etat, par ses interventions, n’entrave pas son développement. Mais nous savons que l’argent, s’il est nécessaire comme instrument d’échanges, devient dangereux, dès l’instant qu’il règne en maître, asservissant les consciences et subordonnant le progrès technologique à la loi d’airain du taux d’intérêt. Il convient donc que les financiers soient tenus à leur place, utilisés, puisqu’ils se révèlent indispensables, mais limités à la fois par le pouvoir spirituel et par le pouvoir temporel, qui ne doivent d’aucune manière dépendre de lui. Par pouvoir spirituel, il faut d’ailleurs entendre l’Eglise, en tant qu’institution, et aussi l’intelligence, au sens maurrassien, c’est-à-dire les philosophes de la République platonicienne et les responsables de l’information.
D’Abraham à Jacquard
L’erreur des libéraux et des marxistes consiste à confondre, dans la pratique, sinon dans la théorie, le capitalisme industriel et le capitalisme financier. Ils n’apparaissent pas dans les mêmes conditions historiques. L’antiquité, même la plus haute, connaissait le capitalisme financier. Il y avait des banquiers en Mésopotamie, du temps d’Abraham, il y a quarante siècles, qui maîtrisaient le% techniques financières.
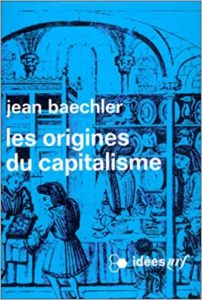 Mais l’antiquité ignorait le capitalisme industriel, qui est né en Europe occidentale vers le XIème siècle, ce que démontre dans un petit livre clair, d’une lecture aisée, qui est un chef d’œuvre d’empirisme organisateur, encore que son auteur sera le premier étonné de l’apprendre, Jean Baechler, dans les origines du capitalisme (chez Gallimard, dans la collection Idées). Je ne saurais trop en recommander la lecture à nos étudiants.
Mais l’antiquité ignorait le capitalisme industriel, qui est né en Europe occidentale vers le XIème siècle, ce que démontre dans un petit livre clair, d’une lecture aisée, qui est un chef d’œuvre d’empirisme organisateur, encore que son auteur sera le premier étonné de l’apprendre, Jean Baechler, dans les origines du capitalisme (chez Gallimard, dans la collection Idées). Je ne saurais trop en recommander la lecture à nos étudiants.
Bien plus, le capitalisme financier, s’il est nécessaire au développement du capitalisme industriel, tend à le stériliser. Nous en avons eu la preuve lors de la première révolution technologique, avec l’exemple génois qui vaut pour l’ensemble de l’Europe (décadence de la Hanse, transformation de Florence en place financière, etc…). Au XIXème siècle, la banque se désintéresse de l’industrie, drainant l’épargne au profit des emprunts d’Etat, n’intervenant dans le cas des chemins de fer que lorsque l’Etat (avec l’argent qu’elle lui prête) assume les frais et les risques, pour lui laisser les profits de l’exploitation des lignes rentables. D’où l’essoufflement de l’essor industriel et la stagnation économique des deux dernières décennies du XIXème siècle. Du point de vue de la physique sociale, il ne peut qu’en aller de même aujourd’hui.
 Nous avons vécu un prodigieux télescopage des révolutions technologiques. A la révolution du métier à tisser et de la machine à vapeur (le paléotechnique, selon la terminologie de Mumford) succède au début du XXème siècle, celle de l’électricité, du moteur à explosion et des télécommunications (le néotechnique).
Nous avons vécu un prodigieux télescopage des révolutions technologiques. A la révolution du métier à tisser et de la machine à vapeur (le paléotechnique, selon la terminologie de Mumford) succède au début du XXème siècle, celle de l’électricité, du moteur à explosion et des télécommunications (le néotechnique).
Cette succession nous a donné l’impression d’un progrès continu, donc destiné à se poursuivre indéfiniment. Rien de moins certain. Nous vivons sur la lancée. Les dernières inventions majeures datent soit de l’entre-deux guerres (la télévision) soit de la guerre (la fusée) et encore ne sont-elles que des améliorations ou des combinaisons de techniques plus anciennes. Quant à l’ordinateur, il découle de la machine à calculer de Pascal (1642). qui était demeurée une curiosité scientifique. La carte perforée était inventée par Jacquard, qui la créa, au début du XIXème siècle, pour son métier automatique. L’automation totale d’un processus industriel est plus ancienne encore : le baille-blé du XVème siècle qui réglait automatiquement l’alimentation en grains d’une meule. L’on peut dire de l’ordinateur et de l’automation qu’ils sont l’aboutissement d’une longue évolution technologique.
De nos jours, il n’existe qu’une seule piste qui pourrait conduire à une quatrième révolution industrielle, la biologie, avec l’espoir d’une somme inépuisable d’énergie, la photosynthèse. Il ne s’agit encore, en dépit des progrès du génie génétique, que d’une anticipation, qu’il ne serait pas sérieux de faire entrer en ligne de compte. Néanmoins, si les conditions politiques se trouvent réunies, il est hautement vraisemblable que le phénomène qui s’est produit au début du XXème siècle se reproduira au XXIème : une relance de l’innovation technologique, liée à l’esprit d’entreprise du capitalisme industriel.
Le seul problème reste de savoir si les recherches nécessaires ne deviendront pas si coûteuses qu’elles provoqueront la mainmise des financiers (banques ou Etats). Ce qui en interdirait, comme pour la machine à calculer de Pascal, l’exploitation industrielle ou en tous cas, la freinerait.
« Les années folles »
 En effet, les découvertes majeures du début du XXe siècle ont été l’œuvre d’inventeurs travaillant avec des moyens dérisoires (le laboratoire de Branly, à l’institut catholique de Paris) et d’artisans disposant, au départ, de faibles capitaux. L’exemple de Louis Renault est significatif. En 1899, il fonde sa société avec 60.000 francs or rassemblés en unissant ses économies avec celles de ses deux frères. Au départ, une famille de marchands de draps de la place des Victoires, des petits bourgeois, sans liens avec la haute finance. Un quart de siècle plus tard, Citroën, enrichi par les commandes d’armements, provoquées par la première guerre mondiale, le type même du munitionnaire, sera contraint de passer par les banques qui l’étrangleront en dépit de ses prodigieuses réussites de constructeur, tandis que Renault demeurera jusqu’au bout maître à 95 % de son capital. Il faudra pour l’abattre, que l’Etat le spolie après que les communistes l’ont battu à mort dans les prisons de la République. (À suivre, lundi 11janvier) ■
En effet, les découvertes majeures du début du XXe siècle ont été l’œuvre d’inventeurs travaillant avec des moyens dérisoires (le laboratoire de Branly, à l’institut catholique de Paris) et d’artisans disposant, au départ, de faibles capitaux. L’exemple de Louis Renault est significatif. En 1899, il fonde sa société avec 60.000 francs or rassemblés en unissant ses économies avec celles de ses deux frères. Au départ, une famille de marchands de draps de la place des Victoires, des petits bourgeois, sans liens avec la haute finance. Un quart de siècle plus tard, Citroën, enrichi par les commandes d’armements, provoquées par la première guerre mondiale, le type même du munitionnaire, sera contraint de passer par les banques qui l’étrangleront en dépit de ses prodigieuses réussites de constructeur, tandis que Renault demeurera jusqu’au bout maître à 95 % de son capital. Il faudra pour l’abattre, que l’Etat le spolie après que les communistes l’ont battu à mort dans les prisons de la République. (À suivre, lundi 11janvier) ■
* Je Suis Français, 1983
Lire aussi notre introduction à cette série…
© JSF – Peut être repris à condition de citer la source












