
Par Pierre Debray.*
Cette étude reprise de Je Suis Français (1983) est une suite à paraître ici au fil des jours de la semaine sauf le week-end. Une fois opérés les correctifs contextuels qui découlent du changement d’époque, elle constitue selon nous une contribution magistrale à la réflexion historique, économique, sociale politique et stratégique de l’école d’Action Française. ![]()
En économie, il ne faudrait comparer que des choses comparables, en renonçant à la superstition des mots.
Un chômeur qui retrouvera du travail au bout de trois mois ou un autre qui, après un an, n’en a pas trouvé, cela fait deux chômeurs dans les statistiques et pourtant il s’agit de phénomènes radicalement différents. Il en va de même pour le déficit budgétaire.
 Par contre, la politique du Front Populaire, en dépit des mesures heureuses (abolition de « l’abattement Laval » sur les traitements des fonctionnaires, dévaluation qui libère le franc des contraintes des parités fixes, programme de grands travaux, d’ailleurs trop timide) allait se révéler désastreuse. Le nombre de chômeurs est réduit de moitié entre 1935 et 1938 mais la production, dans le même temps, baisse de 20 % par rapport à 1929. Cela tient à ce que la lutte contre le chômage se fonde, non sur l’accroissement des forces productives mais sur le « partage du travail » (40 heures, congés payés).
Par contre, la politique du Front Populaire, en dépit des mesures heureuses (abolition de « l’abattement Laval » sur les traitements des fonctionnaires, dévaluation qui libère le franc des contraintes des parités fixes, programme de grands travaux, d’ailleurs trop timide) allait se révéler désastreuse. Le nombre de chômeurs est réduit de moitié entre 1935 et 1938 mais la production, dans le même temps, baisse de 20 % par rapport à 1929. Cela tient à ce que la lutte contre le chômage se fonde, non sur l’accroissement des forces productives mais sur le « partage du travail » (40 heures, congés payés).
 Ni Schacht, ni Morgenthau, maître d’œuvre du new deal n’avaient pu s’inspirer de la célèbre « general theory of employment, interest and money » de John Maynard Keynes, publiée seulement en 1936. Cependant, l’inspiration demeurait la même. Les uns – et les autres substituaient à une conception statique de l’économie, où les équilibres se rétablissaient automatiquement, une « description dynamique » selon l’expression de Keynes. Les classiques visaient en fait un état quasi stationnaire. Ce qui donnera, sous une forme journalistique, la « croissance zéro » préconisée par le club de Rome, croissance zéro de la production et de la démographie. Mais l’expérience montre assez qu’il n’y a jamais d’état quasi stationnaire. En économie, comme dans les autres domaines, qui n’avance pas recule.
Ni Schacht, ni Morgenthau, maître d’œuvre du new deal n’avaient pu s’inspirer de la célèbre « general theory of employment, interest and money » de John Maynard Keynes, publiée seulement en 1936. Cependant, l’inspiration demeurait la même. Les uns – et les autres substituaient à une conception statique de l’économie, où les équilibres se rétablissaient automatiquement, une « description dynamique » selon l’expression de Keynes. Les classiques visaient en fait un état quasi stationnaire. Ce qui donnera, sous une forme journalistique, la « croissance zéro » préconisée par le club de Rome, croissance zéro de la production et de la démographie. Mais l’expérience montre assez qu’il n’y a jamais d’état quasi stationnaire. En économie, comme dans les autres domaines, qui n’avance pas recule.
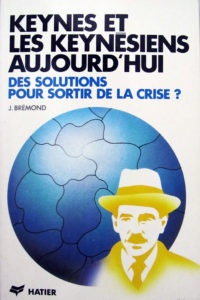 Nous ne discuterons pas les thèses de Keynes. Elles reposent sur ce qu’il nomme « la loi psychologique fondamentale » qui s’énonce ainsi : « lorsque le revenu croît, la consommation croît aussi mais dans une mesure moindre ». Ce qui n’est pas évident. Si les statistiques prouvent qu’effectivement l’épargne tend à augmenter avec le revenu, il faut tenir compte de la nature de ce revenu : plus l’individu est protégé socialement, plus la propension à épargner rejoint, quel que soit le revenu, la moyenne nationale. On voit, par cet exemple que Keynes reste prisonnier du « psychologisme » des classiques. Pas plus qu’eux, il ne situe l’économie dans son contexte historique et sociologique. Les socialistes viennent de nous en donner une illustration : en augmentant les salaires des « smicards » habitués à vivre au jour le jour, ils n’ont nullement stimulé leur propension à épargner mais bien au contraire ils ont provoqué des achats d’automobiles. ou de magnétoscopes pour le seul profit de nos fournisseurs étrangers.
Nous ne discuterons pas les thèses de Keynes. Elles reposent sur ce qu’il nomme « la loi psychologique fondamentale » qui s’énonce ainsi : « lorsque le revenu croît, la consommation croît aussi mais dans une mesure moindre ». Ce qui n’est pas évident. Si les statistiques prouvent qu’effectivement l’épargne tend à augmenter avec le revenu, il faut tenir compte de la nature de ce revenu : plus l’individu est protégé socialement, plus la propension à épargner rejoint, quel que soit le revenu, la moyenne nationale. On voit, par cet exemple que Keynes reste prisonnier du « psychologisme » des classiques. Pas plus qu’eux, il ne situe l’économie dans son contexte historique et sociologique. Les socialistes viennent de nous en donner une illustration : en augmentant les salaires des « smicards » habitués à vivre au jour le jour, ils n’ont nullement stimulé leur propension à épargner mais bien au contraire ils ont provoqué des achats d’automobiles. ou de magnétoscopes pour le seul profit de nos fournisseurs étrangers.
 Ceci dit, l’on attribue d’ordinaire à Keynes les erreurs imputables à Henri de Man et aux néosocialistes d’une part, dont nos socialistes actuels tiennent leur « volontarisme » économique et d’autre, part à Lord Beveridge, qui publiait, en 1944 « Full employement « in the free society » qui préconisait le walfare state, l’Etat Providence. Il s’agissait de libérer les individus des trois craintes : crainte de la maladie par le biais de la Sécurité Sociale, crainte de la misère par le salaire minimum garanti, crainte du chômage par des interventions de l’Etat destinées à stimuler la demande effective. Ainsi le pouvoir politique, par le biais de l’impôt ou de « charges sociales » procédait à une répartition des revenus, en faveur des plus défavorisés.
Ceci dit, l’on attribue d’ordinaire à Keynes les erreurs imputables à Henri de Man et aux néosocialistes d’une part, dont nos socialistes actuels tiennent leur « volontarisme » économique et d’autre, part à Lord Beveridge, qui publiait, en 1944 « Full employement « in the free society » qui préconisait le walfare state, l’Etat Providence. Il s’agissait de libérer les individus des trois craintes : crainte de la maladie par le biais de la Sécurité Sociale, crainte de la misère par le salaire minimum garanti, crainte du chômage par des interventions de l’Etat destinées à stimuler la demande effective. Ainsi le pouvoir politique, par le biais de l’impôt ou de « charges sociales » procédait à une répartition des revenus, en faveur des plus défavorisés.
 Sous une apparence philanthropique, Lord Beveridge raisonnait en cynique Les riches tendent à rechercher des produits de luxe. De ce fait, ils détournent une fraction importante des revenus de la consommation de masse. Il convient donc, si l’on veut stimuler l’industrie, de diriger les dépenses des ménages vers les biens de série. Mais surtout, l’individu qui craint pour son avenir met de l’argent de côté. Il thésaurise. Or Keynes a exposé, de façon irréfutable, qu’e l’épargne qui n’est pas investie (par exemple l’or qui se cache dans les bas de laine) constitue un facteur de déséquilibre. C’est de l’argent qui ne « travaille pas » et, quand il apparaît dans le circuit économique, il devient un facteur d’inflation. Il correspond, en effet, à une création de monnaie ex nihilo.
Sous une apparence philanthropique, Lord Beveridge raisonnait en cynique Les riches tendent à rechercher des produits de luxe. De ce fait, ils détournent une fraction importante des revenus de la consommation de masse. Il convient donc, si l’on veut stimuler l’industrie, de diriger les dépenses des ménages vers les biens de série. Mais surtout, l’individu qui craint pour son avenir met de l’argent de côté. Il thésaurise. Or Keynes a exposé, de façon irréfutable, qu’e l’épargne qui n’est pas investie (par exemple l’or qui se cache dans les bas de laine) constitue un facteur de déséquilibre. C’est de l’argent qui ne « travaille pas » et, quand il apparaît dans le circuit économique, il devient un facteur d’inflation. Il correspond, en effet, à une création de monnaie ex nihilo.
L’Etat va se munir d’un certain nombre d’indicateurs : comptabilité nationale, budget économique prévisionnel. A partir de là, il pourra jouer des deux menaces qui semblent s’annuler : l’inflation et le chômage. Il semblait démontrer, statistiquement, que plus l’inflation augmentait, plus le .chômage diminuait et réciproquement. Dans ces conditions, il suffisait de trouver un équilibre entre un taux d’inflation et un taux de chômage également tolérables en favorisant, selon la tendance, l’offre ou la demande, l’investissement ou la consommation. Mystérieusement, à partir de 1971, le mécanisme cessa de jouer.
Quoiqu’il en soit, nul ne peut contester que depuis la seconde guerre mondiale jusqu’au début des années 70, le système, dans l’ensemble, ait bien fonctionné. En un quart de siècle, il devait provoquer un enrichissement général, sans précédent dans l’histoire. Certes, le coût social de cette réussite fut excessif, perte du goût de l’effort, refus du risque, effondrement des mœurs, prolifération bureaucratique, mais ceux qui le déploraient passaient pour des rétrogrades, des prophètes de malheur, tant la société occidentale enorgueillie de ses pouvoirs s’imaginait maîtresse du destin.
 A quoi tenait cette évolution d’apparence irréversible ? Avant tout à l’augmentation constante des revenus qui permettait de prévoir, sans trop de risques, la consommation future, donc d’ajuster la production aux débouchés prévisibles. Une industrie qui doit programmer plusieurs années à l’avance ses investissements pouvait se développer, sauf erreurs de gestion ou de prévision, dans une relative sécurité. Avec plus ou moins de bonheur, les Etats contrôlaient assez bien le cours des choses même si, de temps à autre, ils commettaient des erreurs de conduite. Cependant, une fois de plus, le facteur financier allait détraquer la machine. Cette fois, ce ne fut pas, comme en 1929, la spéculation privée qui porta la responsabilité mais l’endettement croissant des entreprises et des Etats. (À suivre, demain jeudi) ■
A quoi tenait cette évolution d’apparence irréversible ? Avant tout à l’augmentation constante des revenus qui permettait de prévoir, sans trop de risques, la consommation future, donc d’ajuster la production aux débouchés prévisibles. Une industrie qui doit programmer plusieurs années à l’avance ses investissements pouvait se développer, sauf erreurs de gestion ou de prévision, dans une relative sécurité. Avec plus ou moins de bonheur, les Etats contrôlaient assez bien le cours des choses même si, de temps à autre, ils commettaient des erreurs de conduite. Cependant, une fois de plus, le facteur financier allait détraquer la machine. Cette fois, ce ne fut pas, comme en 1929, la spéculation privée qui porta la responsabilité mais l’endettement croissant des entreprises et des Etats. (À suivre, demain jeudi) ■
* Je Suis Français, 1983
Lire aussi notre introduction à cette série…
© JSF – Peut être repris à condition de citer la source












