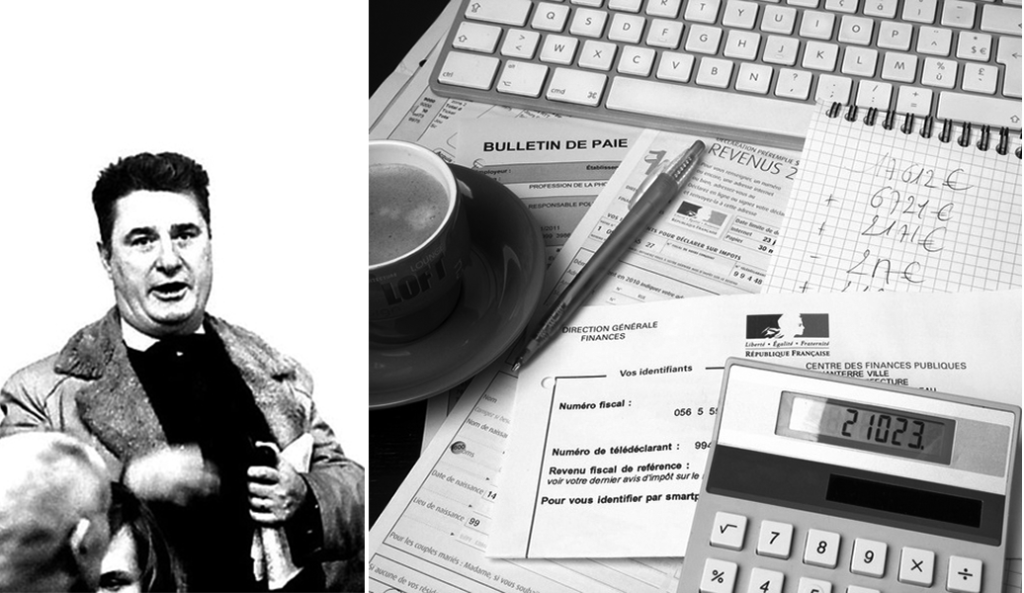
Par Pierre Debray.*
Cette nouvelle étude reprise de Je Suis Français (1983) est une suite publiée ici en feuilleton (février-mars 2021) et maintenant réunie en un document unique. Pour la formation et / ou la consultation de tous. Notamment, étudiants, universitaires et chercheurs, mais aussi lecteurs de JSF intéressés par le sujet. Un sujet plus actuel que jamais, alors que se profile la crise économique de grande ampleur dont chacun sait qu’elle suivra l’épisode pandémique. Une fois opérés les correctifs contextuels substantiels qui découlent du changement d’époque, et discerné ce qui est devenu – fût-ce provisoirement – obsolète, elle constitue une contribution utile à la réflexion historique, économique, sociale politique et stratégique de l’école d’Action Française. ![]()
I – En finir avec l’impôt sur le revenu
L’explication de la crise est simple : elle est financière, et si l’augmentation du prix du pétrole l’a déclenchée, si le désordre monétaire l’a aggravée, ils n’ont joué qu’un rôle secondaire -secondaire mais pas subalterne. L’accélération du progrès technique périme de plus en plus vite l’équipement industriel et par un processus dialectique, exige des investissements dans la recherche, toujours plus importants. Les peuples se sont habitués à une amélioration progressive de leur niveau de vie. Que celui-ci puisse stagner ou même diminuer leur semble intolérable. L’idéologie sécuritaire exige que l’existence humaine soit purgée du risque. Les socialistes ont bonne mine qui reprochent aux Français d’exiger d’être débarrassés des voleurs et des assassins par tous les moyens. Il est certain que la délinquance est bien moindre qu’il y a un siècle. Les statistiques n’y changeront rien. Il y a un siècle, il paraissait normal à un parisien qui se hasardait hors de chez lui, à pied, après la tombée de la nuit, de se faire détrousser. Tout aussi normal que de n’être pas protégé contre la maladie ou le chômage. L’idéologie sécuritaire a persuadé l’homme occidental qu’il devait ne plus craindre les aléas de l’existence. Il serait totalement pris en charge ! Comment admettrait-il qu’un malfrat force sa porte ? Si l’on ajoute que les dirigeants soviétiques, qui imposent à la population un niveau de vie de l’ordre de celui que nous avions en 1950 (ce n’est tout de même pas la misère), mènent à grand train la course aux armements et qu’il faut bien les suivre, l’on comprend que les Etats, les entreprises et les particuliers soient endettés jusqu’au cou.
Tout allait bien aussi longtemps que le coût de la dette restait inférieur à la rentabilité du capital de l’Etat, de l’entreprise ou du particulier. C’est ce que les économistes nomment l’effet de levier positif. Que le mouvement s’inverse et nous avons un effet de levier négatif. Ou bien l’on n’investit plus assez pour ne pas accroître le poids de la dette et la compétitivité s’affaiblit, la rentabilité du capital devient nulle, ou l’on continue de s’endetter jusqu’au jour où il faut, afin de payer les frais financiers (intérêts), obtenir de nouveaux prêts. Pour les entreprises c’est le dépôt de bilan, pour les Etats, la tutelle du fonds monétaire international (FM I). Mais quand toutes les entreprises et tous les Etats, ou presque, se retrouvent en rouge dans les comptes bancaires, cela risque de finir très mal. Le système financier, en dépit du partage des risques, menace ruine. Les bilans se chargent de créances que l’on dit « douteuses », encore qu’il n’y ait pas le moindre doute sur leur valeur. Les prêteurs passent du laxisme à l’avarice et pour emprunter il faut accepter des conditions draconiennes. Ce qui n’arrange rien.
L’inflation, qui est une épargne forcée dont le profit est transféré aux emprunteurs, comme l’avait constaté Keynes, constitue le détonateur de cette machine infernale. Quand l’inflation est de 10 %, le travailleur qui reçoit 5.000 F en valeur nominale ne dispose, en pouvoir d’achat que de 4.500 F. Qui récupère ces 500 F ? En fait, l’entreprise, à condition qu’elle se soit endettée. Chaque fois qu’elle remboursera 5000 F d’emprunt, cela correspondra à 5.500 F. de son chiffre d’affaires, gonflé artificiellement par l’inflation. Ce travailleur aura perdu 500 F. et l’entreprise en aura gagné exactement autant. Certes, ce n’est pas à lui qu’elle l’a pris mais à son créancier. Pourtant, si l’on observe l’ensemble du circuit des échanges, le résultat est le même. Certes un ajustement se produit, les salaires augmenteront de 10 % au bout d’un certain temps. Quant aux créanciers, ils ne continueront à prêter de l’argent. que s’ils obtiennent (mais cela ne vaut pas que pour l’avenir) un taux d’intérêt qui dépasse le taux d’inflation.
N’empêche qu’il y a eu pendant un temps plus ou moins long une épargne forcée dont bénéficient industriels et commerçants. Les salariés et les banquiers ne sont pas stupides. Ils savent qu’ils sont victimes de l’inflation. Comment s’en prémunir ? En anticipant. Les salariés chercheront à obtenir, dès le 1er janvier, des augmentations correspondant au maintien du pouvoir d’achat pendant six mois ou un an, si bien que leur pouvoir d’achat n’aura pas été seulement maintenu mais qu’il se sera accru, . encore que cet accroissement diminue avec le temps. Même chose pour les prêteurs. L’inflation ne joue plus son rôle d’épargne forcée. Elle devient un facteur de désinvestissement, les salaires et les frais financiers augmentant plus vite que les prix.
 Ce raisonnement paraîtra aux doctes trop simpliste et aux autres un peu compliqué. Mais dans la pratique, les choses se passent bien ainsi. On comprend maintenant pourquoi la règle qui voulait qu’à une hausse du chômage corresponde une baisse de l’inflation, ne joue plus. Nous avons à la fois une hausse du chômage et de l’inflation. Le débat qui consiste à se demander s’il faut accorder la priorité à la lutte contre l’un ou contre l’autre n’a aucun sens. Une infection qui provoque de la fièvre et des boutons ne peut être soignée qu’en s’attaquant à la cause du mal et celle-ci, on commence à s’en apercevoir, est l’endettement excessif des Etats et des entreprises.
Ce raisonnement paraîtra aux doctes trop simpliste et aux autres un peu compliqué. Mais dans la pratique, les choses se passent bien ainsi. On comprend maintenant pourquoi la règle qui voulait qu’à une hausse du chômage corresponde une baisse de l’inflation, ne joue plus. Nous avons à la fois une hausse du chômage et de l’inflation. Le débat qui consiste à se demander s’il faut accorder la priorité à la lutte contre l’un ou contre l’autre n’a aucun sens. Une infection qui provoque de la fièvre et des boutons ne peut être soignée qu’en s’attaquant à la cause du mal et celle-ci, on commence à s’en apercevoir, est l’endettement excessif des Etats et des entreprises.
Pour les entreprises, il faut rétablir à un haut niveau la marge brute d’autofinancement qui représentait en 1973 16,9 % de la valeur ajoutée et est tombée à 10,6 % en 1981 et à 9,6 % en 1982. Cela ne sera possible qu’en restituant aux fonds propres (c’est-à-dire aux ressources financières que l’entreprise dégage, grâce au profit) un taux de rentabilité supérieur à celui de l’inflation. Or en 1981, il n’était que de 5,1 % contre 12 %, en 1973. Il faut stopper une hémorragie qui détruit la substance de notre industrie.
Même si le plan Delors ramenait l’inflation à 8 %, la rentabilité des fonds propres sera inférieure, selon les prévisions, à 5 % et sans doute voisine de 4 %. Dans le meilleur des cas, la perte serait de 3 %. D’où l’angoisse de M. Gattaz, qu’il ne peut faire partager à la grande masse des Français qui ne connaissent que deux indicateurs, d’ailleurs truqués, l’évolution du chômage et l’inflation.
Il faut diminuer les charges des entreprises mais cela ne suffit pas. Il faut aussi maintenir le niveau de leur production. en privilégiant les exportations par rapport à la consommation intérieure. Ce n’est pas ce qui se passe. Nos exportations restent quasi stationnaires (+ 0,5 % en juin) tandis que la consommation intérieure ne diminue que lentement. Certes le plan Delors va la faire baisser et la balance du commerce extérieur s’améliorera, comme toujours en période de récession puisque notre industrie produisant moins achètera moins de matières premières. Nous sommes au rouet. Certes, les Français vivent au-dessus de leurs moyens mais une baisse brutale du niveau de vie risque de provoquer des secousses révolutionnaires d’autant plus violentes. qu’elle entraînerait une hausse du chômage et des faillites, insupportable (l’exemple du Chili est instructif). Et de surcroît, elle diminuerait encore la rentabilité des fonds propres des entreprises, donc irait à l’encontre du ‘out poursuivi. On peut s’attaquer à la Sécurité Sociale, en limitant impitoyablement les prestations, sans que les effets pervers soient trop graves (sauf pour les professions de :a santé et les industries pharmaceutiques qui seraient touchées de plein fouet) mais la réaction des syndicats serait dure et finalement il ne s’agirait que d’un palliatif.
D’où la nécessité d’en finir avec les « remèdes de cheval » qui laissent le patient si affaibli qu’il ne s’en remet pas. Nous n’en sortirons que par des réformes radicales : réforme de notre système fiscal, réforme de la Sécurité Sociale, réforme du système scolaire. II convient d’en exposer le principe.
LA RÉFORME
FISCALE
 Reggan l’a compris : l’impôt sur le revenu est archaïque, inadapté et dangereux. Il convient de le réduire progressivement afin d’arriver, dans des délais raisonnables, à sa disparition. Il frappe indistinctement :e revenu sans tenir compte de son emploi. D’où son caractère brutal. indifférencié, qui en fait un mauvais instrument. M. Delors l’augmente dans l’espoir de réduire la consommation mais nul n’ignore qu’une proportion de Français, plus ou moins grande, puisera dans son épargne. Ce qui réduira d’autant l’investissement. L’impôt sur le revenu frappe d’ailleurs indistinctement : la cigale et la fourmi. Celui qui dépense tout ce qu’il gagne et celui qui met de l’argent de côté.
Reggan l’a compris : l’impôt sur le revenu est archaïque, inadapté et dangereux. Il convient de le réduire progressivement afin d’arriver, dans des délais raisonnables, à sa disparition. Il frappe indistinctement :e revenu sans tenir compte de son emploi. D’où son caractère brutal. indifférencié, qui en fait un mauvais instrument. M. Delors l’augmente dans l’espoir de réduire la consommation mais nul n’ignore qu’une proportion de Français, plus ou moins grande, puisera dans son épargne. Ce qui réduira d’autant l’investissement. L’impôt sur le revenu frappe d’ailleurs indistinctement : la cigale et la fourmi. Celui qui dépense tout ce qu’il gagne et celui qui met de l’argent de côté.
 Laissons les Français maitres d’employer leur revenu comme bon leur semble. Que vont-ils faire de leur argent ? Deux parts, l’une pour consommer, l’autre pour épargner à court, moyen ou long terme. L’impôt sera donc prélevé après que chaque ménage aura fait cette répartition et non avant, comme c’est maintenant le cas. Il le sera sur la consommation et sur le capital, fruit de l’épargne d’une ou de plusieurs générations. Un tel système, nous allons le constater, a l’avantage de permettre à l’Etat d’orienter l’économie en modulant, selon les objectifs qu’il se fixe, les taux d’imposition, et ce en respectant la liberté des ménages.
Laissons les Français maitres d’employer leur revenu comme bon leur semble. Que vont-ils faire de leur argent ? Deux parts, l’une pour consommer, l’autre pour épargner à court, moyen ou long terme. L’impôt sera donc prélevé après que chaque ménage aura fait cette répartition et non avant, comme c’est maintenant le cas. Il le sera sur la consommation et sur le capital, fruit de l’épargne d’une ou de plusieurs générations. Un tel système, nous allons le constater, a l’avantage de permettre à l’Etat d’orienter l’économie en modulant, selon les objectifs qu’il se fixe, les taux d’imposition, et ce en respectant la liberté des ménages.
a) – L’impôt sur la consommation
C’est, bien sûr la T.V.A., impôt indolore entré dans les mœurs mais qui déplaît à la gauche. Elle le prétend injuste. Il peut l’être s’il est mal utilisé. Tout dépend des taux, qui doivent être faible pour les produits de première nécessité, plus élevé pour le superflu devenu indispensable (les désirs que la publicité a transformés en besoins) et considérable sur les désirs qui ne sont pas encore perçus comme des besoins (le magnétoscope par exemple), du moins pour le plus grand nombre. Un autre critère doit être retenu : la T.V.A. sera plus forte pour les produits que nous ne fabriquons pas (les appareils photos) que sur ceux que nous ne produisons qu’en quantité insuffisante (les automobiles) et relativement faibles dans les secteurs où nous produisons à des prix compétitifs suffisamment pour répondre à la demande du marché intérieur. Ce qui entraînerait sans doute certaines « injustices ». La T.V.A., bien utilisée frapperait plus fortement certains articles textiles à bon marché, fabriqués en Asie, que la haute couture. Mais dans l’ensemble, rien n’empêche qu’une majoration, même sensible, de cet impôt épargne, dans une large mesure, les bas revenus, non imposables. De légères augmentations des salaires compenseraient la hausse inévitable des prix.
 Bien entendu, l’augmentation de la T. V.A. devrait s’accompagner de la réforme de la Sécurité Sociale, si bien que la hausse des prix sur le plan intérieur ne serait que faiblement répercutée à l’exportation. La T.V.A. frappe aussi bien les produits que nous fabriquons que ceux que nous importons et, comme je l’ai montré, l’augmentation devrait peser surtout sur les importations. Nous pourrions réduire les achats de magnétoscopes japonais où les voyages organisés à l’étranger par des taux prohibitifs, sans nous rendre odieux ou ridicules. Il est normal que quelqu’un qui souhaite acheter un magnétoscope ou s’offrir ses vacances à l’étranger, choses dont il pourrait parfaitement se passer, soit astreint à l’impôt somptuaire, de tradition dans nos pays. De toute façon, il conviendrait de prévoir une transition assez douce : la T.V.A. augmentant et l’impôt sur le revenu diminuant progressivement.
Bien entendu, l’augmentation de la T. V.A. devrait s’accompagner de la réforme de la Sécurité Sociale, si bien que la hausse des prix sur le plan intérieur ne serait que faiblement répercutée à l’exportation. La T.V.A. frappe aussi bien les produits que nous fabriquons que ceux que nous importons et, comme je l’ai montré, l’augmentation devrait peser surtout sur les importations. Nous pourrions réduire les achats de magnétoscopes japonais où les voyages organisés à l’étranger par des taux prohibitifs, sans nous rendre odieux ou ridicules. Il est normal que quelqu’un qui souhaite acheter un magnétoscope ou s’offrir ses vacances à l’étranger, choses dont il pourrait parfaitement se passer, soit astreint à l’impôt somptuaire, de tradition dans nos pays. De toute façon, il conviendrait de prévoir une transition assez douce : la T.V.A. augmentant et l’impôt sur le revenu diminuant progressivement.
b) – L’impôt sur le capital
Il est évident que la disparition de l’impôt sur le revenu, même si elle s’opère sur plusieurs années, apparaîtrait comme un « cadeau aux riches » si elle ne s’accompagnait pas d’un impôt sur la capital. En fait celui-ci existe, mais sous des camouflages : l’impôt sur les plus-values fiscales institué par Giscard et l’impôt socialiste sur les grandes fortunes. Mais ce sont de mauvais impôts puisque non sélectifs (les plus-values) ou antiéconomiques (l’impôt sur les grandes fortunes qui favorise la spéculation sur les œuvres d’art, les forêts ou le vin). H convient de se défier des concepts vagues, imprécis. Par capital, on entend d’ordinaire la fortune accumulée sans se préoccuper de son origine, de sa nature et de son usage. Certes la fiscalité ne peut être rétroactive. La fortune d’un Giscard provient du pillage de l’Etat opéré impunément par trois générations. Mais il y a prescription. Par contre, on peut empêcher, à l’avenir, ce pillage. On y parviendra en distinguant le capital investi dans l’outil de travail qui doit être protégé, le capital spéculatif et l’épargne familiale. Le capital spéculatif lui-même n’est pas nécessairement condamnable. Un monsieur qui prend des actions dans une entreprise à hauts risques (par exemple, la fabrication d’un produit nouveau dans un secteur de pointe) gagnera beaucoup d’argent si l’affaire réussit. Le fisc ne saurait le traiter de la même manière que celui qui joue contre le franc. Il importe de tenir compte également de l’utilisation des revenus du capital. Réinvestis ou placés ils sont utiles au pays. Gaspillés en dépenses, ils deviennent une offense faite aux pauvres. Donc, l’impôt sur le capital sera complexe afin de s’adapter aux situations. Cet inconvénient inévitable — tout impôt simple se révèle injuste et surtout développe des effets pervers — en fera l’instrument d’une politique économique souple.
 Les capitalistes resteront libres de spéculer ou d’exploiter des rentes de situation, mais ils seront plus lourdement imposés que ceux qui créeront de la richesse. De ce point de vue, l’impôt ne doit pas épargner l’outil de travail mais si le patron utilise ses bénéfices pour mener la dolce vita, il sera plus durement touché que s’il modernise ses équipements. L’investissement productif donnerait droit à un crédit d’impôt par exemple.
Les capitalistes resteront libres de spéculer ou d’exploiter des rentes de situation, mais ils seront plus lourdement imposés que ceux qui créeront de la richesse. De ce point de vue, l’impôt ne doit pas épargner l’outil de travail mais si le patron utilise ses bénéfices pour mener la dolce vita, il sera plus durement touché que s’il modernise ses équipements. L’investissement productif donnerait droit à un crédit d’impôt par exemple.
L’impôt sur le capital présente, en outre, l’avantage de supprimer l’impôt sur les successions, qu’il engloberait, pour autant que le capital déclaré ne soit pas inférieur à l’évaluation lors de la liquidation de la succession, mais alors il s’agirait d’un simple redressement. Si l’on ajoute qu’il limiterait l’inquisition fiscale et permettrait d’instituer le secret bancaire, comme en Suisse, puisqu’en définitive la transparence des patrimoines s’établit plus facilement que celle des revenus, l’on s’explique mal la répugnance des Français à admettre l’impôt sur le capital.
 Sans doute reste-t-il le méchant souvenir des campagnes de Caillaux qui lui conserve un petit côté démagogique, assez déplaisant. En le liant à l’abolition des droits de succession, du moins en ligne directe, et à la reconnaissance du secret bancaire, on réduirait les obstacles psychologiques. En tout cas, il est nécessaire de repenser notre fiscalité si l’on veut en faire un outil efficace de régulation de la consommation et du capital. La France ne doit pas conserver un impôt sur le revenu, de type révolutionnaire, puisqu’il se veut égalitaire, s’appliquant uniformément à tous les citoyens, selon des barèmes arbitraires. Il faut une fiscalité résolument sélective qui favorise les formes de consommation et d’enrichissement les plus favorables au bien public. Si nos lecteurs ont mieux à proposer, le débat reste ouvert.
Sans doute reste-t-il le méchant souvenir des campagnes de Caillaux qui lui conserve un petit côté démagogique, assez déplaisant. En le liant à l’abolition des droits de succession, du moins en ligne directe, et à la reconnaissance du secret bancaire, on réduirait les obstacles psychologiques. En tout cas, il est nécessaire de repenser notre fiscalité si l’on veut en faire un outil efficace de régulation de la consommation et du capital. La France ne doit pas conserver un impôt sur le revenu, de type révolutionnaire, puisqu’il se veut égalitaire, s’appliquant uniformément à tous les citoyens, selon des barèmes arbitraires. Il faut une fiscalité résolument sélective qui favorise les formes de consommation et d’enrichissement les plus favorables au bien public. Si nos lecteurs ont mieux à proposer, le débat reste ouvert.
II – ALLEGEONS LE BUDGET SOCIAL
 Pendant des années nous avons été seuls à l’écrire.
Pendant des années nous avons été seuls à l’écrire.
Maintenant même le C.N.P.F. le reconnaît. Le septennat de Giscard fut un désastre économique. Pour ne pas chagriner les électeurs, pour ne pas mécontenter le syndicats, le pouvoir giscardien laissa le niveau de vie des Français grimper allègrement, faisant supporter aux entreprises les deux chocs pétroliers. Accablées de charges, contraintes de s’endetter, elles n’ont pu investir. La France va-t-elle manquer la grande mutation technologique qui s’accélère ? Si la politique d’austérité, imposée par Delors, parce qu’il se trouvait le dos au mur, avait été engagée dès 1974, notre pays aurait sans doute réalisé les prévisions des futurologues de l’Hudson Institute qui, en 1973, annonçaient que nous serions, en 1985, le moteur de l’économie mondiale. Les futurologues, malheureusement, ne font pas entrer le facteur politique dans leurs calculs. Ce qui n’empêche pas Giscard et ses complices Barre et Chirac, de parader sur les estrades, en reprochant aux socialistes une incompétence dont ils ont donné l’exemple.
M. Mitterrand déplore de ne pas avoir dévalué dès le 25 mai 1981. S’il avait appliqué, à l’époque, les mesures de rigueur qu’il prend aujourd’hui, nous commencerions de voir « le bout du tunnel » que Giscard nous promettait pour 1975. Une chose est sûre, la France va manquer le rendez-vous de la relance, sans doute précaire, que propose à l’Occident l’économie américaine. De nouveau, la France est « l’homme malade » de l’Europe. Il faudra pour opérer un redressement durable des mesures autrement radicales que celles, toutes conjoncturelles, que propose Delors. Répétons-le, rabâchons le même, selon le conseil de Maurras : la crise que nous traversons est financière. Pour réaliser la mutation technologique, il faut de l’argent, énormément d’argent. Afin d’investir, nous devons dégager des centaines de milliards. Ce n’est pas la « purge » qu’administre M. Delors qui les fournira. Au mieux, elle évitera la faillite mais au prix d’une récession d’autant plus longue que le pouvoir socialiste n’osera pas accepter les trois millions de chômeurs que suppose la réussite du plan Delors.
D’où la nécessité, si l’on veut se donner les moyens d’investir, de dégager les capitaux nécessaires à la modernisation de notre appareil de production, sans recourir à l’emprunt, qui grève les entreprises de frais financiers, avec pour conséquence obligée de réduire la marge de profit. L’Etat n’a pas à aider les entreprises, comme il le fait depuis trop longtemps par un système d’aides. de prêts bonifiés ou d’interventions directes par l’intermédiaire de l’ID1 ou de la DATAR ; ce qui a l’inconvénient de distribuer l’argent des contribuables selon le bon plaisir de technocrates au terme de procédures lentes, complexes et coûteuses. En dehors de cas de force majeure, des inondations par exemple, pas un centime ne devrait être détourné au profit d’entreprises ou de catégories socio-professionnelles, si respectables et méritantes soient-elles. Tout ce que l’Etat peut faire, c’est de leur donner leurs chances, en leur permettant de trouver sur le marché ‘des capitaux les fonds dont elles ont besoin et en allégeant leurs charges.
La disparition d’impôts anachroniques, comme l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les successions en ligne directe doit s’accompagner du remplacement de l’impôt sur les bénéfices qui pénalise les entreprises les plus utiles à la société, celles qui réalisent des profits, par un impôt sur le chiffre d’affaires qui, outre qu’il serait anti-inflationniste, permettrait un contrôle plus aisé. Il faut absolument libérer les Français du terrorisme fiscal, par des impôts simples ; c’est la seule manière de limiter la fraude et l’é\ asion de› capitaux.
De ce point de vue, il conviendrait d’instituer le secret bancaire et même d’autoriser, du moins pour les non-résidents, l’ouverture de comptes numérotés. Sans doute faudrait-il même inscrire le secret bancaire dans la constitution, afin de restaurer la confiance. Autant il est normal que l’Etat évalue la richesse des citoyens ou le chiffre d’affaires des entreprises, autant il est intolérable qu’il se livre à l’inquisition fiscale, avec pour seul résultat d’engraisser d’argent français les Suisses, les Luxembourgeois et quelques îliens d’Amérique latine. Certes, il y aura toujours des fraudeurs. N’ayant plus d’excuses, ils devront être, comme aux Etats-Unis, châtiés durement. Le bagne à perpétuité pour les plus coupables constituerait une excellente arme de dissuasion.
Solidarité et assurances
Si la réforme de la fiscalité est une condition nécessaire de la modernisation de l’appareil de production, ce n’est pas une condition suffisante. La réorganisation du budget social de la nation s’impose d’autant plus qu’il augmente beaucoup plus vite que le P.N.B. Au train où vont les choses, son poids écrasera l’économie française, en dépit des mesures d’économie, d’ordinaire d’une efficacité médiocre puisqu’elles restent, elles aussi, conjoncturelles. Il faut s’attaquer aux structures.
 Tout le système repose, en effet, sur une imposture, « la part patronale » dont le C.N.P.F. porte la responsabilité. Il l’a inventée pour s’assurer, avec la complicité de F.O. (qui en a tiré de juteuses prébendes) le contrôle des caisses. La notion de « part patronale » arrange d’ailleurs tout le monde, puisqu’elle permet de faire croire aux salariés que c’est, pour l’essentiel, le patron qui paie. En réalité, les cotisations que verse l’entreprise entrent dans la masse salariale. Qu’elles soient versées à la Sécurité Sociale et non au salarié n’y change rien. Une fois cette fiction abolie, celui-ci découvrirait que lorsqu’il touche 5.000 F, il coûte 7.500 F à l’entreprise. Qu’on l’oblige à déposer lui-même ces 2,500 F chez. le percepteur favoriserait les prises de conscience. La transformation progressive de l’entrepreneur en percepteur supplétif (et non rémunéré) est une erreur. Sauf pour la T.V.A., le prélèvement à la source devrait se faire au niveau du compte, postal ou bancaire, du salarié. Celui-ci doit savoir ce que lui coûte l’Etat.
Tout le système repose, en effet, sur une imposture, « la part patronale » dont le C.N.P.F. porte la responsabilité. Il l’a inventée pour s’assurer, avec la complicité de F.O. (qui en a tiré de juteuses prébendes) le contrôle des caisses. La notion de « part patronale » arrange d’ailleurs tout le monde, puisqu’elle permet de faire croire aux salariés que c’est, pour l’essentiel, le patron qui paie. En réalité, les cotisations que verse l’entreprise entrent dans la masse salariale. Qu’elles soient versées à la Sécurité Sociale et non au salarié n’y change rien. Une fois cette fiction abolie, celui-ci découvrirait que lorsqu’il touche 5.000 F, il coûte 7.500 F à l’entreprise. Qu’on l’oblige à déposer lui-même ces 2,500 F chez. le percepteur favoriserait les prises de conscience. La transformation progressive de l’entrepreneur en percepteur supplétif (et non rémunéré) est une erreur. Sauf pour la T.V.A., le prélèvement à la source devrait se faire au niveau du compte, postal ou bancaire, du salarié. Celui-ci doit savoir ce que lui coûte l’Etat.
Etrange démocratie qui n’ose pas informer les citoyens du montant réel de leurs contributions !
 L’on ne rendra transparent le budget social qu’en distinguant solidarité et assurances. Les allocations familiales relèvent de la seule solidarité. Les accidents du travail des seules assurances, l’entreprise les prenant en charge.
L’on ne rendra transparent le budget social qu’en distinguant solidarité et assurances. Les allocations familiales relèvent de la seule solidarité. Les accidents du travail des seules assurances, l’entreprise les prenant en charge.
Tout le reste se divise. Il est normal d’obliger les citoyens à s’assurer contre la longue maladie, ou même le chômage, ou à cotiser à une caisse de retraite dans des conditions qui leur évitent d’être à la charge de la collectivité, un jour ou l’autre. L’assurance auto n’est-elle pas obligatoire ? Il reste que les ménages à faible revenu ou les personnes dont l’âge augmente les risques doivent être aidés. La solidarité nationale prendra en compte une partie plus ou moins importante des primes.
L’essentiel c’est de laisser chacun libre de choisir son type d’assurance. Qu’il puisse. contre un allègement de sa prime renoncer au remboursement du « petit risque » ou qu’il lui soit permis de programmer la durée de sa vie active, en optant pour la retraite à 60 ou à 65 ans, et, pourquoi pas ? 50 ou 70 ans, avec le droit de changer d’option contre l’effort financier correspondant. Chacun doit disposer de ses revenus comme il l’entend, dans les limites fixées par le bien commun.
L’impôt financerait tout ce qui relève de la solidarité. Ce qui permettrait de moduler les charges des entreprises sans recourir à des artifices et fournirait aux compagnies d’assurance et aux mutuelles les moyens d’investir. La réforme du système de financement permettrait sans doute d’unifier les régimes et de faire des économies de gestion — la sécurité sociale devenant l’organisme distributeur de la solidarité nationale et pouvant Jouer le rôle d’une compagnie d’assurance en compétition avec les autres. Cela réduirait le déficit actuel mais ne réduirait pas la progression dangereuse des dépenses de santé.
 La disparition de l’assistance publique y contribuerait. Les hôpitaux généraux sont des anachronismes. Ils datent de l’époque où les indigents n’étaient soignés que grâce aux fondations religieuses, expropriées par la Révolution. Le problème des C.H.U., plus complexe, au plan du financement. n’est guère différent au plan de la gestion. Actuellement les hôpitaux ont intérêt à remplir les lits, principe aberrant qui incite au .gaspillage. Les soins à domicile sont moins coûteux. Il convient d’en encourager le développement et, par une étude rigoureuse des besoins, de supprimer les lits inutiles. Que de politiciens locaux ont obtenu la d’établissements hospitaliers qui servent leur prestige mais qui étaient trop lourds. La répartition d’équipements coûteux devrait être revue pour éviter leur sous-emploi. Il faudrait favoriser la communication de l’information. Trop souvent, parce que les dossiers ne sont pas transmis, le malade qui passe d’un hôpital à l’autre est obligé de recommencer des examens onéreux et, parfois, pénibles. Chaque Français devrait, sous la protection de son code de sécurité sociale, disposer d’un carnet de santé, informatisé et stocké par une banque de données à laquelle seuls les médecins auraient accès.
La disparition de l’assistance publique y contribuerait. Les hôpitaux généraux sont des anachronismes. Ils datent de l’époque où les indigents n’étaient soignés que grâce aux fondations religieuses, expropriées par la Révolution. Le problème des C.H.U., plus complexe, au plan du financement. n’est guère différent au plan de la gestion. Actuellement les hôpitaux ont intérêt à remplir les lits, principe aberrant qui incite au .gaspillage. Les soins à domicile sont moins coûteux. Il convient d’en encourager le développement et, par une étude rigoureuse des besoins, de supprimer les lits inutiles. Que de politiciens locaux ont obtenu la d’établissements hospitaliers qui servent leur prestige mais qui étaient trop lourds. La répartition d’équipements coûteux devrait être revue pour éviter leur sous-emploi. Il faudrait favoriser la communication de l’information. Trop souvent, parce que les dossiers ne sont pas transmis, le malade qui passe d’un hôpital à l’autre est obligé de recommencer des examens onéreux et, parfois, pénibles. Chaque Français devrait, sous la protection de son code de sécurité sociale, disposer d’un carnet de santé, informatisé et stocké par une banque de données à laquelle seuls les médecins auraient accès.
Ces mesures, prises à l’échelon national, ne suffiront pas. L’Eut impose certaines règles mais il ne faut pas qu’il intervienne dans le domaine de la gestion. Ce qui suppose l’autonomie des établissements hospitaliers qui fonctionneront sous la responsabilité d’une conseil d’administration composé d’élus locaux et de représentants du corps médical. En cas de déficit le conseil sera conduit à réduire les dépenses et à demander des subventions aux municipalités, cc qui se traduira par une augmentation des impôts locaux. En aucun cas. l’Etat ne fournira de crédits pour boucher les trous ou pour entreprendre des travaux. Il est évident que les élus locaux seront conduits à beaucoup plus de vigilance et de prudence ; mais après tout, c’est à chaque ville. à chaque département, dans le cadre de leurs ressources de déterminer leurs priorités, même si, entre l’hôpital, la culture et le sport les choix sont parfois douloureux.
Vers l’horreur institutionnalisée ?
Reste le problème de la société. Nous assistons, comme l’avait prophétisé Jules Romains au triomphe de la médecine. Nos contemporains n’acceptent plus d’être mortels. Leur corps devient leur unique souci. Le matérialisme pratique (on n’a qu’une vie), les espoirs excessifs nés du prodigieux essor des sciences biologiques, l’idéologie sécuritaire, qui n’admet pas le risque et transforme le médecin en gibier de justice, contribuent à la surconsommation des médicaments, à la multiplication des analyses de laboratoire ou des radios, à l’acharnement thérapeutique et à la recherche de l’exploit qui donnera à un patron la notoriété. Ce qui conduira immanquablement, du fait de l’impitoyable logique des coûts, à l’euthanasie et à l’eugénisme. Il est déjà absurde de provoquer trois cent mille avortements par an et de réaliser, à grands frais, l’insémination artificielle de quelques femmes. Le nombre des enfants diminuant, celui des vieillards augmentant, il faudra bien se résoudre à se débarrasser par une piqûre. des démences séniles, des handicapés profonds et des victimes d’accidents de la route quand les frais d’opération dépasseront un petit peu trop ce qu’ils rapporteraient en tant que producteurs à la société. Puis l’on éliminera tous les improductifs, fous incurables, vieillards trop atteints et handicapés moteurs incapables de travailler. Notre société débouche sur l’horreur institutionnalisée dont Hitler fut le précurseur. Le jour où l’avortement fut libéralisé, nous nous sommes engagés sur une voie qui conduit nécessairement au désastre moral. Quelles règles éthiques protégeront des tentations offertes par les manipulations génétiques une médecine qui perd le respect de la vie et de ses rythmes pour se transformer en « technique de pointe » ?
Il est temps d’inverser l’évolution en faisant porter l’effort sur la prévention et le dépistage précoce. Que de maladies incurables pourraient, si elles étaient détectées à temps, être soignées avec des chances sérieuses de guérison ! Que d’opérations coûteuses et parfois mutilantes, seraient évitées !
 La France n’a sans doute pas trop de médecins. Elle n’en a pas assez de bons. Si difficile que ce soit, en raison d’une urbanisation anarchique et de la mobilité sociale, il convient de rendre sa juste place au médecin de famille, seul capable d’orienter ses patients vers les spécialistes et. plutôt que de se contenter d’examens hâtifs, anarchiques et trop souvent bureaucratiques de médecins des écoles, du travail et de la sécurité sociale dont la compétence et la , bonne volonté ne sont pas, d’ordinaire, contestables, procéder à des examens méthodiques, en milieu hospitalier, selon une périodicité déterminée par l’âge, l’emploi et la condition générale. L’informatisation des résultats, la liaison entre la banque de données et les cabinets médicaux des généralistes nécessiteraient, dans un premier temps, des investissements importants, encore que leurs conséquences sur le développement de notre informatique compenseraient, pour une bonne part, le prix de l’effort consenti. En tous cas, à terme, ils réduiraient le nombre et surtout la gravité des « interventions lourdes » les plus onéreuses, celles qui creusent le gouffre de la sécurité sociale.
La France n’a sans doute pas trop de médecins. Elle n’en a pas assez de bons. Si difficile que ce soit, en raison d’une urbanisation anarchique et de la mobilité sociale, il convient de rendre sa juste place au médecin de famille, seul capable d’orienter ses patients vers les spécialistes et. plutôt que de se contenter d’examens hâtifs, anarchiques et trop souvent bureaucratiques de médecins des écoles, du travail et de la sécurité sociale dont la compétence et la , bonne volonté ne sont pas, d’ordinaire, contestables, procéder à des examens méthodiques, en milieu hospitalier, selon une périodicité déterminée par l’âge, l’emploi et la condition générale. L’informatisation des résultats, la liaison entre la banque de données et les cabinets médicaux des généralistes nécessiteraient, dans un premier temps, des investissements importants, encore que leurs conséquences sur le développement de notre informatique compenseraient, pour une bonne part, le prix de l’effort consenti. En tous cas, à terme, ils réduiraient le nombre et surtout la gravité des « interventions lourdes » les plus onéreuses, celles qui creusent le gouffre de la sécurité sociale.
Ne nous berçons pas d’illusions cependant. A terme, nous n’éviterons l’euthanasie systématique que si le nombre des naissances l’emporte sur celui des morts. Sinon, il n’y aura d’issue, quoi que nous fassions, que dans le recours à l’horreur. Il est vrai que sans doute l’Islam ou le communisme nous auront, dans ce cas, soumis à leur loi avant que nous n’en arrivions là. L’avenir d’un peuple, ce sont ses enfants. Une jeunesse nombreuse peut seule assurer le progrès technique et la prospérité de l’Occident. De ce point de vue, le Club de Rome a raison. La croissance zéro de la démographie est liée à la croissance zéro de l’économie.
 Les technocrates, dont Giscard comme maintenant Mitterrand, ne sont que les agents, partent d’une idée simple, donc fausse. La technologie moderne exigera de moins en moins de travailleurs, donc réduisons le nombre d’enfants pour éviter d’en faire des chômeurs. Il n’est besoin, pour démonter l’absurdité du raisonnement que de constater que, dans le même temps, ces messieurs ouvraient nos frontières aux familles d’immigrés dont la fécondité masquait la chute de la natalité française. En d’autres termes, nous importions de futurs chômeurs. Mais nous touchons là à l’essentiel. Il va falloir s’en expliquer plus longuement.
Les technocrates, dont Giscard comme maintenant Mitterrand, ne sont que les agents, partent d’une idée simple, donc fausse. La technologie moderne exigera de moins en moins de travailleurs, donc réduisons le nombre d’enfants pour éviter d’en faire des chômeurs. Il n’est besoin, pour démonter l’absurdité du raisonnement que de constater que, dans le même temps, ces messieurs ouvraient nos frontières aux familles d’immigrés dont la fécondité masquait la chute de la natalité française. En d’autres termes, nous importions de futurs chômeurs. Mais nous touchons là à l’essentiel. Il va falloir s’en expliquer plus longuement.
III. LES NOUVELLES « CLASSES DANGEREUSES »
 Il convient, avant d’aborder le problème de l’immigration, de rappeler que, .de tradition romaine et catholique nous tenons le racisme pour une aberration fabriquée par le luthéranisme.
Il convient, avant d’aborder le problème de l’immigration, de rappeler que, .de tradition romaine et catholique nous tenons le racisme pour une aberration fabriquée par le luthéranisme.
Il constitue l’une des conséquences obligées, parmi d’autres, aussi détestables, de la conception théologique d’une perversion radicale de la nature humaine par le péché d’origine. Les pauvres et les nègres sont des coupables, du seul fait que Dieu ne leur a pas procuré la richesse ou ne leur a pas permis de naître de la race des maîtres. Il. convient de les tenir en tutelle. L’enfermement des paysans, chassés de leurs terres, dans l’Angleterre puritaine où l’apartheid sud-africain constituent des mesures philanthropiques pour un luthérien demeuré fidèle aux Pères de la Réformation. Tout naturellement ces gens-là devaient porter Hitler au pouvoir. Ils l’ont fait.
 Romains, nous sommes les fils de César, non de Vercingétorix. Nous devons le meilleur de nous-mêmes au colonisateur, qui nous a intégrés à un empire où se mêlaient les ethnies les plus disparates mais liées par une communauté de culture. Serions-nous devenus catholiques sans les marchands syriaques qui remontaient du Rhône au Rhin ? Les peuples latins charrient, dans leurs veines, tous les sangs. Nicolette, raimée du bel Aucassin, était une arabe. Maurras ne voyait à ces rencontres qu’avantages, à condition qu’ils s’inscrivent dans une communauté de culture. Nicolette était arabe sans-doute mais cela n’avait pas d’importance puisqu’elle était catholique. S’il n’y avait parmi les immigrés que des Espagnols, des Portugais. des Polonais ou des Arméniens, ils ne poseraient aucun problème. Et si en 1830, nous avions baptisé les arabes d’Algérie à la lance d’arrosage, dans la tradition de Clovis, ils n’en poseraient pas davantage. Mais voilà, Alger conquise, la Révolution triomphait à Paris.
Romains, nous sommes les fils de César, non de Vercingétorix. Nous devons le meilleur de nous-mêmes au colonisateur, qui nous a intégrés à un empire où se mêlaient les ethnies les plus disparates mais liées par une communauté de culture. Serions-nous devenus catholiques sans les marchands syriaques qui remontaient du Rhône au Rhin ? Les peuples latins charrient, dans leurs veines, tous les sangs. Nicolette, raimée du bel Aucassin, était une arabe. Maurras ne voyait à ces rencontres qu’avantages, à condition qu’ils s’inscrivent dans une communauté de culture. Nicolette était arabe sans-doute mais cela n’avait pas d’importance puisqu’elle était catholique. S’il n’y avait parmi les immigrés que des Espagnols, des Portugais. des Polonais ou des Arméniens, ils ne poseraient aucun problème. Et si en 1830, nous avions baptisé les arabes d’Algérie à la lance d’arrosage, dans la tradition de Clovis, ils n’en poseraient pas davantage. Mais voilà, Alger conquise, la Révolution triomphait à Paris.
A force de crier au loup, les intellectuels de gauche finiront bien par persuader les Français qu’ils sont racistes. En réalité, le phénomène de résurgence des « classes dangereuses », auquel nous assistons, est aggravé par l’idéologie sécuritaire. Paris au XVIIIe siècle, quand les bandes de cartouchiens détroussaient les passants qui commettaient l’erreur de sortir le soir, était moins sûr qu’aujourd’hui.
 Le XIXe siècle tenait, à juste titre, les « mystères de Paris » pour le récit, assez fidèle, des mœurs d’une société souterraine, qui effrayait et fascinait. Notre siècle a prétendu protéger le citoyen contre tous les risques. Celui-ci entend que l’assistance policière l’assure contre les voleurs. Multiplierait-on par cent le nombre de policiers que l’on n’y parviendrait sans-doute pas et cette charge financière, s’ajoutant aux autres, rendrait impossible le fonctionnement de l’économie. Que l’on ne s’étonne pas que le citoyen prenne son fusil et tire au jugé sur tout ce qui bouge.
Le XIXe siècle tenait, à juste titre, les « mystères de Paris » pour le récit, assez fidèle, des mœurs d’une société souterraine, qui effrayait et fascinait. Notre siècle a prétendu protéger le citoyen contre tous les risques. Celui-ci entend que l’assistance policière l’assure contre les voleurs. Multiplierait-on par cent le nombre de policiers que l’on n’y parviendrait sans-doute pas et cette charge financière, s’ajoutant aux autres, rendrait impossible le fonctionnement de l’économie. Que l’on ne s’étonne pas que le citoyen prenne son fusil et tire au jugé sur tout ce qui bouge.
L’histoire des « classes dangereuses »
Des statistiques, qu’il n’y a aucune raison de récuser, nous apprennent qu’il n’y a jamais eu plus de monde dans les prisons. Si tant de juges sombrent dans le laxisme n’est-ce-pas, dans bien des cas, parce qu’ils ne savent plus que faire des délinquants, devenus si nombreux qu’il faudrait pour les punir convenablement couvrir le territoire de prisons ? Toujours, selon les statistiques, les immigrés ne représenteraient que 15 % des condamnés mais les Français commencent à penser que le nombre de ceux qu’on laisse courir est en proportion beaucoup plus considérable. Les immigrés s’identifient désormais, dans l’esprit public, aux « classes dangereuses ». Au siècle précédent, ce n’était pas l’Arabe mais le terrassier breton ou le ramoneur savoyard qui faisait peur.
Les « classes dangereuses » se composaient à l’époque de domestiques ou de paysans qui ne trouvaient plus à s’employer sur place du fait du lotissement des biens communaux, de la dispersion des maisons seigneuriales, puis de l’apparition d’objets manufacturés, qui ruinait une partie des artisans. Avec le chemin de fer, ce peuple de déracinés afflua vers les grandes villes, s’entassant dans des quartiers suburbains, d’ordinaire attiré par les grands chantiers qui s’ouvraient. Sans qualification, cette main d’œuvre ne pouvait s’employer que de façon précaire. Privée de ses cadres religieux et sociaux, rongée par l’alcoolisme, elle ne survivait, en temps de crise, que d’aumônes ou de menus chapardages. Ainsi se constituait un lumpen prolétariat, un prolétariat en guenilles, dont Marx parle avec mépris, car il était inutilisable par la Révolution. En majorité, les « classes dangereuses » étaient honnêtes. La plupart de leurs membres étaient disposés à accepter n’importe quelle tâche, si pénible soit-elle, qu’on leur proposait à la journée. Elles fournissaient, toujours selon Marx, « l’armée de réserve du travail », cette masse de main-d’œuvre disponible, qui donnait à l’appareil productif son élasticité puisqu’on y puisait, en cas de besoin, les manœuvres dont on se débarrassait au premier fléchissement de l’activité. Comment un tel milieu n’aurait-il pas engendré des délinquants. surtout parmi les jeunes. élevés dans la rue, habitués par l’exiguïté du logement à la promiscuité, tôt initiés à l’absinthe ? Il est remarquable que le grand débat entre les partisans de la répression et ceux de la prévention soit né à cette époque.
 Aujourd’hui les « classes dangereuses » se recrutent parmi les immigrés mais, à ceci près que la drogue remplace l’absinthe, les similitudes paraissent frappantes. Des gamins qui ne se sentent plus algériens mais sans être devenus français, incapables de recevoir une formation professionnelle, et qui, cependant. ne voulant plus travailler comme leurs pères à la chaîne, deviennent des délinquants. Cependant leurs rangs tendent à se grossir des jeunes Français, sortis à seize ans de l’école, sans métier, analphabètes, parfois drogués. Ce n’est pas une affaire de race mais un échec de notre société. L’essor de l’industrie avait permis de résorber les anciennes classes dangereuses. Nous les avons reconstituées. Ce n’était pas une fatalité. Le surpeuplement ayant empêché le Japon de recourir à la main-d’œuvre immigrée — en dehors de Coréens, qui fournissent par tradition des domestiques — celui-ci a su conserver une classe ouvrière indigène et quand elle est devenue insuffisante, robotiser les tâches répétitives.
Aujourd’hui les « classes dangereuses » se recrutent parmi les immigrés mais, à ceci près que la drogue remplace l’absinthe, les similitudes paraissent frappantes. Des gamins qui ne se sentent plus algériens mais sans être devenus français, incapables de recevoir une formation professionnelle, et qui, cependant. ne voulant plus travailler comme leurs pères à la chaîne, deviennent des délinquants. Cependant leurs rangs tendent à se grossir des jeunes Français, sortis à seize ans de l’école, sans métier, analphabètes, parfois drogués. Ce n’est pas une affaire de race mais un échec de notre société. L’essor de l’industrie avait permis de résorber les anciennes classes dangereuses. Nous les avons reconstituées. Ce n’était pas une fatalité. Le surpeuplement ayant empêché le Japon de recourir à la main-d’œuvre immigrée — en dehors de Coréens, qui fournissent par tradition des domestiques — celui-ci a su conserver une classe ouvrière indigène et quand elle est devenue insuffisante, robotiser les tâches répétitives.
Le système est incapable
de résoudre la question de l’immigration
 Pourquoi n’en avons-nous pas fait autant ? Parce qu’en France l’Etablissement, le capitalisme financier domine la capitalisme industriel et ne cherche que le profit immédiat sans viser le long terme.
Pourquoi n’en avons-nous pas fait autant ? Parce qu’en France l’Etablissement, le capitalisme financier domine la capitalisme industriel et ne cherche que le profit immédiat sans viser le long terme.
Le taylorisme, privant l’ouvrier de toute responsabilité, parcellisant les tâches, exige des travailleurs sans la moindre qualification. On les a cherchés dans les campagnes. Au bout d’une génération, les jeunes ont commencé à déserter l’usine, devenant fonctionnaires, employés de banques, vendeurs. Au lieu de comprendre comme l’a fait Ford qu’il fallait compenser par de hauts salaires la disqualification du travail manuel puis, comme les Japonais, qu’il convenait de faire participer les ouvriers à l’organisation du travail et à l’amélioration de la productivité, notre Etablissement a développé une hiérarchie salariale aberrante. Le manœuvre aux écritures qui passe sa journée derrière un bureau à classer des documents a été beaucoup mieux payé et surtout considéré que l’ouvrier. Il est vrai qu’il était difficile de recruter des travailleurs immigrés pour gonfler, jusqu’à la pléthore, le secteur tertiaire.
 Le giscardisme, invoquant des raisons humanitaires, encouragea les immigrés à faire venir leurs familles en France. M. Stoleru dissimulait derrière l’idéalisme du discours de sordides questions de gros sous. Il s’agissait de limiter les sorties de devises. Les immigrés consommaient peu, pour envoyer leur salaire à leur famille. Celle-ci, installée en France, ferait marcher le commerce. Ce serait tout bénéfice, d’autant que les grands ensembles, construits à la va-vite pour loger les rapatriés commençaient à se vider d’une population courageuse qui avait su améliorer rapidement ses conditions d’existence et désertait des immeubles qui se dégradaient aussi rapidement qu’ils avaient été édifiés. Mais les enfants déracinés, mêlés dans des classes surpeuplées aux petits français, pouvaient-ils sauf exception, apprendre convenablement notre langue et poursuivre une scolarité normale ? Aucune importance, pensait, mais ne disait pas, M. Stoleru puisqu’ils sont, comme leurs pères, voués à la chaîne. C’était oublier qu’ils ne tarderaient pas à partager le dégoût du travail posté des petits français.
Le giscardisme, invoquant des raisons humanitaires, encouragea les immigrés à faire venir leurs familles en France. M. Stoleru dissimulait derrière l’idéalisme du discours de sordides questions de gros sous. Il s’agissait de limiter les sorties de devises. Les immigrés consommaient peu, pour envoyer leur salaire à leur famille. Celle-ci, installée en France, ferait marcher le commerce. Ce serait tout bénéfice, d’autant que les grands ensembles, construits à la va-vite pour loger les rapatriés commençaient à se vider d’une population courageuse qui avait su améliorer rapidement ses conditions d’existence et désertait des immeubles qui se dégradaient aussi rapidement qu’ils avaient été édifiés. Mais les enfants déracinés, mêlés dans des classes surpeuplées aux petits français, pouvaient-ils sauf exception, apprendre convenablement notre langue et poursuivre une scolarité normale ? Aucune importance, pensait, mais ne disait pas, M. Stoleru puisqu’ils sont, comme leurs pères, voués à la chaîne. C’était oublier qu’ils ne tarderaient pas à partager le dégoût du travail posté des petits français.
La première guerre mondiale avait marqué la fin des « classes dangereuses ». Les travailleurs que nous amenions de notre Empire s’étaient tout naturellement installés dans les quartiers chauds, libérés par les métropolitains. Ainsi, à Paris, le quartier de la Goutte d’Or. Nous débarrasserons-nous, comme nous y étions parvenus, des classes dangereuses que nous avons laissé se reconstituer ? Sans doute aurions-nous pu l’espérer dans le cadre de l’Algérie Française, en menant une politique d’intégration. L’armée aurait joué son rôle de creuset. A quoi bon refaire l’histoire ? Nous nous trouvons en face d’une situation désormais insoluble, sinon au terme d’un drame national.
 Les immigrés de la seconde génération sont plongés dans un monde trop proche d’eux et cependant inaccessible. Ils ont pris nos habitudes de vie et nos désirs mais sans qu’il leur soit possible de mener une existence semblable à la nôtre. Installés dans des quartiers misérables, sans espoir de promotion sociale, ils se sentent de trop. Si nous voulons que notre industrie lourde demeure compétitive, il faudra bien robotiser et d’autant plus vite que notre retard est plus grand. L’O.S. sera chassé de l’usine, remplacé, comme au Japon, par des bacheliers moins nombreux et mieux payés. Il ne restera que les emplois précaires, les moins intéressants, moralement et financièrement pour une « armée de réserve du travail » composée de chômeurs. Il est évident qu’encadrés par les Khomeynistes ou les frères musulmans, aidés par un parti communiste qui, par une illusion tenace, croit encore qu’il contrôlera le mouvement, les immigrés de la seconde génération fourniront les combattants de terrifiantes révoltes.
Les immigrés de la seconde génération sont plongés dans un monde trop proche d’eux et cependant inaccessible. Ils ont pris nos habitudes de vie et nos désirs mais sans qu’il leur soit possible de mener une existence semblable à la nôtre. Installés dans des quartiers misérables, sans espoir de promotion sociale, ils se sentent de trop. Si nous voulons que notre industrie lourde demeure compétitive, il faudra bien robotiser et d’autant plus vite que notre retard est plus grand. L’O.S. sera chassé de l’usine, remplacé, comme au Japon, par des bacheliers moins nombreux et mieux payés. Il ne restera que les emplois précaires, les moins intéressants, moralement et financièrement pour une « armée de réserve du travail » composée de chômeurs. Il est évident qu’encadrés par les Khomeynistes ou les frères musulmans, aidés par un parti communiste qui, par une illusion tenace, croit encore qu’il contrôlera le mouvement, les immigrés de la seconde génération fourniront les combattants de terrifiantes révoltes.
 Ils le deviendront d’autant plus facilement que, par le seul jeu des naissances, leur poids démographique va augmenter rapidement, à l’exemple des fils de harkis (Photo) qui approchent du demi-million. Si l’on ajoute les antillais, la menace devient pressante.
Ils le deviendront d’autant plus facilement que, par le seul jeu des naissances, leur poids démographique va augmenter rapidement, à l’exemple des fils de harkis (Photo) qui approchent du demi-million. Si l’on ajoute les antillais, la menace devient pressante.
Quelques propositions réalistes
Alors, les renvoyer, en masse ? Ne tombons pas dans les slogans démagogiques d’hurluberlus d’extrême droite. Par tradition, nous• savons garder raison. Il serait dangereux, par des mesures trop brutales de déstabiliser le Maroc, la Tunisie et le Mali. Par ailleurs, notre industrie lourde n’est pas prête et, en période de récession, le départ de millions de consommateurs poserait des problèmes délicats de reconversion au commerce. Les enfants de harkis, les immigrés de la seconde génération nés en France et les antillais sont français. Cela fait déjà beaucoup de monde.
On peut formuler quelques propositions réalistes :
- création d’une carte d’identité informatisée, pratiquement impossible à falsifier, pour les étrangers.
- expulsion de tout immigré qui se trouve en situation irrégulière mais aussi des délinquants, famille comprise. Nous avons nos proxénètes ; nos trafiquants de drogue et nos bandits. Inutile d’en importer. Cette mesure permettrait de freiner la montée du racisme et profiterait aux immigrés honnêtes qui restent, quoi qu’on pense, la majorité.
- abolition de la loi qui accorde automatiquement la nationalité française aux étrangers nés sur notre sol. Ce qui réglerait notre différend avec l’Algérie. Celle-ci accepterait que l’abolition ait un effet rétroactif.
Il ne s’agit que de mesures de première urgence. Nous devons négocier avec nos partenaires le retour de tous les immigrés dans les dix ans. Nous y parviendrons en modifiant notre politique de coopération. Pour un certain nombre de produits qui exigent une main-d’œuvre abondante et bon marché, il convient que notre industrie accepte, à l’exemple de la japonaise, de créer elle-même des concurrents. De toute façon, ces concurrents existent déjà : Hong-Kong, la Thaïlande, Taiwan, l’Indonésie. Le Japon les a suscités. Montons en Afrique noire, au Maroc, en Tunisie des entreprises et formons les immigrés pour qu’ils fournissent la main-d’œuvre. Ils repartiront à mesure que nous leur fournirons du travail dans leur propre pays. Il faut se presser. Le Japon et même le Brésil commencent à s’intéresser au marché africain longtemps, pour la part francophone, notre chasse gardée. Pourquoi Renault n’installerait-il pas au Mali, dont la main d’œuvre est très adroite, une usine de montage, pour résister à la poussée japonaise ? Nos investissements aideraient, par leurs effets induits, des pays où nous gardons des amis, plus qu’une « aide » qui finance de grands travaux d’une rentabilité médiocre, en tous cas sans commune mesure avec leur coût. Ainsi serait engagée une politique sage, généreuse parce qu’intelligente.
Même l’Algérie, menacée du renvoi massif de ses ressortissants, se montrerait accommodante.
 Peu à peu, nous allégerions le budget social de la nation. Ce qui libérerait des moyens financiers pour mener un effort de formation des antillais et des enfants des harkis. (Photo) En améliorant leurs conditions de vie, en les libérant de la promiscuité de l’immigration noire ou maghrébine, le danger de racisme étant écarté, nous engagerions le processus d’intégration, d’autant plus urgent à mettre en œuvre, qu’ils menacent de devenir des ennemis de l’intérieur. Que de fils de harkis, en particulier, parfois victimes de brimades racistes, révoltés, se retournent contre des pères, accusés d’avoir trahi pour rien l’Islam. En ferons-nous les plus dangereux agents du Khomeynisme ? La question doit être posée.
Peu à peu, nous allégerions le budget social de la nation. Ce qui libérerait des moyens financiers pour mener un effort de formation des antillais et des enfants des harkis. (Photo) En améliorant leurs conditions de vie, en les libérant de la promiscuité de l’immigration noire ou maghrébine, le danger de racisme étant écarté, nous engagerions le processus d’intégration, d’autant plus urgent à mettre en œuvre, qu’ils menacent de devenir des ennemis de l’intérieur. Que de fils de harkis, en particulier, parfois victimes de brimades racistes, révoltés, se retournent contre des pères, accusés d’avoir trahi pour rien l’Islam. En ferons-nous les plus dangereux agents du Khomeynisme ? La question doit être posée.
IV. – LES INTÉRÊTS DU « CAPITAL FRANCE »
 Le problème posé par les prestations sociales est sans doute le plus délicat. Il n’est pas le plus difficile.
Le problème posé par les prestations sociales est sans doute le plus délicat. Il n’est pas le plus difficile.
Tout le monde s’accorde à reconnaître que le pourcentage du produit intérieur brut qu’elles absorbent ne peut plus être dépassé. Il faut réaliser des économies, grâce à une meilleure gestion, et M. Bérégovoy s’y emploie de son mieux.
Instaurer la rigueur = premier impératif.
Sur des points importants, il se montre plus lucide ou plus courageux que ses prédécesseurs. Il n’a d’ailleurs qu’un faible mérite, car dans ce domaine comme dans les autres, le septennat de M. Giscard s’est révélé .désastreux. Financer les hôpitaux en fonction du nombre de lits occupés encourageait le gaspillage. M. Bérégovoy vient de réformer ce système absurde en adoptant le principe d’une dotation accordée chaque année, aux directeurs d’hôpitaux. Au risque de faire hurler les « grands patrons », il est convenable de faire entrer dans la prescription thérapeutique la notion de coût. 11 est des progrès, souhaitables sans doute mais trop onéreux, dans l’état présent de l’économie, compte tenu du petit. nombre de cas concernés. S’il est vrai que la santé n’a pas de prix, elle a un coût, dont les médecins doivent tenir compte. Pour sauver une centaine de vies humaines ou les prolonger, il est impossible de prendre le risque d’en sacrifier, d’ici quelques années, des milliers, du fait d’un effondrement de notre système de soins.
 Mais surtout, il importe de réviser la carte médicale. La répartition géographique des praticiens est aberrante. Elle contribue à la désertification des campagnes. On n’y remédiera que dans le cadre d’une réforme radicale de nos structures ‘universitaires. Pour l’instant, nous n’aborderons pas le sujet. Par contre chaque conseil général a voulu se pourvoir d’un centre départemental hospitalier, parfois luxueux, souvent suréquipé. L’on a accumulé les « lits » inutiles et mal distribués, des appareils coûteux, qui ne sont pas utilisés à plein temps, ce qui est d’autant plus fâcheux que ce matériel se périme très vite et qu’il convient de l’amortir rapidement. La mise en place d’une « carte sanitaire » présente des dangers. Elle limite le libre choix des malades et contraint les familles à de longs déplacements. Là encore, les exigences financières doivent malheureusement l’emporter sur d’autres considérations. L’on n’y serait pas contraint si la non-gestion giscardienne ne nous y avait pas conduits.
Mais surtout, il importe de réviser la carte médicale. La répartition géographique des praticiens est aberrante. Elle contribue à la désertification des campagnes. On n’y remédiera que dans le cadre d’une réforme radicale de nos structures ‘universitaires. Pour l’instant, nous n’aborderons pas le sujet. Par contre chaque conseil général a voulu se pourvoir d’un centre départemental hospitalier, parfois luxueux, souvent suréquipé. L’on a accumulé les « lits » inutiles et mal distribués, des appareils coûteux, qui ne sont pas utilisés à plein temps, ce qui est d’autant plus fâcheux que ce matériel se périme très vite et qu’il convient de l’amortir rapidement. La mise en place d’une « carte sanitaire » présente des dangers. Elle limite le libre choix des malades et contraint les familles à de longs déplacements. Là encore, les exigences financières doivent malheureusement l’emporter sur d’autres considérations. L’on n’y serait pas contraint si la non-gestion giscardienne ne nous y avait pas conduits.
 Beaucoup d’autres économies pourraient être réalisées. Nos hôpitaux sont encombrés d’étrangers, entrés souvent en fraude, qui donnent de fausses adresses et se font soigner aux frais des Français. Que de femmes d’immigrés ne viennent chez nous que le temps d’accoucher ou d’obtenir pour des enfants, dont nul n’est sûr qu’ils sont les leurs, des soins longs et onéreux ! Aussi déplorable que ce soit, nous ne sommes plus en mesure de supporter le poids financier de la santé des familles du tiers monde. La France ne peut devenir l’hôpital général de l’Afrique. De même trop de vieillards sont hébergés par les hôpitaux, parfois abandonnés comme des chiens par des enfants qui disposent des moyens financiers de s’en occuper. Dans notre période de prospérité, l’effort nécessaire au maintien à domicile des vieillards n’a pas été accompli. Pas davantage, l’on s’est soucié de maintenir chez eux les malades. L’hospitalisation constituait une solution de facilité, même si elle provoquait d’énormes gaspillages.
Beaucoup d’autres économies pourraient être réalisées. Nos hôpitaux sont encombrés d’étrangers, entrés souvent en fraude, qui donnent de fausses adresses et se font soigner aux frais des Français. Que de femmes d’immigrés ne viennent chez nous que le temps d’accoucher ou d’obtenir pour des enfants, dont nul n’est sûr qu’ils sont les leurs, des soins longs et onéreux ! Aussi déplorable que ce soit, nous ne sommes plus en mesure de supporter le poids financier de la santé des familles du tiers monde. La France ne peut devenir l’hôpital général de l’Afrique. De même trop de vieillards sont hébergés par les hôpitaux, parfois abandonnés comme des chiens par des enfants qui disposent des moyens financiers de s’en occuper. Dans notre période de prospérité, l’effort nécessaire au maintien à domicile des vieillards n’a pas été accompli. Pas davantage, l’on s’est soucié de maintenir chez eux les malades. L’hospitalisation constituait une solution de facilité, même si elle provoquait d’énormes gaspillages.
Faut-il réduire les prestations sociales ?
On pourrait multiplier les exemples. Mais même en introduisant plus de rigueur dans le fonctionnement des caisses, l’on ne parviendra qu’à des résultats précaires et sans commune mesure avec les déficits qu’il faut à tout prix résorber. Les gouvernements qu’ils soient « libéraux » ou « socialistes » s’en tiennent toujours .à des mesures conjoncturelles. D’où de cuisants échecs.
 Ainsi M. Delors avait imaginé qu’il lui suffirait, pour vaincre l’inflation, d’imposer à l’économie une « cure de refroidissement », comme si la pauvrette n’était pas déjà presque morte de froid. Remède aussi classique que la saignée, du temps de M. Purgon. C’est oublier les causes véritables de l’inflation, qui résident dans la trop faible rentabilité de l’investissement, et l’accumulation des frais financiers, qu’il faut bien répercuter dans les prix de vente. La sanction ne se fera pas attendre. La quatrième dévaluation est prédite, par tous les observateurs financiers, pour le printemps prochain, le seul espoir de M. Delors restant d’obtenir de l’Allemagne qu’elle la dissimule au moyen d’une réévaluation du mark, dont les effets psychologiques seraient moins graves. Il en va de même des prestations sociales. Les gaspillages existent. Il est nécessaire de les réduire. Cela prendra du temps. Alors, il reste la réduction des prestations sociales. Jamais Giscard et Barre n’auraient osé s’engager dans cette voie. Ce n’était pas l’envie qui leur manquait mais le courage, Reconnaissons qu’il en faut moins à M. Bérégovoy. Franchise de 20 F sur la journée d’hospitalisation, non remboursement des médicaments dits de « confort », diminution des allocations chômage et augmentation limitée des allocations familiales, ont permis de réaliser des économies, malheureusement insuffisantes. Est-il possible d’aller plus loin ? Sans doute, pas. La France entre en période préélectorale. Tout se jouera en 1986, lors des législatives. Les socialistes le savent. Le courage, en démocratie, se déploie dans des limites étroites.
Ainsi M. Delors avait imaginé qu’il lui suffirait, pour vaincre l’inflation, d’imposer à l’économie une « cure de refroidissement », comme si la pauvrette n’était pas déjà presque morte de froid. Remède aussi classique que la saignée, du temps de M. Purgon. C’est oublier les causes véritables de l’inflation, qui résident dans la trop faible rentabilité de l’investissement, et l’accumulation des frais financiers, qu’il faut bien répercuter dans les prix de vente. La sanction ne se fera pas attendre. La quatrième dévaluation est prédite, par tous les observateurs financiers, pour le printemps prochain, le seul espoir de M. Delors restant d’obtenir de l’Allemagne qu’elle la dissimule au moyen d’une réévaluation du mark, dont les effets psychologiques seraient moins graves. Il en va de même des prestations sociales. Les gaspillages existent. Il est nécessaire de les réduire. Cela prendra du temps. Alors, il reste la réduction des prestations sociales. Jamais Giscard et Barre n’auraient osé s’engager dans cette voie. Ce n’était pas l’envie qui leur manquait mais le courage, Reconnaissons qu’il en faut moins à M. Bérégovoy. Franchise de 20 F sur la journée d’hospitalisation, non remboursement des médicaments dits de « confort », diminution des allocations chômage et augmentation limitée des allocations familiales, ont permis de réaliser des économies, malheureusement insuffisantes. Est-il possible d’aller plus loin ? Sans doute, pas. La France entre en période préélectorale. Tout se jouera en 1986, lors des législatives. Les socialistes le savent. Le courage, en démocratie, se déploie dans des limites étroites.
 Est-il souhaitable d’aller trop loin, dans ce sens ? Les hésitations de Madame Thatcher s’expliquent par la crainte de convulsions sociales. Mais aussi pour des raisons économiques. En période de crise, les prestations sociales jouent le rôle d’amortisseurs. A trop les réduire, on prend le risque de provoquer une récession d’une telle ampleur qu’aucun pays ne serait capable de la supporter. M. Reagan a compris qu’en allant trop loin il compromettait la reprise économique. Tout assuré social est un consommateur. Moins il consomme (puisqu’obligé de dépenser davantage pour sa santé) et moins vite les stocks s’écoulent. Prétendre le contraire relève de la démagogie. Il ne faut pas oublier que l’Etat providence n’est pas né d’un brutal accès de philanthropie du grand capital. Il ne s’agit pas davantage d’une « conquête sociale » des travailleurs. Cessons de ruser. L’Etat providence constituait l’unique réponse qu’une société libérale pouvait apporter à la grande dépression de 1929. Qu’il transforme cette société de l’intérieur et la rende totalitaire, n’y change rien. Parce que l’A.F. a pour premier souci la défense des libertés ou plutôt leur reconstitution, dans la mesure où elles n’ont cessé, depuis 1789, de s’amenuiser, nous sommes sans doute hostiles à l’Etat providence en raison précisément de la dérive totalitaire qu’il implique. Cela ne signifie nullement que nous trouvons qu’il y a trop de justice sociale, dans ce pays. Au contraire des libéraux, nous pensons qu’il n’y en a pas assez. Aussi sommes-nous hostiles à toute politique, y compris l’actuelle politique socialiste, qui aboutit à la réduction des prestations sociales, en matière de santé, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales ou de chômage. Les mesures prises dans ce sens sont anti-économiques, injustes et l’apparent « courage » qu’elles supposent dissimule la lâcheté fondamentale des démocrates. Ceux-ci n’osent pas s’attaquer aux causes structurelles du déficit croissant du budget social de la nation, de la même manière qu’ils répugnent à combattre efficacement l’inflation. La raison en est simple. Cela mettrait en cause l’idéologie révolutionnaire.
Est-il souhaitable d’aller trop loin, dans ce sens ? Les hésitations de Madame Thatcher s’expliquent par la crainte de convulsions sociales. Mais aussi pour des raisons économiques. En période de crise, les prestations sociales jouent le rôle d’amortisseurs. A trop les réduire, on prend le risque de provoquer une récession d’une telle ampleur qu’aucun pays ne serait capable de la supporter. M. Reagan a compris qu’en allant trop loin il compromettait la reprise économique. Tout assuré social est un consommateur. Moins il consomme (puisqu’obligé de dépenser davantage pour sa santé) et moins vite les stocks s’écoulent. Prétendre le contraire relève de la démagogie. Il ne faut pas oublier que l’Etat providence n’est pas né d’un brutal accès de philanthropie du grand capital. Il ne s’agit pas davantage d’une « conquête sociale » des travailleurs. Cessons de ruser. L’Etat providence constituait l’unique réponse qu’une société libérale pouvait apporter à la grande dépression de 1929. Qu’il transforme cette société de l’intérieur et la rende totalitaire, n’y change rien. Parce que l’A.F. a pour premier souci la défense des libertés ou plutôt leur reconstitution, dans la mesure où elles n’ont cessé, depuis 1789, de s’amenuiser, nous sommes sans doute hostiles à l’Etat providence en raison précisément de la dérive totalitaire qu’il implique. Cela ne signifie nullement que nous trouvons qu’il y a trop de justice sociale, dans ce pays. Au contraire des libéraux, nous pensons qu’il n’y en a pas assez. Aussi sommes-nous hostiles à toute politique, y compris l’actuelle politique socialiste, qui aboutit à la réduction des prestations sociales, en matière de santé, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales ou de chômage. Les mesures prises dans ce sens sont anti-économiques, injustes et l’apparent « courage » qu’elles supposent dissimule la lâcheté fondamentale des démocrates. Ceux-ci n’osent pas s’attaquer aux causes structurelles du déficit croissant du budget social de la nation, de la même manière qu’ils répugnent à combattre efficacement l’inflation. La raison en est simple. Cela mettrait en cause l’idéologie révolutionnaire.
Rejeter l’infantilisme
de l’assistance
 Que reprochons-nous au système des prestations sociales ? Avant tout, de transformer le citoyen en enfant assisté de la naissance à la mort. Un enfant est irresponsable. Il ne compte pas. Comment le lui reprocher ? C’est précisément le rôle des éducateurs que de lui apprendre à devenir responsable, à ne plus dire ingénument que tout est possible tout de suite et qu’il peut satisfaire, sans effort, ses caprices. L’éducation lui permet, quand elle est réussie, d’accéder sans rupture, à l’âge adulte. Il est- évident qu’un système qui infantilise ses usagers doit nécessairement tomber en faillite. C’est ce qui se passe, en ce moment. D’où la nécessité de restituer ses responsabilités donc ses libertés —les deux sont liées — au citoyen prestataire. Il est significatif que les fonctionnaires de la Sécurité sociale utilisent, pour parler de nous, le terme d’assujettis. Nous sommes donc bien en présence d’un système qui asservit les Français.
Que reprochons-nous au système des prestations sociales ? Avant tout, de transformer le citoyen en enfant assisté de la naissance à la mort. Un enfant est irresponsable. Il ne compte pas. Comment le lui reprocher ? C’est précisément le rôle des éducateurs que de lui apprendre à devenir responsable, à ne plus dire ingénument que tout est possible tout de suite et qu’il peut satisfaire, sans effort, ses caprices. L’éducation lui permet, quand elle est réussie, d’accéder sans rupture, à l’âge adulte. Il est- évident qu’un système qui infantilise ses usagers doit nécessairement tomber en faillite. C’est ce qui se passe, en ce moment. D’où la nécessité de restituer ses responsabilités donc ses libertés —les deux sont liées — au citoyen prestataire. Il est significatif que les fonctionnaires de la Sécurité sociale utilisent, pour parler de nous, le terme d’assujettis. Nous sommes donc bien en présence d’un système qui asservit les Français.
 Rien là que de nécessaire. L’Etat providence est le produit d’une idéologie qui conjugue l’individualisme et le collectivisme. En U.R.S.S.,le collectivisme déchaîne l’individualisme, chacun se débrouillant grâce au travail noir, à la fraude, à la fauche, à la concussion. Dans le « monde libre », à l’inverse, l’individualisme engendre le collectivisme. Des régimes, d’apparence opposés, marchent à la rencontre les uns des autres. Nationalistes, nous refusons cette dialectique des faux contraires. Nous tenons que tout homme naît héritier. Il possède, en indivision, le patrimoine accumulé au long des âges, par sa tribu, ou sa nation. Certes, il existe des faibles et des puissants, des pauvres et des riches mais d’évidence le petit Français, à sa naissance, reçoit un héritage beaucoup plus précieux que le petit hottentot. Au risque d’être traité de raciste, cela me semble juste. Depuis plus de mille ans, des générations ont travaillé à défricher, à cultiver, à bâtir. Elles ont forgé les instruments intellectuels et matériels du développement technique dont profite aujourd’hui le petit Français. Ce capital accumulé est infiniment supérieur à celui que ses ancêtres ont légués au petit hottentot. L’on y peut rien changer, à moins que le petit hottentot ne s’empare un jour de l’héritage du petit français.
Rien là que de nécessaire. L’Etat providence est le produit d’une idéologie qui conjugue l’individualisme et le collectivisme. En U.R.S.S.,le collectivisme déchaîne l’individualisme, chacun se débrouillant grâce au travail noir, à la fraude, à la fauche, à la concussion. Dans le « monde libre », à l’inverse, l’individualisme engendre le collectivisme. Des régimes, d’apparence opposés, marchent à la rencontre les uns des autres. Nationalistes, nous refusons cette dialectique des faux contraires. Nous tenons que tout homme naît héritier. Il possède, en indivision, le patrimoine accumulé au long des âges, par sa tribu, ou sa nation. Certes, il existe des faibles et des puissants, des pauvres et des riches mais d’évidence le petit Français, à sa naissance, reçoit un héritage beaucoup plus précieux que le petit hottentot. Au risque d’être traité de raciste, cela me semble juste. Depuis plus de mille ans, des générations ont travaillé à défricher, à cultiver, à bâtir. Elles ont forgé les instruments intellectuels et matériels du développement technique dont profite aujourd’hui le petit Français. Ce capital accumulé est infiniment supérieur à celui que ses ancêtres ont légués au petit hottentot. L’on y peut rien changer, à moins que le petit hottentot ne s’empare un jour de l’héritage du petit français.
Défendre l’héritage
français
 Là où le capital existait, même si des retards technologiques l’avaient amoindri, il a suffi de quelques générations, pour rejoindre les Européens et parfois les dépasser.
Là où le capital existait, même si des retards technologiques l’avaient amoindri, il a suffi de quelques générations, pour rejoindre les Européens et parfois les dépasser.
A preuve le Japon, la Corée du Sud, les Chinois de Taiwan et de Singapour, peuples de vieille et riche civilisation. Notre chance reste que la Chine continentale, sombrant dans la barbarie marxiste, n’ait pu devenir le redoutable concurrent qui nous aurait écrasé de son milliard d’hommes. Le sous-développement ne naît pas de l’inégalité des races. Un persan ou un noir du Ghana étaient, au temps de Charlemagne plus riches et plus cultivés qu’un Franc. Ce n’est pas de notre faute si l’Islam a stérilisé ces civilisations. Au train où vont les choses, qui sait si les Français dans un siècle ne seront pas des sous-développés, par rapport à des peuples plus actifs ou mieux gouvernés.
Pour l’instant, le capital existe. Il faut en tirer le meilleur parti et d’abord bien le répartir. Nous partons du principe que les Français sont solidaires. L’emploi du mot par les curés et les instituteurs qui nous oppriment, idéologiquement aussi bien que politiquement, le rend nauséabond. Pour nous, il ne s’agit pas d’un sentiment vague et diffus de fraternité universelle, mais d’un constat. Que la patrie soit plongée dans le malheur, le riche et le puissant s’en tirent mieux que le pauvre et le faible. Tous en souffrent, à l’exception de quelques charognards. Ma génération en a fait l’expérience en juin 40. Fût-il fainéant ou ivrogne, tout Français est le descendant de la cinquantaine de générations qui ont amassé le capital-France. Il a droit, en tant qu’usufruitier d’un patrimoine indivis, à sa part d’intérêt, afin de se soigner, d’élever convenablement ses enfants, de leur donner l’instruction qui leur permettra de gagner leur vie et d’achever son existence de façon décente. Ce droit n’est pas inscrit dans un code divin. Il n’est donc pas imprescriptible car il relève d’un constat économique : actuellement le capital-France produit des intérêts suffisants pour opérer cette distributions d’intérêts, au profit de chaque citoyen.
Instituer le « Capital-Santé »
Distribution d’intérêts et non redistribution de revenus. Dans le cas de l’assurance-maladie, le seul qui nous occupera ici, le système actuel parce qu’il confond tout, se révèle coûteux et compliqué. L’assurance est une chose, l’exercice de la solidarité nationale une autre. La Nation ne pouvant couvrir la totalité du risque, à chacun de s’assurer, comme il l’entend, pour la part qui lui revient. Par contre, une proportion fixée une fois pour toutes du produit intérieur brut (PIB) serait, dans notre système, bloquée pour constituer un « capital santé ». Chaque Français, dès qu’il naît, est intégralement couvert par ce capital santé, et ce à 100%. Il serait ,intolérable qu’un enfant, qui constitue par lui-même le capital le plus précieux, ne reçoive pas tous les soins dont il a besoin. A l’âge de la majorité, le jeune recevra un « compte santé » calculé en fonction de la moyenne des frais médicaux qu’un Français engage au cours de sa vie. Les données statistiques existent. Chacun gérera son compte comme il l’entendra. Certains l’économiseront en vue d’un « coup dur ». D’autres le gaspilleront, en « congés de, maladie » ou en médicaments superflus. Quand le compte sera épuisé avant l’âge fixé par l’espérance de vie que les statistiques attribuent aux Français, tant pis pour –l’imprévoyant. Il se débrouillera comme il pourra, à moins qu’il ne se soit doté personnellement d’une bonne assurance complémentaire. Il va de soi qu’à partir d’un certain âge – 75 ans – la société. comme pour l’enfant, assumera toutes les dépenses. Pour les âges intermédiaires, le compte sera, bien entendu, calculé en fonction des risques, qui grandissent avec les années, mais le principe demeurera le même.
 Grâce aux progrès de l’informatique le compte-santé pourrait se présenter sous la forme d’une carte de crédit qui débiterait immédiatement hôpitaux, médecins et pharmaciens des sommes correspondantes. Mais même si, pour des raisons matérielles, la carte fonctionnait, comme les autres cartes de crédit, le patient ne verserait que le tiers payant, ce système n’exigerait aucun contrôle, aucun intermédiaire bureaucratique. Pas besoin de paperasserie. Le titulaire d’un compte le gérerait en homme responsable. Personne, ni le malade, ni le corps médical, ni l’hôpital n’aurait intérêt au gaspillage. Ces avantages rendent utopique, un tel système dans notre société démocratique. Raison de plus pour le proposer.
Grâce aux progrès de l’informatique le compte-santé pourrait se présenter sous la forme d’une carte de crédit qui débiterait immédiatement hôpitaux, médecins et pharmaciens des sommes correspondantes. Mais même si, pour des raisons matérielles, la carte fonctionnait, comme les autres cartes de crédit, le patient ne verserait que le tiers payant, ce système n’exigerait aucun contrôle, aucun intermédiaire bureaucratique. Pas besoin de paperasserie. Le titulaire d’un compte le gérerait en homme responsable. Personne, ni le malade, ni le corps médical, ni l’hôpital n’aurait intérêt au gaspillage. Ces avantages rendent utopique, un tel système dans notre société démocratique. Raison de plus pour le proposer.
Capital-Santé et immigrés
 Mais objectera-t-on, quelle place faites-vous aux travailleurs étrangers dans votre système ? Celle qui leur revient, en bonne justice. Tout travailleur contribue à créer de la richesse. Dans la mesure où, sa compétence, de l’expérience acquise ou du refus des Français d’accepter certaines tâches rendent nécessaire l’emploi d’un immigré, il est normal qu’il bénéficie des avantages sociaux que cette richesse qu’il contribue à créer permet d’accorder aux Français. Il recevra donc un compte-santé, en fonction de son contrat de travail. Si le contrat est rompu ou non renouvelé, le compte est clos. Par contre, il n’y a aucune raison d’en faire bénéficier sa famille, à laquelle la France ne doit rien. Cc serait d’ailleurs le meilleur service à rendre aux immigrés. Ces–avantages sociaux attirent des étrangers qui entrent clandestinement en France, espérant qu’un emploi ou une inscription frauduleuse leur permettront d’en bénéficier. Et les familles de travailleurs, déracinées, sont promises trop souvent, à l’échec et à la délinquance. Mieux vaudra accorder un mois de congé payé supplémentaire à ces travailleurs —le temps de Ramadan, pour les musulmans. Il serait inhumain de couper des hommes dont nous avons besoin de leurs familles mais à l’inverse, je ne vois pas pourquoi nous nous montrerions plus généreux que l’Algérie, vis-à-vis de nos coopérants. Seul .un contrat de travail, d’une durée minimale de trois ans devrait donner droit à un capital-santé, renouvelable comme lui. Quelques petits boulots de hasard, actuellement permettent aux immigrés d’obtenir des prestations sociales. Ce qui encourage le commerce des passeurs de « travailleurs » clandestins. Ce sont ces prestations qui attirent chez nous les miséreux du monde entier et font de la France un hôpital général à l’échelle de la planète.
Mais objectera-t-on, quelle place faites-vous aux travailleurs étrangers dans votre système ? Celle qui leur revient, en bonne justice. Tout travailleur contribue à créer de la richesse. Dans la mesure où, sa compétence, de l’expérience acquise ou du refus des Français d’accepter certaines tâches rendent nécessaire l’emploi d’un immigré, il est normal qu’il bénéficie des avantages sociaux que cette richesse qu’il contribue à créer permet d’accorder aux Français. Il recevra donc un compte-santé, en fonction de son contrat de travail. Si le contrat est rompu ou non renouvelé, le compte est clos. Par contre, il n’y a aucune raison d’en faire bénéficier sa famille, à laquelle la France ne doit rien. Cc serait d’ailleurs le meilleur service à rendre aux immigrés. Ces–avantages sociaux attirent des étrangers qui entrent clandestinement en France, espérant qu’un emploi ou une inscription frauduleuse leur permettront d’en bénéficier. Et les familles de travailleurs, déracinées, sont promises trop souvent, à l’échec et à la délinquance. Mieux vaudra accorder un mois de congé payé supplémentaire à ces travailleurs —le temps de Ramadan, pour les musulmans. Il serait inhumain de couper des hommes dont nous avons besoin de leurs familles mais à l’inverse, je ne vois pas pourquoi nous nous montrerions plus généreux que l’Algérie, vis-à-vis de nos coopérants. Seul .un contrat de travail, d’une durée minimale de trois ans devrait donner droit à un capital-santé, renouvelable comme lui. Quelques petits boulots de hasard, actuellement permettent aux immigrés d’obtenir des prestations sociales. Ce qui encourage le commerce des passeurs de « travailleurs » clandestins. Ce sont ces prestations qui attirent chez nous les miséreux du monde entier et font de la France un hôpital général à l’échelle de la planète.
 Reste le problème des C.H.U. Il faut que notre pays forme de bons médecins et se tienne à la pointe de la recherche. Ce qui exige de l’argent. Mais il doit venir de l’Etat, qui consentira les efforts nécessaires. Certaines interventions sont très coûteuses, des greffes d’organes par exemple, qu’on ne peut refuser aux malades. Il importe qu’ils n’en supportent, sur leur capital-santé, qu’une part raisonnablement calculée, le principal étant imputé au budget de la recherche. Cet accommodement, d’autres aussi dont la pratique révélera la nécessité, ne sauraient toucher au principe. Chaque Français disposera d’un capital affecté à ses dépenses de santé. Si le PIB croit, ce qui devrait être le cas dans une économie bien gérée. le capital-santé augmente dans la même proportion. S’il diminue, le capital-santé s’amenuise d’autant. Ainsi le citoyen sera responsable vis-à-vis de lui-même, mais aussi de la nation. Il prendra conscience qu’il sera d’autant mieux soigné que le pays sera prospère.
Reste le problème des C.H.U. Il faut que notre pays forme de bons médecins et se tienne à la pointe de la recherche. Ce qui exige de l’argent. Mais il doit venir de l’Etat, qui consentira les efforts nécessaires. Certaines interventions sont très coûteuses, des greffes d’organes par exemple, qu’on ne peut refuser aux malades. Il importe qu’ils n’en supportent, sur leur capital-santé, qu’une part raisonnablement calculée, le principal étant imputé au budget de la recherche. Cet accommodement, d’autres aussi dont la pratique révélera la nécessité, ne sauraient toucher au principe. Chaque Français disposera d’un capital affecté à ses dépenses de santé. Si le PIB croit, ce qui devrait être le cas dans une économie bien gérée. le capital-santé augmente dans la même proportion. S’il diminue, le capital-santé s’amenuise d’autant. Ainsi le citoyen sera responsable vis-à-vis de lui-même, mais aussi de la nation. Il prendra conscience qu’il sera d’autant mieux soigné que le pays sera prospère.
V.- Delenda Schola ?
 Inexorablement, nous nous acheminons vers ce que les sociologues nomment une société duale, une société à deux vitesses, en quelque sorte que préfigure l’Union Soviétique.
Inexorablement, nous nous acheminons vers ce que les sociologues nomment une société duale, une société à deux vitesses, en quelque sorte que préfigure l’Union Soviétique.
Dans le pays du « Socialisme réel », une partie de la population travaille beaucoup et bien. Elle comprend, la « nomenklatura », cette classe de propriétaires collectifs des biens de production, mais aussi tous ceux, officiers, chercheurs, ingénieurs ou ouvriers des arsenaux qui relèvent de la défense nationale. On exige beaucoup d’eux, mais en échange ils disposent, pour eux et leurs familles, d’excellents hôpitaux, d’écoles de bon niveau, de magasins bien garnis, de logements convenables et de « maisons de repos » confortables pour leurs vacances. L’autre partie, largement majoritaire, fait des heures de queue pour acheter un peu de viande, envoie ses enfants dans des établissements scolaires médiocres, et même misérables, dans les campagnes, se soigne dans des hôpitaux mal équipés, où les malades s’entassent dans les couloirs quand les salles communes sont pleines, vit dans des immeubles sans confort, avec la cuisine collective. En échange, elle bénéficie de la sécurité de l’emploi, du droit à la paresse, du laxisme des autorités qui tolèrent le travail noir, la concussion, les petits vols, tous les expédients qui permettent de s’en tirer.
Au contraire de ce qu’imaginent les Occidentaux, les gens s’accommodent très bien de cette situation. Le soviétique moyen sait que, s’il ne fait preuve d’aucune ambition, le KGB le laissera tranquille. A condition de ne pas exagérer, il pillera son entreprise, ou utilisera son autorité de fonctionnaire, si pour toucher des pots de vin sans grand risque. Son existence n’est pas facile, mais il pourra, de temps à autre, faire la fête avec des copains ou, se réfugier dans une ivresse morne. Du moins, évitera-t-il les risques qui pèsent sur ceux qui prétendent s’élever dans l’échelle sociale. Pour quoi envier l’ouvrier des arsenaux, que la moindre malfaçon envoie en prison quand on bâcle impunément sa tâche ? Il y a dans toute société des paresseux, des médiocres et des incapables. Il suffit pour en multiplier le nombre que le système pédagogique soit conçu de façon à sélectionner une élite nécessaire aux besoins vitaux de l’Etat — en URSS, pays impérialiste, l’armement — et se désintéresse des autres.
Prolifération du secteur semi-parasitaire
Le progrès technique tend à chasser les ouvriers des usines, les employés de bureaux, les vendeurs des magasins. Il supprime inexorablement des emplois, au contraire de ce qui s’est passé jusqu’à présent. Le danger ne vient pas du robot, dont la rentabilité n’apparaît que si on la conditionne pour des tâches complexes, mais de l’automation. En France, l’industrie du chocolat n’utilise plus de manœuvres, sinon quelques femmes, chargées de remplir les caisses adressées aux clients. Il en ira de même, demain, dans l’automobile, encore que le gouvernement freine le mouvement, par peur du chômage, au risque de détruire nos entreprises. Les dactylos, les caissières, les comptables disparaîtront. Et l’on peut se demander à quoi serviront les employés de banque quand les transferts de fonds se feront automatiquement, au moyen de cartes informatisées ! Certes, il restera nécessaire de fabriquer les machines, de les surveiller, de les réparer. De nouvelles professions surgissent, dans l’informatique, la communication. Personne ne croit sérieusement que les emplois ainsi créés seront assez nombreux pour compenser ceux appelés à disparaître, d’autant qu’ils exigeront un niveau scolaire élevé. Déjà, au Japon, dans les industries de pointe, 80% des travailleurs ont le niveau du baccalauréat.
 Accepter que des millions d’êtres humains soient réduits, puisqu’à peu près inutilisables, à l’oisiveté et à la délinquance, assistés à grands frais, est intolérable. D’où l’idée de la croissance zéro. On encourage, dans tous les pays industrialisés, la baisse de la natalité, grâce à la libéralisation de l’avortement et à la généralisation de la contraception. Cette politique repose sur des prémisses fausses. Dans une société donnée, il y aura toujours la même proportion d’imbéciles, de fainéants, d’incapables, d’intelligents et d’ambitieux. En réduisant le nombre des naissances on diminue celui des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’économie. Le problème n’est pas résolu. Il est plutôt aggravé puisque l’on risque de manquer d’individus aptes à occuper un emploi. La croissance zéro conduit donc à l’eugénisme. Il faut interdire de se reproduire aux couples présumés incapables d’engendrer des rejetons dont le quotient intellectuel (Q.I.) serait suffisant. Malheureusement, il arrive que les enfants d’individus supérieurs soient des crétins et par chance l’inverse est parfois vrai.
Accepter que des millions d’êtres humains soient réduits, puisqu’à peu près inutilisables, à l’oisiveté et à la délinquance, assistés à grands frais, est intolérable. D’où l’idée de la croissance zéro. On encourage, dans tous les pays industrialisés, la baisse de la natalité, grâce à la libéralisation de l’avortement et à la généralisation de la contraception. Cette politique repose sur des prémisses fausses. Dans une société donnée, il y aura toujours la même proportion d’imbéciles, de fainéants, d’incapables, d’intelligents et d’ambitieux. En réduisant le nombre des naissances on diminue celui des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’économie. Le problème n’est pas résolu. Il est plutôt aggravé puisque l’on risque de manquer d’individus aptes à occuper un emploi. La croissance zéro conduit donc à l’eugénisme. Il faut interdire de se reproduire aux couples présumés incapables d’engendrer des rejetons dont le quotient intellectuel (Q.I.) serait suffisant. Malheureusement, il arrive que les enfants d’individus supérieurs soient des crétins et par chance l’inverse est parfois vrai.
 Une meilleure solution consiste à prétendre qu’il existe deux modes de développement et à persuader l’opinion que ceux qui préfèrent travailler le moins possible, s’occuper à des tâches marginales telle que l’élevage des caprins dans les Cévennes ou se consacrer à leur « créativité » relèvent d’un mode de développement aussi nécessaire que celui adopté jusqu’alors par l’Occident. Cela ne relève pas de la plaisanterie. Je me contente de résumer le rapport de M. Roustang pour le 1Xme plan, publié sous le titre « changement des modes de vie », avec une préface d’un député socialiste, M. Claude Even. Selon cet éminent technocrate « le problème ne sera peut-être pas de produire plus de richesses mais de permettre à . chacun d’avoir des activités qui assurent son insertion sociale et son développement personnel », mais comme l’expérience prouve que si l’on ne produit pas plus de richesses, ce qui est le cas en ce moment, l’argent manque, on distinguera deux secteurs, le secteur macro-international, soumis aux exigences du marché mondial et l’autre, micro-local, où l’on fournira aux parasites une activité épanouissante encore que médiocrement rentable. Sa grande difficulté reste de persuader les bénéficiaires qu’ils travailleront peu mais seront moins payés.
Une meilleure solution consiste à prétendre qu’il existe deux modes de développement et à persuader l’opinion que ceux qui préfèrent travailler le moins possible, s’occuper à des tâches marginales telle que l’élevage des caprins dans les Cévennes ou se consacrer à leur « créativité » relèvent d’un mode de développement aussi nécessaire que celui adopté jusqu’alors par l’Occident. Cela ne relève pas de la plaisanterie. Je me contente de résumer le rapport de M. Roustang pour le 1Xme plan, publié sous le titre « changement des modes de vie », avec une préface d’un député socialiste, M. Claude Even. Selon cet éminent technocrate « le problème ne sera peut-être pas de produire plus de richesses mais de permettre à . chacun d’avoir des activités qui assurent son insertion sociale et son développement personnel », mais comme l’expérience prouve que si l’on ne produit pas plus de richesses, ce qui est le cas en ce moment, l’argent manque, on distinguera deux secteurs, le secteur macro-international, soumis aux exigences du marché mondial et l’autre, micro-local, où l’on fournira aux parasites une activité épanouissante encore que médiocrement rentable. Sa grande difficulté reste de persuader les bénéficiaires qu’ils travailleront peu mais seront moins payés.
 Le secteur macro-international sera chargé de nourrir l’autre. En échange, il sera assuré de la paix sociale, les fainéants et les incapables étant valorisés à leurs propres yeux, ce qui les fera tenir tranquilles. Le Japon montre le chemin. Une élite travaille pour les trusts, qui possèdent leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs agences de voyage à prix réduit. Pas besoin de magasins spéciaux comme en URSS puisque la pénurie n’existe pas. Les gens qui préféreront le secteur micro-local se contenteront d’établissements scolaires ou hospitaliers de seconde zone, gérés par la collectivité. Par contre, le nombre d’heures de travail sera réduit. Les quinze chaînes de télévision se peupleront d’inutiles qui donneront libre cours à leur créativité, afin de meubler les heures creuses. Des tâches d’animation des quartiers, de protection de l’environnement, de conseil en tout et rien absorberont le surplus. Quand il s’agit d’inventer des emplois non rentables, l’imagination prend le pouvoir. L’essentiel c’est d’occuper le plus de gens possible à ne rien faire (ou à faire des choses pour lesquelles nul n’accepterait de payer). Ce qui éviterait le chômage tout en ne coûtant guère plus, les allocations se transformant en rémunérations. L’augmentation rapide de la productivité dans le secteur macro-international, grâce à l’élimination des inutiles, à l’automation et à la sélection des meilleurs professionnels permettrait à la collectivité de supporter le poids économique du secteur micro-local. On payerait une partie de la population pour qu’elle n’empêche pas l’autre de travailler. Tel est, sous un habillage pompeux, l’objectif dont le IXme plan amorce la réalisation.
Le secteur macro-international sera chargé de nourrir l’autre. En échange, il sera assuré de la paix sociale, les fainéants et les incapables étant valorisés à leurs propres yeux, ce qui les fera tenir tranquilles. Le Japon montre le chemin. Une élite travaille pour les trusts, qui possèdent leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs agences de voyage à prix réduit. Pas besoin de magasins spéciaux comme en URSS puisque la pénurie n’existe pas. Les gens qui préféreront le secteur micro-local se contenteront d’établissements scolaires ou hospitaliers de seconde zone, gérés par la collectivité. Par contre, le nombre d’heures de travail sera réduit. Les quinze chaînes de télévision se peupleront d’inutiles qui donneront libre cours à leur créativité, afin de meubler les heures creuses. Des tâches d’animation des quartiers, de protection de l’environnement, de conseil en tout et rien absorberont le surplus. Quand il s’agit d’inventer des emplois non rentables, l’imagination prend le pouvoir. L’essentiel c’est d’occuper le plus de gens possible à ne rien faire (ou à faire des choses pour lesquelles nul n’accepterait de payer). Ce qui éviterait le chômage tout en ne coûtant guère plus, les allocations se transformant en rémunérations. L’augmentation rapide de la productivité dans le secteur macro-international, grâce à l’élimination des inutiles, à l’automation et à la sélection des meilleurs professionnels permettrait à la collectivité de supporter le poids économique du secteur micro-local. On payerait une partie de la population pour qu’elle n’empêche pas l’autre de travailler. Tel est, sous un habillage pompeux, l’objectif dont le IXme plan amorce la réalisation.
 Il existe un précédent historique. La plèbe romaine fut entretenue aux frais des provinces. Ce qui assura la paix civile. D’Auguste à Sévère Alexandre, l’Empire connut des putschs militaires qu’une bataille arbitrait, à l’occasion, mais les populations n’en étaient guère affectées. Rien de commun avec les atroces proscriptions qui, de Sulla à César, décimèrent l’aristocratie et les classes moyennes. Est-il raisonnable de fournir du pain et des jeux aux plèbes modernes ? Le rapport Even a le mérite de poser la question. La société, selon lui, se désagrégera « si nous ne savons pas trouver des substituts ou des compléments au travail salarié et aux échanges marchands dans leur rôle d’intégration sociale des individus ». M. Roustang se demande même si l’une des causes de la crise ne doit pas être cherchée dans la modification des modes de vie. L’ébranlement de mai 68 n’aurait pas fini de produire ses effets. Les profondes lézardes qu’il avait provoquées dans l’édifice social se seraient élargies avec le temps au point qu’il menacerait de s’écrouler.
Il existe un précédent historique. La plèbe romaine fut entretenue aux frais des provinces. Ce qui assura la paix civile. D’Auguste à Sévère Alexandre, l’Empire connut des putschs militaires qu’une bataille arbitrait, à l’occasion, mais les populations n’en étaient guère affectées. Rien de commun avec les atroces proscriptions qui, de Sulla à César, décimèrent l’aristocratie et les classes moyennes. Est-il raisonnable de fournir du pain et des jeux aux plèbes modernes ? Le rapport Even a le mérite de poser la question. La société, selon lui, se désagrégera « si nous ne savons pas trouver des substituts ou des compléments au travail salarié et aux échanges marchands dans leur rôle d’intégration sociale des individus ». M. Roustang se demande même si l’une des causes de la crise ne doit pas être cherchée dans la modification des modes de vie. L’ébranlement de mai 68 n’aurait pas fini de produire ses effets. Les profondes lézardes qu’il avait provoquées dans l’édifice social se seraient élargies avec le temps au point qu’il menacerait de s’écrouler.
 Il me semble que les choses se sont passées de façon un peu différente. Une jeunesse qui s’ennuyait s’est lancée dans un gigantesque sociodrame.
Il me semble que les choses se sont passées de façon un peu différente. Une jeunesse qui s’ennuyait s’est lancée dans un gigantesque sociodrame.
Elle a mimé la Révolution, grand jeu non sanglant qui exprimait le besoin d’un défoulement collectif. Ritualisées dans les sociétés traditionnelles par les saturnales, le carnaval, toutes ces dérisions de l’ordre, qui restituaient le chaos primitif, le temps d’une fête, relevaient d’une saine hygiène sociale, tout comme ces cérémonies pénitentielles, suscitées jadis par les prédicateurs, pendant lesquelles la peur de l’enfer, habilement exploitée, permettait à une ville tout entière de se libérer des péchés. La fin de la guerre d’Algérie, qui avait privé les étudiants d’un prétexte vertueux pour s’agiter, les livrait à la banalité. Ils ont cherché un dérivatif. Rien de plus, quoi que nous ayons pu en écrire, les uns et les autres. A preuve, aux Etats-Unis, le mouvement s’est lui aussi produit alors que la bataille pour « l’intégration raciale » était terminée.
 La petite peur des adultes, dénoncée, non sans courage, par Raymond Aron, eut des conséquences beaucoup plus graves. Les professeurs, les députés, les pères signèrent leur acte d’abdication, tout comme Charles X en 1830, qui aurait conservé son trône s’il avait accepté de faire couler le sang, mais pour des raisons moins nobles. Ils ont aboli un système éducatif fondé sur le respect de la hiérarchie du savoir, la sélection et l’effort. Certes, il fallait le réformer. Il avait vieilli et sans doute répondait-il mal à la nécessité de former rapidement des cadres pour une économie en pleine expansion. L’afflux des étudiants l’avait désorganisé. On avait embauché à tour de bras des assistants sans trop se préoccuper de leur qualification. Au bas de .l’échelle, les choses s’étaient aussi mal passées. Le recrutement d’instituteur était devenu si urgent, du fait d’une poussée démographique dont des gouvernements imprévoyants ne s’étaient souciés que trop tard pour y trouver des solutions efficaces, qu’on avait pris n’importe quel bachelier, sans se préoccuper de lui fournir une formation pédagogique.
La petite peur des adultes, dénoncée, non sans courage, par Raymond Aron, eut des conséquences beaucoup plus graves. Les professeurs, les députés, les pères signèrent leur acte d’abdication, tout comme Charles X en 1830, qui aurait conservé son trône s’il avait accepté de faire couler le sang, mais pour des raisons moins nobles. Ils ont aboli un système éducatif fondé sur le respect de la hiérarchie du savoir, la sélection et l’effort. Certes, il fallait le réformer. Il avait vieilli et sans doute répondait-il mal à la nécessité de former rapidement des cadres pour une économie en pleine expansion. L’afflux des étudiants l’avait désorganisé. On avait embauché à tour de bras des assistants sans trop se préoccuper de leur qualification. Au bas de .l’échelle, les choses s’étaient aussi mal passées. Le recrutement d’instituteur était devenu si urgent, du fait d’une poussée démographique dont des gouvernements imprévoyants ne s’étaient souciés que trop tard pour y trouver des solutions efficaces, qu’on avait pris n’importe quel bachelier, sans se préoccuper de lui fournir une formation pédagogique.
D’où une dévalorisation de la fonction enseignante, mal payée, mal recrutée, mal respectée. C’est à ce niveau qu’il aurait fallu agir. Or, financièrement, l’éducation nationale a été sacrifiée. par démagogie. à la santé publique. On a construit des hôpitaux, souvent luxueux, formé de nombreux médecins, laissé les dépenses médicales augmenter démesurément sans songer qu’il convenait, si l’on voulait que la nation puisse supporter les charges financières que cela impliquait, répartir l’effort de façon plus équitable, en faveur de l’université. L’on a misé sur le présent, la santé, en négligeant l’avenir, l’enseignement.
L’éducation nationale
sacrifiée.
 La véritable leçon de mai 68 était là, dans cette angoisse d’une jeunesse, encore nombreuse, devant l’avenir. Les adultes capitulards se sont lancés dans des « réformes ». Mal appliquée dans ce qu’elle avait de bon, la réforme d’Edgar Faure ne le fut que dans ses aspects franchement néfastes. Quant ik la réforme Haby, sortie du rapport Langevin-Wallon, d’inspiration marxiste, elle s’est révélée désastreuse. Il suffit d’énumérer les conséquences. Au niveau du primaire : des méthodes pédagogiques grotesques (les activités d’éveil), les classes trop nombreuses, la présence d’une proportion excessive d’immigrés qui auraient dû bénéficier d’un enseignement différent peut-être bilingue. Tant qu’à scolariser le petit arabe qu’on ne l’arrache pas à sa culture familiale, en étant incapable de l’intégrer à la nôtre. A ce jeu, l’on saccage toute une génération, dans les quartiers à forte densité d’immigrés. Comment apprendre à lire à des enfants quand la classe rassemble trente ethnies pour trente-cinq élèves ? Le déchet est si élevé que l’on commence à s’en inquiéter. A la sortie du primaire, 25% des effectifs ne maitrisent ni la lecture, ni l’écriture. Ne parlons pas de l’orthographe. Quant aux rudiments d’histoire et de géographie, réduits au rang d’activités d’éveil, ils ne sont assimilés, que par un enfant sur six.
La véritable leçon de mai 68 était là, dans cette angoisse d’une jeunesse, encore nombreuse, devant l’avenir. Les adultes capitulards se sont lancés dans des « réformes ». Mal appliquée dans ce qu’elle avait de bon, la réforme d’Edgar Faure ne le fut que dans ses aspects franchement néfastes. Quant ik la réforme Haby, sortie du rapport Langevin-Wallon, d’inspiration marxiste, elle s’est révélée désastreuse. Il suffit d’énumérer les conséquences. Au niveau du primaire : des méthodes pédagogiques grotesques (les activités d’éveil), les classes trop nombreuses, la présence d’une proportion excessive d’immigrés qui auraient dû bénéficier d’un enseignement différent peut-être bilingue. Tant qu’à scolariser le petit arabe qu’on ne l’arrache pas à sa culture familiale, en étant incapable de l’intégrer à la nôtre. A ce jeu, l’on saccage toute une génération, dans les quartiers à forte densité d’immigrés. Comment apprendre à lire à des enfants quand la classe rassemble trente ethnies pour trente-cinq élèves ? Le déchet est si élevé que l’on commence à s’en inquiéter. A la sortie du primaire, 25% des effectifs ne maitrisent ni la lecture, ni l’écriture. Ne parlons pas de l’orthographe. Quant aux rudiments d’histoire et de géographie, réduits au rang d’activités d’éveil, ils ne sont assimilés, que par un enfant sur six.
Au niveau du secondaire, le « tronc commun » aboutit à livrer les classes qui décident du développement intellectuel de Tenfant, la sixième, la cinquième et la quatrième, aux « professeurs d’enseignement général » (PEG), des instituteurs dont les méthodes ne conviennent qu’à la formation de cadres subah ternes, ce qui était effectivement le rôle, dans le passé, du « primaire supérieur »: Elles ne permettent ni de cultiver l’esprit critique, ni de favoriser la curiosité d’esprit.
Dans les classes supérieures, les professeurs se heurtent à des adolescents qui manquent des bases indispensables et du goût de l’étude. Le laxisme de l’administration, l’absence de discipline font le reste. Ne parlons pas de l’enseignement technique.
Dans trop de cas la médiocrité d’un personnel peu ou mal qualifié, la vétusté du matériel et l’inadéquation des formations condamnent les petits malheureux, que l’on y exile, à se retrouver à seize ans sans métier et, trop souvent, sans désir d’en acquérir.
M. Savary se prépare à donner le coup de grâce à l’enseignement supérieur. Faute de sélection à l’entrée que d’étudiants choisissent des filières qui ne mènent à rien. A quoi peut bien servir la « scénique », sinon à passer le temps ? Le promoteur de cette « spécialité » M. Bernard Dort, qui l’enseigne en Sorbonne, explique qu’elle ne forme pas des metteurs en scène, comme on pourrait l’imaginer, mais des gens capables de réfléchir sur la mise en scène, de purs théoriciens, à l’image de leur maître. Que fera-t-on d’eux ? Tous ne pourront pas écrire dans le Monde des articles obscurément pédants, comme le fait M. Dort. Certes, ce cas reste extrême. Il illustre, néanmoins, la manière dont se fabrique un prolétariat intellectuel, arrogant et ignorant, qu’il faut bien employer, grâce aux maisons de la culture, à « la vie associative », à « l’animation » et autres fanfreluches coûteuses et parfaitement inutiles.
Le peuple travailleur exploité par le peuple paresseux
 Ainsi l’Université, de l’analphabète au diplômé, en passant par la dactylo, forme une quantité sans cesse croissante d’individus qui ne peuvent trouver preneur sur le marché du travail et, d’ordinaire, s’en montrent plutôt satisfaits. Cette plèbe moderne réclame, comme l’antique, du pain et des jeux. Il ne faut pas se faire d’illusions, elle a cessé d’être cette écume qui se forme sur les marges des sociétés. Elle tend à devenir majoritaire puisque notre système scolaire vise, de moins en moins, à donner aux jeunes la capacité intellectuelle et morale, d’être employés dans une économie, qui exige toujours plus de personnel qualifié.
Ainsi l’Université, de l’analphabète au diplômé, en passant par la dactylo, forme une quantité sans cesse croissante d’individus qui ne peuvent trouver preneur sur le marché du travail et, d’ordinaire, s’en montrent plutôt satisfaits. Cette plèbe moderne réclame, comme l’antique, du pain et des jeux. Il ne faut pas se faire d’illusions, elle a cessé d’être cette écume qui se forme sur les marges des sociétés. Elle tend à devenir majoritaire puisque notre système scolaire vise, de moins en moins, à donner aux jeunes la capacité intellectuelle et morale, d’être employés dans une économie, qui exige toujours plus de personnel qualifié.
 Le moment vient où cette plèbe coûtera tellement cher à entretenir, d’autant qu’il ne suffit plus de la nourrir et de l’amuser, mais qu’elle se constitue en secteur économique sans préoccupation de rentabilité ou de productivité, que le secteur productif s’effondrera. On peut se demander d’ailleurs si ce secteur productif trouvera longtemps des candidats à l’embauche. Il est tellement plus amusant d’être « animateur » qu’ingénieur, joueur de banjo que technicien. Rendu à ce point, système scolaire ne peut plus être réformé. A quoi servirait d’ailleurs d’ajouter une réforme, même contraire, à toutes les autres. Il faut le détruire, de fond en –comble. Delenda Schola !
Le moment vient où cette plèbe coûtera tellement cher à entretenir, d’autant qu’il ne suffit plus de la nourrir et de l’amuser, mais qu’elle se constitue en secteur économique sans préoccupation de rentabilité ou de productivité, que le secteur productif s’effondrera. On peut se demander d’ailleurs si ce secteur productif trouvera longtemps des candidats à l’embauche. Il est tellement plus amusant d’être « animateur » qu’ingénieur, joueur de banjo que technicien. Rendu à ce point, système scolaire ne peut plus être réformé. A quoi servirait d’ailleurs d’ajouter une réforme, même contraire, à toutes les autres. Il faut le détruire, de fond en –comble. Delenda Schola !
VI. – LA GAUCHE FAINEANTE
 A mesure que se met en place la société duale, toutes les nations, et pas seulement la française, se divisent en deux peuples, un peuple fainéant, la plèbe, et un peuple travailleur.
A mesure que se met en place la société duale, toutes les nations, et pas seulement la française, se divisent en deux peuples, un peuple fainéant, la plèbe, et un peuple travailleur.
Le peuple fainéant ne subsiste que grâce au peuple travailleur. Abandonné à son sort, il serait incapable de gagner son pain et même d’organiser ses jeux. En montre-t-il de la reconnaissance ? Non point. Il s’efforce de le spolier, s’emparant pour en jouir, d’une part croissante des profits des entreprises et des « hauts revenus », en fait les salaires de l’ensemble des producteurs, ouvriers, cadres ou patrons. Comme cela ne lui suffit pas, il l’humilie, soutenant que les « nouveaux modes de vie » sont seuls conformes à la dignité de l’homme. Il est remarquable que l’épiscopat français ait fourni la plus arrogante des justifications idéologiques au peuple fainéant. L’église est passée du côté de la plèbe moderne qu’elle identifie, par une aberration intellectuelle assez surprenante, au « peuple des pauvres », étrange retournement d’une religion qui n’a triomphé, historiquement, qu’en s’identifiant, dans la Rome antique, au peuple travailleur !
Le peuple fainéant vote à gauche
En gros, les clivages politiques tendent à reproduire cette division. Le peuple fainéant vote à gauche et le peuple travailleur à droite. Si le socialisme l’a emporté en 1981, c’est que la plèbe, depuis l’avènement de la Ve République n’a cessé de grossir. Elle est quasi-majoritaire, désormais. Néanmoins tout pouvoir, fût-il socialiste, doit ménager le peuple travailleur. Si celui-ci se met à se croiser les bras, il ne sera plus possible de nourrir et d’amuser la plèbe. Celle-ci se montre déçue et se réfugie dans l’abstention et surtout les couches ouvrières du peuple travailleur, qui, par solidarité de classe ou endoctrinement idéologique, votaient communiste, commencent à rejoindre leur camp. D’où les succès électoraux de M. Le Pen, qui ne s’expliquent nullement par le « racisme » mais par le fait que dans les quartiers ouvriers, les immigrés forment le gros de la plèbe.
La gauche ne se sauvera qu’à condition de reprendre sa place naturelle, l’opposition. En effet la droite au pouvoir accordera beaucoup plus facilement qu’un gouvernement socialiste des faveurs à la plèbe puisque le peuple travailleur pour éviter un retour de la gauche au pouvoir consentira des sacrifices qu’il refuse à M. Mitterrand. Ce qui nous place dans une situation paradoxale : quasi-majoritaire dans le pays, le peuple fainéant doit accepter d’être gouverné par les représentants du peuple travailleur, s’il veut continuer de le spolier et de le brocarder. Mais la tension risque de monter, du fait de la fraction ouvrière ralliée à M. Le Pen en raison du phénomène de promiscuité. Un cadre supérieur, vivant dans un quartier « bourgeois », acceptera plus facilement d’entretenir une plèbe lointaine qu’un petit technicien, soucieux de promotion sociale pour lui-même et ses enfants, dont les voisins s’engraissent à ses dépens, l’empêchant d’atteindre son objectif, une maison individuelle, par exemple. A l’inverse de ce que prétend M. Chirac, l’émergence d’une droite populaire, correspondant à 10 % du corps électoral, risque de devenir une donnée permanente du jeu politique.
Vers un système
soviétique ?
 Théoriquement, la société duale devrait engendrer un système assez voisin du soviétique, encore que doté d’une idéologie de « droite ». Seul un pouvoir fort sera capable de contenir dans des limites raisonnables les prétentions de la plèbe. Certes, il convient de se méfier des comparaisons historiques. Cependant, le véritable créateur du césarisme ne fut pas César mais Octave. Héritier du vieux parti plébéien, il sut conserver une fraction des césariens tout en s’alliant contre le véritable successeur de son oncle, Antoine, au parti conservateur. Il est incontestable qu’il existe en France une tradition césarienne, dont se réclament MM. Chirac et Le Pen. Leur grande faiblesse, c’est d’être classés à droite, l’un et l’autre. Un Doriot, né trop tôt pour son malheur, aurait été l’homme de la situation. En effet, la fraction ouvrière du peuple travailleur est communiste. Les « déçus du socialisme » appartiennent au peuple fainéant. Ils ne représentent qu’un intérêt électoral. Mieux vaudrait miser sur les « déçus du communisme ». Se trouvera-t-il un Doriot ou si l’on préfère un Mussolini ? J’imagine que M. Chevènement ne répugnerait pas à jouer ce rôle mais a-t-il assez de culot ? Un énarque est mal préparé à ce genre d’aventure. Mais il n’existe pas d’exemple qu’une fonction historique ne trouve pas un homme pour l’incarner. Seul, en tous cas, un aventurier, venu de la gauche, avec des bataillons ouvriers peut fédérer la France travailleuse, dans le cadre démocratique de la lutte de deux peuples.
Théoriquement, la société duale devrait engendrer un système assez voisin du soviétique, encore que doté d’une idéologie de « droite ». Seul un pouvoir fort sera capable de contenir dans des limites raisonnables les prétentions de la plèbe. Certes, il convient de se méfier des comparaisons historiques. Cependant, le véritable créateur du césarisme ne fut pas César mais Octave. Héritier du vieux parti plébéien, il sut conserver une fraction des césariens tout en s’alliant contre le véritable successeur de son oncle, Antoine, au parti conservateur. Il est incontestable qu’il existe en France une tradition césarienne, dont se réclament MM. Chirac et Le Pen. Leur grande faiblesse, c’est d’être classés à droite, l’un et l’autre. Un Doriot, né trop tôt pour son malheur, aurait été l’homme de la situation. En effet, la fraction ouvrière du peuple travailleur est communiste. Les « déçus du socialisme » appartiennent au peuple fainéant. Ils ne représentent qu’un intérêt électoral. Mieux vaudrait miser sur les « déçus du communisme ». Se trouvera-t-il un Doriot ou si l’on préfère un Mussolini ? J’imagine que M. Chevènement ne répugnerait pas à jouer ce rôle mais a-t-il assez de culot ? Un énarque est mal préparé à ce genre d’aventure. Mais il n’existe pas d’exemple qu’une fonction historique ne trouve pas un homme pour l’incarner. Seul, en tous cas, un aventurier, venu de la gauche, avec des bataillons ouvriers peut fédérer la France travailleuse, dans le cadre démocratique de la lutte de deux peuples.
 Très curieusement un travailliste anglais professeur à Cambridge, Michael Young, dans un livre publié en 1958, « Therise of méritocraty » (l’ascension de la méritocratie) a construit un scénario du futur assez séduisant. Une société démocratique doit, selon lui, fonder le pouvoir sur le mérite et non sur l’hérédité ou la chance. La guerre économique devenant impitoyable une nation ne survivra que si elle sélectionne, de façon scientifique, les futurs talents, à quelque classe qu’ils appartiennent par la naissance.
Très curieusement un travailliste anglais professeur à Cambridge, Michael Young, dans un livre publié en 1958, « Therise of méritocraty » (l’ascension de la méritocratie) a construit un scénario du futur assez séduisant. Une société démocratique doit, selon lui, fonder le pouvoir sur le mérite et non sur l’hérédité ou la chance. La guerre économique devenant impitoyable une nation ne survivra que si elle sélectionne, de façon scientifique, les futurs talents, à quelque classe qu’ils appartiennent par la naissance.
D’où la nécessité de détecter dès que possible les enfants dont le quotient intellectuel (Q.I.) dépasse 100, de les placer dans des écoles spéciales, de les former grâce aux meilleurs professeurs et de leur donner les postes dirigeants. Le reste, repoussé dans les « basses classes » disposera du SMIC, qu’il pourra améliorer, soit en acceptant les activités manufacturières résiduelles ou des fonctions domestiques, destinées à décharger l’élite des tâches serviles. Il restera aux basses classes l’espoir d’avoir un enfant auquel son Q.I permettra d’accéder à un poste dirigeant. Ce qui les aidera à supporter leur médiocrité, en satisfaisant leur passion de l’égalité.
Il est assurément enfantin de fonder comme le travailliste Young ou, à l’opposé de l’éventail idéologique, notre « nouvelle droite », la sélection sur le Q.I. Cette notion pseudo scientifique relève de l’imposture. L’intelligence ne se calcule pas. En fait, il s’agit d’une batterie de tests, conçus à partir d’un échantillon d’individus particulièrement efficaces, donc d’un système de valeurs lié à notre modèle de développement. Les facteurs culturels entrent en ligne de compte au moins autant que les facteurs génétiques. Ainsi « la nouvelle droite » constate que le Q.I des noirs est, en moyenne, inférieur à celui des blancs. Cependant lorsqu’il s’agit de familles également intégrées à notre culture, qui ont, de ce fait, assimilé le système de valeurs dont dépend le Q.I, la proportion devient pratiquement identique, quelle que soit la couleur de la peau. D’autres éléments jouent. Un fou peut avoir un Q.I élevé. Il faudrait éliminer, pour obtenir l’égalité des chances les facteurs psychologiques, pédagogiques, familiaux, dont certains s’exercent dès la petite enfance et même pendant la vie fœtale, de façon décisive. Tant d’éléments entrent en jeu qu’il est délirant de tout réduire à la génétique. Ceci dit, la sélection s’imposera, de plus en plus durement dans la société qui se construit sous nos yeux et l’on doit reconnaître, avec le professeur Schwartz, qu’elle se fera, de toute façon, par l’école ou par la vie. Mieux vaut qu’elle se fasse par l’école, ce qui permet d’orienter à temps les jeunes.
Reprenons les données du problème.
 De plus en plus, les hommes seront chassés du processus productif. Le phénomène n’est pas nouveau. Jusqu’à présent, il était corrigé par le développement du tertiaire (emplois de bureau et commerce). A son tour, le tertiaire réduit le nombre des emplois disponibles. Reste le quaternaire, secteur en expansion (enseignement, recherche et communication). Il produit et exploite la principale matière première du siècle à venir, la matière grise. Il exige de ce fait une main-d’œuvre hautement qualifiée et d’une grande conscience professionnelle. On le voit, la difficulté intervient, effectivement, au niveau des capacités. Il existe des individus qui trouvaient du travail dans le secteur industriel ou dans le tertiaire et qu’il faudra occuper. Ils ne sont pas nécessairement stupides mais inaptes aux études, ils perdent leur temps à l’école. Leur donner une instruction primaire suffit, à condition de développer leurs autres qualités. Trois secteurs semblent porteurs d’emplois : la protection sociale, les métiers de luxe, l’aide familiale. Notre société, est fragile. Elle le sera de plus en plus. Aussi a-t-elle besoin de gardiens. Les qualités morales, le courage, la loyauté, le dévouement importent à ce niveau, bien davantage que le quotient intellectuel. De même, l’élite tendra à augmenter, puisqu’il faudra un nombre croissant de cadres supérieurs, de savants et d’ingénieurs. D’où des débouchés pour les métiers de luxe. Enfin, il faudra trouver des aides ménagères, des gardes d’enfants pour répondre aux besoins des femmes à haut quotient intellectuel que le secteur quaternaire recrute. Le chômage des laissés-pour-compte des techniques nouvelles n’a rien d’inévitable et la société duale pas davantage.
De plus en plus, les hommes seront chassés du processus productif. Le phénomène n’est pas nouveau. Jusqu’à présent, il était corrigé par le développement du tertiaire (emplois de bureau et commerce). A son tour, le tertiaire réduit le nombre des emplois disponibles. Reste le quaternaire, secteur en expansion (enseignement, recherche et communication). Il produit et exploite la principale matière première du siècle à venir, la matière grise. Il exige de ce fait une main-d’œuvre hautement qualifiée et d’une grande conscience professionnelle. On le voit, la difficulté intervient, effectivement, au niveau des capacités. Il existe des individus qui trouvaient du travail dans le secteur industriel ou dans le tertiaire et qu’il faudra occuper. Ils ne sont pas nécessairement stupides mais inaptes aux études, ils perdent leur temps à l’école. Leur donner une instruction primaire suffit, à condition de développer leurs autres qualités. Trois secteurs semblent porteurs d’emplois : la protection sociale, les métiers de luxe, l’aide familiale. Notre société, est fragile. Elle le sera de plus en plus. Aussi a-t-elle besoin de gardiens. Les qualités morales, le courage, la loyauté, le dévouement importent à ce niveau, bien davantage que le quotient intellectuel. De même, l’élite tendra à augmenter, puisqu’il faudra un nombre croissant de cadres supérieurs, de savants et d’ingénieurs. D’où des débouchés pour les métiers de luxe. Enfin, il faudra trouver des aides ménagères, des gardes d’enfants pour répondre aux besoins des femmes à haut quotient intellectuel que le secteur quaternaire recrute. Le chômage des laissés-pour-compte des techniques nouvelles n’a rien d’inévitable et la société duale pas davantage.
A ce niveau, la difficulté peut être surmontée. Demain comme hier, celui qui voudra travailler le pourra, à condition d’accepter un emploi à sa mesure et de ne pas avoir des prétentions financières excessives. Engager des soldats et des policiers, encourager les métiers d’art et revaloriser les fonctions domestiques, actuellement abandonnées aux femmes immigrées permettraient de résorber le chômage structurel. Mais qu’adviendra-t-il du peuple fainéant ? Jadis il se recrutait en haut (les riches oisifs) et au bas de l’échelle sociale (les malfaiteurs professionnels). Maintenant, on en trouve dans tous les milieux et surtout parmi les jeunes. Qu’on le veuille ou pas, la société duale dont rêve la gauche utopiste et l’Episcopat engendrera un régime de type soviétique, même paré d’une idéologie de « droite ». On n’évitera pas cette dérive par des incantations sur le thème des droits de l’homme ou par des manipulations politiciennes. Le peuple travailleur en a ras le bol, du peuple fainéant et le moment viendra nécessairement ou cette irritation se transformera en volonté. Une dictature assurera la simple survie de la plèbe, et fournira aux producteurs une protection efficace de leurs revenus et de leur rôle dominant. Royalistes, traditionnalistes nous refusons un tel régime qui achèverait la destruction des libertés.
Combattre les causes
de la fainéantise
Il faut s’attaquer aux causes de la fainéantise. C’est l’école, aujourd’hui, qui est devenue le pourrissoir de la société, sinon le seul, du moins le principal. Trop de jeunes s’ennuient. Ils considèrent qu’ils perdent leur temps. Ils l’emploient comme ils peuvent, drogue, petite délinquance, promiscuité sexuelle. Les professeurs ne se portent pas mieux. Beaucoup craquent. C’est la dépression. D’autres, découragés, baissent les bras. Qui s’étonnerait que cent mille garçons et filles sortent chaque année du système scolaire sans la moindre formation, à peine alphabétisés et, ce qui paraît pire encore, à jamais dégoûtés du travail !
Il convient d’en finir avec le funeste « tronc commun ». Nous avons besoin d’un primaire qui apprenne le rudiment et forge la conscience morale, dont nul ne sortirait qui ferait plus de cinq fautes dans sa dictée ; d’un primaire supérieur pour les intelligences sans éclat mais besogneuses, appliquées, que les intellos méprisent mais si
attachées au réel qu’elles fournirent à la France une administration que l’Europe avait de bonnes raisons de nous envier, en un temps où nos trains arrivaient à l’heure et où une lettre mise à six heures du soir à Marseille était distribuée à Paris le lendemain matin ; un secondaire où l’adolescent découvrirait l’austère plaisir d’un raisonnement sans failles, la compagnie des hommes illustres et la belle architecture d’un plan en trois parties. L’aptitude à raisonner vite et bien, à exprimer sa pensée de façon claire, à s’adapter à d’autres mécaniques intellectuelles constitue la clé du succès.
Ceci dit, il ne s’agit nullement de revenir au passé. De plus en plus, l’apprentissage doit être distingué de l’éducation. Tout apprentissage est répétitif. Il doit donner des réflexes conditionnés. Cela vaut pour la lecture, l’écriture, le calcul comme pour la haute mathématique ou le tournage d’une pièce. A chaque âge, à chaque niveau d’enseignement, la maîtrise de l’outil, manuel ou intellectuel, s’acquiert par l’effort. La grande erreur de notre système consiste à s’imaginer que les connaissances relèvent, de l’apprentissage. D’où des programmes démentiels. L’effort exigé des jeunes étant trop intense se relâche. Je ne donnerai qu’un exemple, emprunté à l’actualité, qui relève de ma compétence, celui de l’enseignement de l’histoire. Il est évident que si l’on prétend fournir aux élèves des connaissances historiques vraiment sérieuses, il faut beaucoup de temps, si bien qu’on est tombé dans l’excès inverse, et l’enseignement de l’histoire a été progressivement réduit à de vagues notions. Les élèves ont besoin de repères chronologiques très précis, imprimés dans la mémoire par la répétition. Sans ces béquilles, ils seront incapables de trier, par la suite, dans le flux de connaissances disparates que leur fourniront les médias. Pour le reste, l’important c’est de leur donner le goût de l’histoire, la vraie, qui n’est pas un catalogue de dates mais la compréhension du passé. Fournir une méthode et susciter l’intérêt tels sont les critères de l’enseignement et non l’accumulation d’un savoir, de plus en plus vite périmé. Que dès le primaire les enfants apprennent à jouer avec l’ordinateur, tant mieux, si l’ordinateur qu’est leur cerveau a été bien préparé par l’apprentissage des techniques intellectuelles fondamentales. Bien sûr, un lycéen de terminale disposera d’une calculatrice, puisque l’important, là encore, reste l’apprentissage des techniques de la logique.
Peu d’heures consacrées à l’apprentissage et sans doute, dans le primaire, le mi-temps. On apprend plus vite à lire à quinze enfants qu’à trente et ce gain de temps évite l’ennui. Le sport, l’initiation aux techniques modernes, toutes les activités de loisirs actifs occuperont les heures ainsi gagnées, car elles permettent la formation du caractère, en développant l’esprit d’équipe, la curiosité, le goût de l’effort gratuit, toutes qualités que requiert notre société post-industrielle. De ce point de vue, le système américain est bien supérieur au nôtre. En arrivant à l’université, l’étudiant sait moins de choses mais il est mieux armé pour emmagasiner les connaissances.
Bien entendu, il est indispensable de tenir compte des rythmes de l’évolution intellectuelle. Certains esprits sont mûrs très tôt. Dès l’instant que le secondaire cesse d’être un entonnoir où l’on enfourne du savoir, il devient facile de permettre aux surdoués de brûler les étapes. Les grandes découvertes en mathématique et en physique s’effectuent à l’âge où nos plus brillants sujets, transformés en bêtes à concours, ingurgitent des connaissances qu’ils ont vocation de bousculer. A l’inverse, des élèves qui se traînent, en queue de peloton, se réveillent vers quinze, seize ans. Les passerelles sont nécessaires. À tout moment, un homme, qui a la volonté et les capacités de s’élever, intellectuellement, doit pouvoir le faire, qu’il ait ou non la peau d’âne réglementaire. L’expérience, conduite par la défunte université de Vincennes, n’était nullement absurde, dans son principe. Admettre des étudiants, engagés dans la vie professionnelle, alors qu’ils ne possèdent pas le sacro-saint bac, l’une des plus sottes inventions de l’esprit révolutionnaire, représentait une heureuse innovation, malheureusement déformée par le laxisme gauchiste. Ce qui. nous conduit à constater que rien ne se fera sans que l’on se décide à proclamer la séparation de l’université et de l’Etat.
VII – LA SEPARATION DE L’UNIVERSITE ET DE L’ETAT
 Assurément, il serait injuste de charger l’école de tous les maux. Bien d’autres facteurs ont contribué à la fainéantise de masse.
Assurément, il serait injuste de charger l’école de tous les maux. Bien d’autres facteurs ont contribué à la fainéantise de masse.
A mesure que se réduisait la durée du travail, l’organisation des loisirs devenait une préoccupation quasi obsessionnelle. L’année se passe à rêver des vacances, la semaine du « week-end ». La parcellisation croissante des tâches rendait le travail ennuyeux. Les concentrations urbaines engendraient une fatigue nerveuse, à la longue insupportable et le désir lancinant de l’évasion, d’ailleurs favorisé par la diffusion de l’automobile. Il serait déraisonnable de sous-estimer ces phénomènes. Ils s’enracinent dans la réalité socio-économique. En soi, ils ne sont pas absolument négatifs. Après tout, il n’est de civilisation que du loisir.
Le culte du loisir et de la paresse
 C’est par le temps gagné sur le travail de subsistance que furent édifiés les temples grecs et les cathédrales. Le luxe est l’ornement de la vie. Maurras a des phrases admirables, sur la beauté comme accomplissement idéal de l’ordre social. Ce que l’on doit reprocher à notre société technicienne c’est d’avoir commercialisé le loisir, le rendant bête et méchant.
C’est par le temps gagné sur le travail de subsistance que furent édifiés les temples grecs et les cathédrales. Le luxe est l’ornement de la vie. Maurras a des phrases admirables, sur la beauté comme accomplissement idéal de l’ordre social. Ce que l’on doit reprocher à notre société technicienne c’est d’avoir commercialisé le loisir, le rendant bête et méchant.
A l’idéologie utilitariste de la droite libérale, la gauche a opposé ses poncifs. Dépoussiéré par Lévi-Strauss, le mythe du bon sauvage a repris une apparente jeunesse.
 Une critique, pour une part justifiée, de l’ethnocentrisme aboutit au dénigrement de notre mode de développement. On lui refuse toute supériorité sur celui des indiens de l’Amazonie. A la misère sexuelle et à l’abrutissement par le travail de l’occidental on oppose l’existence sans contrainte de l’aborigène, resté au stade de la cueillette. Ce qui est complètement idiot. Les sociétés dites primitives sont emprisonnées dans un réseau serré d’interdits et leur sexualité étroitement codifiée. La contestation de la « société de consommation » et des besoins artificiels qu’elle fabrique, le « retour à la nature », l’écologie et jusqu’au pacifisme concourent à dévaloriser la science et la technique. Les thèmes réactionnaires sont repris, déformés par l’ultra-gauche : la dénonciation du mythe du progrès, l’exaltation des vertus paysannes, la décentralisation. Il faut quelque courage intellectuel, de nos jours, pour admirer l’élan créateur qui, dès l’an mille, a poussé l’homme occidental à se rendre maître de l’univers. Que cet élan ait été, à partir du XVe siècle, dévoyé, c’est certain. Qu’il faille en modifier, avec prudence, la trajectoire, pourquoi pas. N’empêche que tout pays qui renoncera, dans la terrible guerre économique, connaîtra le sort des vaincus. Il sera colonisé, exploité, asservi. Que nous le voulions ou pas, nous sommes embarqués.
Une critique, pour une part justifiée, de l’ethnocentrisme aboutit au dénigrement de notre mode de développement. On lui refuse toute supériorité sur celui des indiens de l’Amazonie. A la misère sexuelle et à l’abrutissement par le travail de l’occidental on oppose l’existence sans contrainte de l’aborigène, resté au stade de la cueillette. Ce qui est complètement idiot. Les sociétés dites primitives sont emprisonnées dans un réseau serré d’interdits et leur sexualité étroitement codifiée. La contestation de la « société de consommation » et des besoins artificiels qu’elle fabrique, le « retour à la nature », l’écologie et jusqu’au pacifisme concourent à dévaloriser la science et la technique. Les thèmes réactionnaires sont repris, déformés par l’ultra-gauche : la dénonciation du mythe du progrès, l’exaltation des vertus paysannes, la décentralisation. Il faut quelque courage intellectuel, de nos jours, pour admirer l’élan créateur qui, dès l’an mille, a poussé l’homme occidental à se rendre maître de l’univers. Que cet élan ait été, à partir du XVe siècle, dévoyé, c’est certain. Qu’il faille en modifier, avec prudence, la trajectoire, pourquoi pas. N’empêche que tout pays qui renoncera, dans la terrible guerre économique, connaîtra le sort des vaincus. Il sera colonisé, exploité, asservi. Que nous le voulions ou pas, nous sommes embarqués.
Changer de mode de développement en cours de route nous condamnerait au désastre.
 Les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont rempli leurs engagements. Ils avaient promis au peuple fainéant cinq semaines de congés payés, la semaine de 39 heures, la retraite à soixante ans, l’embauche, par la fonction publique de deux cent mille inutiles. Un début annonçaient-ils. Deux ans plus tard, c’est l’appel du Président à l’effort puis la politique de rigueur, la baisse du pouvoir d’achat. Les socialistes commettent même un attentat contre le peuple fainéant. Des milliers de ses membres perdent discrètement la qualité de chômeurs, d’ordinaire des malfaiteurs, des trafiquants de drogue ou des proxénètes, ainsi privés de leur argent de poche et d’une raison sociale. Quand M. Barre avait osé parler des chômeurs professionnels, il avait déclenché la colère des syndicats ! Néanmoins l’actuel gouvernement même s’il lui faut opérer un retour, plus apparent que réel, au réalisme économique reste le représentant de la gauche fainéante. Il l’a prouvé en accablant d’impôts et autres charges fiscales la France travailleuse. Mais surtout, pour que les statistiques du chômage restent convenables, il encourage les jeunes à la paresse, en les invitant à prolonger une scolarité sans objet ou à profiter de contrats de formation, dont tout le monde sait qu’ils ne servent à rien, l’équivalent des « chantiers nationaux » de 1848. N’empêche que les socialistes ont été contraints, sous l’empire de la nécessité, d’admettre que seul le peuple travailleur permet d’entretenir la plèbe.
Les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont rempli leurs engagements. Ils avaient promis au peuple fainéant cinq semaines de congés payés, la semaine de 39 heures, la retraite à soixante ans, l’embauche, par la fonction publique de deux cent mille inutiles. Un début annonçaient-ils. Deux ans plus tard, c’est l’appel du Président à l’effort puis la politique de rigueur, la baisse du pouvoir d’achat. Les socialistes commettent même un attentat contre le peuple fainéant. Des milliers de ses membres perdent discrètement la qualité de chômeurs, d’ordinaire des malfaiteurs, des trafiquants de drogue ou des proxénètes, ainsi privés de leur argent de poche et d’une raison sociale. Quand M. Barre avait osé parler des chômeurs professionnels, il avait déclenché la colère des syndicats ! Néanmoins l’actuel gouvernement même s’il lui faut opérer un retour, plus apparent que réel, au réalisme économique reste le représentant de la gauche fainéante. Il l’a prouvé en accablant d’impôts et autres charges fiscales la France travailleuse. Mais surtout, pour que les statistiques du chômage restent convenables, il encourage les jeunes à la paresse, en les invitant à prolonger une scolarité sans objet ou à profiter de contrats de formation, dont tout le monde sait qu’ils ne servent à rien, l’équivalent des « chantiers nationaux » de 1848. N’empêche que les socialistes ont été contraints, sous l’empire de la nécessité, d’admettre que seul le peuple travailleur permet d’entretenir la plèbe.
Revaloriser et libérer l’enseignement.
Comment en tireraient-ils la conséquence logique ? Seule l’école peut fournir à la nation, les hommes capables de maintenir et d’améliorer son appareil productif. Il est évident qu’il n’existe aucune chance d’une transformation radicale de l’institution scolaire aussi longtemps qu’on n’aura pas brisé la résistance du syndicat national des instituteurs et du syndicat national de l’enseignement secondaire, forteresses du conservatisme pédagogique. Mal payé, mal formé, peu considéré, le corps enseignant, dans sa majorité, s’est laissé absorber par la plèbe. Il s’est recruté parmi les étudiants attirés par l’attrait de longues périodes vacancières ou résignés, du fait de leurs médiocres résultats ou de leur manque d’ambition, à une carrière sans risque. Non qu’il ne reste des universitaires dont le choix fut commandé par une solide vocation. Brimés par leurs collègues, et parfois leurs élèves, certains se sont laissé aller au découragement, parfois au dégoût. D’autres se battent courageusement, et militent dans les syndicats minoritaires. En tout cas, ils ne peuvent guère retarder l’inexorable dégradation de notre enseignement, d’autant qu’instituteurs et professeurs sont plus vulnérables que le reste de la nation à l’idéologie dominante qu’impose la cléricature laïque ou religieuse. Parce qu’ils croient sincèrement aux nouveaux modes de vie, à un développement différent et autres turlutaines, ils répandent, parmi leurs élèves, le goût de la fainéantise, soit directement, en diffusant l’idéologie dominante, soit indirectement par des méthodes pédagogiques qui prétendent que l’on apprend sans effort.
Il convient de revaloriser la fonction d’enseignant, donc de la rémunérer à son juste prix. Un instituteur doit gagner autant qu’un cadre moyen, un professeur qu’un bon ingénieur, un proviseur qu’un chef d’entreprise. En contrepartie, le recrutement sera sévère. Il s’opèrera à un double niveau : un concours d’entrée dans un institut pédagogique, après le baccalauréat pour les instituteurs, la maîtrise pour les professeurs et un concours de sortie qui classera les élèves. L’argent ne suffit pas à valoriser un métier. Il faut encore que l’accès en soit rendu difficile. Bien payés, bien formés les enseignants, assurés d’appartenir à l’élite de la nation, s’intégreront au pays travailleur. Ils en accepteront assez facilement les valeurs et les exigences. Le diplôme ne leur conférera ni garantie d’emploi ni assurance salariale. L’enseignement cessera, en effet d’appartenir à la fonction publique pour devenir une profession libérale, avec des risques et des profits.
 L’Etat ne conservera qu’un pouvoir de police. Il veillera à l’hygiène et à la salubrité des locaux, à la régularité des examens, à la bonne tenue morale des établissements. Rien de plus. On peut néanmoins admettre qu’il fixe les programmes scolaires mais après concertation avec les chefs d’établissement. En aucun cas, il n’interviendra pour imposer une pédagogie ou un projet éducatif. Au demeurant, le ministère de l’éducation nationale sera supprimé. Il sera remplacé par une haute autorité, assistée d’un corps d’inspecteurs, dont le statut s’apparentera à celui }de l’inspection des finances.
L’Etat ne conservera qu’un pouvoir de police. Il veillera à l’hygiène et à la salubrité des locaux, à la régularité des examens, à la bonne tenue morale des établissements. Rien de plus. On peut néanmoins admettre qu’il fixe les programmes scolaires mais après concertation avec les chefs d’établissement. En aucun cas, il n’interviendra pour imposer une pédagogie ou un projet éducatif. Au demeurant, le ministère de l’éducation nationale sera supprimé. Il sera remplacé par une haute autorité, assistée d’un corps d’inspecteurs, dont le statut s’apparentera à celui }de l’inspection des finances.
 Chacun, s’il dispose des diplômes requis, sera libre d’ouvrir là et quand il le voudra, un établissement scolaire.
Chacun, s’il dispose des diplômes requis, sera libre d’ouvrir là et quand il le voudra, un établissement scolaire.
La seule condition sera celle de la compétence du personnel. Néanmoins, chaque commune sera obligée d’ouvrir une ou plusieurs écoles primaires, dont elle désignera le ou les directeurs.
Ceux-ci embaucheront librement leur personnel et pourront le licencier, après accord de la haute autorité ou de son antenne régionale qui conserverait le nom de rectorat. De même chaque arrondissement possédera au moins un C.E.G., chaque département au moins un lycée, chaque région au moins une université, que géreront les instances locales, conseil général ou conseil régional. Des établissements concurrents s’installeront, à ceci près que les pouvoirs publics ne prendront en charge que les locaux qu’ils gèrent.
 L’enseignement sera rigoureusement laïc dans les établissements communaux, départementaux et régionaux. L’inspection générale y veillera. Par contre, les autres pourront être confessionnels, ou même marxistes, existentialistes, athées, peu importe, l’essentiel étant que les parents sachent où ils mettent leurs enfants et s’ils choisissent l’école laïque qu’ils soient assurés de sa stricte neutralité. Quant à l’enseignement technique, il relèvera des chambres de commerce mais les professions, les entreprises ou les particuliers resteront libres d’ouvrir des établissements.
L’enseignement sera rigoureusement laïc dans les établissements communaux, départementaux et régionaux. L’inspection générale y veillera. Par contre, les autres pourront être confessionnels, ou même marxistes, existentialistes, athées, peu importe, l’essentiel étant que les parents sachent où ils mettent leurs enfants et s’ils choisissent l’école laïque qu’ils soient assurés de sa stricte neutralité. Quant à l’enseignement technique, il relèvera des chambres de commerce mais les professions, les entreprises ou les particuliers resteront libres d’ouvrir des établissements.
Chaque famille recevra un chèque éducation pour ses enfants qu’elle remettra à l’école de son choix. Elle pourra ajouter une contribution personnelle si elle préfère des établissements ne relevant pas du secteur laïc, le seul où la gratuité soit totale, par principe. Il va de soi que les autorités de tutelle, si elles désirent attirer de meilleurs enseignants auront une certaine liberté financière et seront autorisées à voter des subventions, qu’elles attribueront à leur gré mais seulement dans les limites fixées par la loi.
 En effet, les enseignants toucheront, en fonction de leurs diplômes, un salaire minimum. Par contre les meilleurs maîtres recevront un salaire double ou triple si un établissement tient à s’assurer leur service. Rien n’empêchera un département, s’il accepte l’effort financier, d’essayer d’avoir un lycée de haute réputation. L’émulation entre les divers types d’établissement et entre les enseignants se développera, comme c’était le cas dans l’ancienne France, quand Aix ou Montpellier (Photo) débauchaient les professeurs les plus réputés, de la façon la plus libre.
En effet, les enseignants toucheront, en fonction de leurs diplômes, un salaire minimum. Par contre les meilleurs maîtres recevront un salaire double ou triple si un établissement tient à s’assurer leur service. Rien n’empêchera un département, s’il accepte l’effort financier, d’essayer d’avoir un lycée de haute réputation. L’émulation entre les divers types d’établissement et entre les enseignants se développera, comme c’était le cas dans l’ancienne France, quand Aix ou Montpellier (Photo) débauchaient les professeurs les plus réputés, de la façon la plus libre.
 Au niveau des universités, il conviendrait que l’Etat gère un certain nombre de grandes écoles, de facultés scientifiques et de C.H.U. de très haut niveau, mais en règle générale les régions, les chambres de commerce, les professions seront responsables des établissements d’enseignement supérieur qui correspondront à leurs besoins. Les professeurs seront élus par leurs pairs, les autres chargés de cours, maîtres assistants et assistants seront désignés par un conseil d’administration dépendant de l’autorité de tutelle. Seule l’assemblée des professeurs aura pouvoir pour licencier l’un des siens. Un recours devant la haute autorité, qui tranchera, après enquête de l’inspection générale, restera possible contre toute décision soit d’embauche, soit de licenciement.
Au niveau des universités, il conviendrait que l’Etat gère un certain nombre de grandes écoles, de facultés scientifiques et de C.H.U. de très haut niveau, mais en règle générale les régions, les chambres de commerce, les professions seront responsables des établissements d’enseignement supérieur qui correspondront à leurs besoins. Les professeurs seront élus par leurs pairs, les autres chargés de cours, maîtres assistants et assistants seront désignés par un conseil d’administration dépendant de l’autorité de tutelle. Seule l’assemblée des professeurs aura pouvoir pour licencier l’un des siens. Un recours devant la haute autorité, qui tranchera, après enquête de l’inspection générale, restera possible contre toute décision soit d’embauche, soit de licenciement.
Les étudiants recevront eux aussi un chèque éducation pour les deux premières années. Ensuite il leur faudra payer leurs études à leur vrai prix. Certaines entreprises afin de s’assurer les services des meilleurs éléments prendront en charge les frais de scolarité, contre un contrat à durée limitée. Ceux qui ne bénéficieront pas de cette chance, emprunteront à une banque, qu’ils rembourseront dès qu’ils gagneront leur vie. Rien n’empêchera une collectivité locale ou une fondation d’accorder des bourses ou des prêts d’honneur à faible taux d’intérêt. L’essentiel, c’est que l’étudiant constate que les études coûtent cher. Il les prendra au sérieux s’il sait que redoubler le contraindrait à s’endetter pour des années. De toute façon, il est anormal que des gens, qui recevront des salaires parfois considérables, fassent leurs études aux frais des contribuables.
Naturellement, la carte scolaire sera abolie. Ecoles et Universités, gérées comme des entreprises, pourront disparaître pour cause de faillite, si elles ont un corps enseignant de médiocre qualité, une pédagogie inadaptée, une discipline relâchée. Assurément, les écoles communales, les lycées départementaux, les universités régionales échapperont à ce risque mais l’électeur interviendra pour sanctionner le conseil municipal, départemental ou régional alors qu’il n’a aucune prise sur le ministère de l’éducation nationale.
 Seule la concurrence permettra d’améliorer notre système d’enseignement. Le S.N.I. le sait si bien que s’il veut détruire l’école catholique ce n’est pas par sectarisme laïcard, ou ce ne l’est que subsidiairement. Au demeurant, l’école catholique l’est si peu, dans trop de cas, que seul le désir de supprimer toute concurrence, donc d’instaurer le monopole des maîtres fainéants, explique la hargne des laïques.
Seule la concurrence permettra d’améliorer notre système d’enseignement. Le S.N.I. le sait si bien que s’il veut détruire l’école catholique ce n’est pas par sectarisme laïcard, ou ce ne l’est que subsidiairement. Au demeurant, l’école catholique l’est si peu, dans trop de cas, que seul le désir de supprimer toute concurrence, donc d’instaurer le monopole des maîtres fainéants, explique la hargne des laïques.
Levons pour finir deux objections. La première relève de la justice sociale. Les familles pauvres, ne pouvant compléter le chèque scolaire, seront condamnées à mettre leurs enfants dans les écoles relevant des collectivités locales. Il est facile de répondre que rien n’empêche les collectivités locales de faire l’effort financier nécessaire afin de disposer d’écoles de haut niveau. Un système de bourses payé par l’Etat ou les professions sélectionnera les sujets les plus brillants, sortant de familles à faible revenu. L’autre objection émane des enseignants. Ils craignent des disparités de salaires et même pour certains le chômage. Les disparités de salaires se retrouvent chez les ingénieurs sortis de la même école. Elles ne choquent personne. Si les enseignants veulent être payés à leur juste prix, ils doivent accepter d’être traités de la même façon que les ingénieurs. Quant au chômage, les besoins non satisfaits sont si grands, qu’il n’est guère à craindre. On peut envisager, dans un premier stade, une garantie de salaire pour les enseignants, si nuls qu’ils se révéleront inutilisables dans un système concurrentiel. On pourra toujours les employer à des tâches administratives !
Une réforme indispensable à toute entreprise de redressement
Napoléon a aboli les libertés universitaires. Il est urgent de les rétablir. Le système que nous proposons est d’ailleurs à peu de choses près, celui qui existe dans les pays anglo-saxons. Nous ne sauverons l’économie française que si les entreprises disposent de la main d’œuvre dont elles ont besoin, pour développer les techniques de pointe. La France est désormais en retard, par rapport à la Corée du sud, à Taiwan ou à Singapour, en ce qui concerne la modernisation des structures industrielles et commerciales. Cela tient au manque de ressources financières des entreprises. Une réforme de l’impôt et des charges sociales y remédiera. Cela tient aussi à la pénurie de matière grise. Serait-on moins intelligent à Brest ou à Digne qu’à Singapour ?
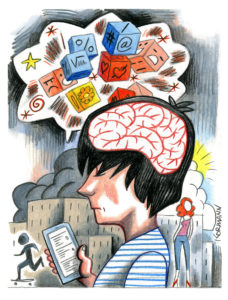 Notre système scolaire nous conduit à la forme la plus pernicieuse de sous-développement, le sous-développement intellectuel. La nation sera sur la voie du redressement quand les journaux se rempliront d’annonces de collectivités locales ou professionnelles et d’entrepreneurs indépendants, offrant des emplois bien rémunérés à des enseignants hautement qualifiés ! (FIN) ■
Notre système scolaire nous conduit à la forme la plus pernicieuse de sous-développement, le sous-développement intellectuel. La nation sera sur la voie du redressement quand les journaux se rempliront d’annonces de collectivités locales ou professionnelles et d’entrepreneurs indépendants, offrant des emplois bien rémunérés à des enseignants hautement qualifiés ! (FIN) ■
* Je Suis Français, 1983
Lire aussi notre introduction à cette série…
© JSF – Peut être repris à condition de citer la source













