
Une Lecture de Bérénice Levet.
![]() La Fontaine politique, de Pierre Boutang a été récemment réédité (2018). Bérénice Levet salue un ouvrage qui décèle dans les Fables une profondeur philosophique digne d’Aristote [FigaroVox, 26.12.2018]. Penseur assumé d’une condition humaine noble parce que limitée, La Fontaine peut être un maître pour notre temps, souffle, en philosophe, Bérénice Levet. D’ailleurs, elle fait bien plus que saluer l’ouvrage réédité de Pierre Boutang. Elle le prolonge de sa propre méditation. Ouvrage difficile dont on sent qu’elle l’a lu avec passion, sympathie, gourmandise, et, en un sens, avec affection, ou à tout le moins, empathie pour son auteur, dont nous n’oublions pas, ici, qu’il est l’un de nos maîtres. Il faut en rendre grâce à Bérénice Levet.
La Fontaine politique, de Pierre Boutang a été récemment réédité (2018). Bérénice Levet salue un ouvrage qui décèle dans les Fables une profondeur philosophique digne d’Aristote [FigaroVox, 26.12.2018]. Penseur assumé d’une condition humaine noble parce que limitée, La Fontaine peut être un maître pour notre temps, souffle, en philosophe, Bérénice Levet. D’ailleurs, elle fait bien plus que saluer l’ouvrage réédité de Pierre Boutang. Elle le prolonge de sa propre méditation. Ouvrage difficile dont on sent qu’elle l’a lu avec passion, sympathie, gourmandise, et, en un sens, avec affection, ou à tout le moins, empathie pour son auteur, dont nous n’oublions pas, ici, qu’il est l’un de nos maîtres. Il faut en rendre grâce à Bérénice Levet. ![]()
Article publié le 30 décembre 2018 – Actualisé le 13 avril 2021
 Quasiment disparu de l’école républicaine depuis les années 1970 – si vous en doutez, interrogez vos enfants, et si vous êtes quarantenaires, interrogez-vous vous-mêmes ! -, La Fontaine connaît depuis plusieurs années un regain d’intérêt et de faveur.
Quasiment disparu de l’école républicaine depuis les années 1970 – si vous en doutez, interrogez vos enfants, et si vous êtes quarantenaires, interrogez-vous vous-mêmes ! -, La Fontaine connaît depuis plusieurs années un regain d’intérêt et de faveur.
À la fin des années 1990, le comédien Fabrice Luchini inscrit Les Fables au programme de ses représentations. La gourmandise, la délectation, la jubilation avec lesquelles il les récite provoquent un effet d’entraînement qui dure depuis lors. En juin dernier, dans le cadre de l’opération « un livre pour les vacances », le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer offrait à 800 000 élèves sortant de classe de CM2, un recueil des œuvres du poète. Ce printemps, Le Monde et Le Figaro consacraient chacun un numéro spécial au fabuliste, Le Point, L’Obs, Lire lui réservaient leur couverture. Sans être dupe des motifs purement mercantiles qui président à ce retour en force et en grâce – l’industrie culturelle, avide de produits toujours neufs, toujours frais se plaît à puiser et à épuiser les ressources spirituelles du passé -, ce phénomène dit quelque chose de notre présent. Comme si nous pressentions que rouvrir La Fontaine ne nous serait peut-être pas inutile, comme si nous devinions que cette œuvre avait encore bien des choses à nous dire, bref qu’il était, pour user d’une formule vermoulue, un poète pour notre temps.
 Pour Pierre Boutang, ce n’est pas qu’un pressentiment, c’est une conviction, qu’il déploie dans cet ouvrage que « Les provinciales » ont l’heureuse idée de rééditer aujourd’hui, La Fontaine politique.
Pour Pierre Boutang, ce n’est pas qu’un pressentiment, c’est une conviction, qu’il déploie dans cet ouvrage que « Les provinciales » ont l’heureuse idée de rééditer aujourd’hui, La Fontaine politique.
Le titre est hasardeux, et Boutang le sait. « Prenons garde, écrit-il, se souvenant de Sainte-Beuve qui recommandait de toujours s’imaginer l’auteur auquel on se voue assis à nos côtés, tendant l’oreille, prenons garde donc, que La fontaine ne s’enfuie par le fond du jardin, s’il entend notre dessein de lui attribuer une politique ». Mais précisément Boutang ne se brise pas sur cet écueil, il n’attribue pas une politique au fabuliste, il ne transforme pas Les Fables en programme électoral ni en petit livre rouge. Mais il célèbre en La Fontaine le penseur de la condition politique des hommes, c’est-à-dire de l’homme comme « animal politique ». On y aura reconnu l’empreinte d’Aristote. « Animal politique » désignant l’homme comme être d’emblée pris dans le faisceau des relations humaines. Politique renvoie donc d’abord à une essentielle sociabilité de l’homme, consubstantielle au don du logos, du langage et de la raison intrinsèquement mêlés, qui le distingue d’entre toutes les espèces vivantes (et fonde, soit dit en passant, sa responsabilité à leur égard). C’est parmi et avec ses semblables que l’homme accomplit son humanité. L’atome des modernes est une fiction. « Politique, définit Boutang, veut dire que ni bête ni dieu, l’homme se revêt de son image dans le regard et les projets de ses frères humains incertains et bigarrés ». Anthropologie pré-moderne avec laquelle Boutang n’est pas seul à renouer, songeons à Hannah Arendt ou à Léo Strauss, par exemple.
Les Fables sont donc politiques parce qu’elles n’ont pas d’autre objet que cette chétive créature avec ses passions, ses grandeurs et ses faiblesses, aux prises avec des questions qui ne se résolvent pas à la façon d’une équation mathématique ou d’un problème technique et financier. Comment vivre, comment rendre le monde plus habitable, la vie un peu plus douce, le commerce avec nos semblables un peu moins âpre ? La réponse n’est écrite nulle part. À nous, hommes, de nous débrouiller, de nous bricoler, de nous composer un art de vivre. En dehors de tout système, de tout dogme, La Fontaine nous est une béquille : « La Fontaine n’enseigne pas, dit si justement Boutang, il montre, […] il aide à faire naître la douce habitude ». Et l’on peut dire de La Fontaine ce que Pascal disait du christianisme, il a bien connu l’homme, « il montre tout, sa paideia va au meilleur et au pire ».
Mais Les Fables sont politiques aussi, et c’est peut-être la leçon première que nous devons retenir de ce livre, parce qu’elles nous donnent la langue, et qu’il n’est pas d’autre force politique que la possession, la maîtrise de cette langue : « La seule réelle force politique [est] la perfection d’une langue […] et d’abord sa transmission religieuse aux enfants de chaque patrie. […] Je ne dis plus seulement que ma patrie c’est la langue française, mais que c’est l’enseignement et la tradition de cette langue dans son intégrité. Tous les autres biens passent effectivement par celui-là ; c’est en lui que l’intérêt et les intérêts deviennent par une métamorphose quotidienne, le bien commun national ». La langue est le ciment d’un peuple : « Chaque fois qu’un enfant apprend sa langue, il imite et prolonge l’aventure capétienne du rassemblement d’une terre dans l’unité de sa parole maîtresse ». À un moment où non seulement les « gilets jaunes », mais la classe politique tout entière et le Président de la République lui-même peinent tant à formuler le discours salutaire et réaliste dont nous avons besoin – nous comprenons que c’est cet apaisement que notre langue nationale est capable de produire en traduisant dans sa perfection et avec sa franchise singulière la réconciliation des intérêts dans le bien commun national, que tout un peuple espère. Apprendre sa langue dans La Fontaine, c’est acquérir un vocabulaire de la sensibilité et de l’intelligence d’une extrême richesse. Boutang est parfaitement accordé à La Fontaine, à l’anthropologie de la transmission qui est la sienne : relisons sa préface aux Fables : Une des grandes « utilités » de son ouvrage, indique-t-il d’emblée, est d’escorter les enfants, de les accompagner : « ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n’en connaissent pas encore les habitants ; ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu’on peut ».
La Fontaine nous est précieux, parce qu’il nous donne les mots, parce qu’il nous donne les histoires pour être rapatriés sur terre, dans le monde des hommes, ce monde humain trop humain. Un politique qui ne donne audience qu’à la raison technicienne, technocratique, calculante, est comme condamné à méconnaître et à sacrifier la réalité humaine, qui crie parfois pathétiquement pour être reconnue et entendue, sans même pouvoir trouver les mots. « Nous avions cessé de regarder le hibou et les souris (cf XI, 9) mais la figure de meurtre et de servitude qui y était contenue, associée cette fois, hors nature, avec la raison calculatrice et technicienne, est revenue sur nous. Qu’est-ce qu’un camp d’extermination, ou un goulag, avec leur finalité industrielle ? Ne reconnaissons-nous pas le hibou et les souris aux visages d’homme ? »
Prenons l’exemple d’une question politique majeure aujourd’hui, la question écologique, la question de notre rapport à la nature. Avant toute mesure, avant toute interdiction, c’est d’une autre philosophie que celle de l’individu et de ses droits que nous avons besoin. Et à cet égard, le détour par La Fontaine lu par Boutang ne serait peut-être pas vain. « La Fontaine devrait être le saint patron des ‘’écologistes » authentiques ». Rien que de très convenu, dira-t-on : La Fontaine, la nature, les animaux … Mais le propos de Boutang est autrement hardi et fécond. Lisons avec lui, L’homme et la couleuvre. Si La Fontaine mériterait d’être érigé en saint patron de l’écologie, ce n’est pas seulement parce qu’il rend une âme aux bêtes et même aux végétaux (et particulièrement dans cette fable, aux arbres), mais parce qu’il se fait le poète d’une disposition sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable sauvetage de la nature : la gratitude, la capacité à remercier, à se tenir pour les obligés de ce dont nous ne sommes pas les auteurs, à voir un don dans ce qui nous est donné, dans ce que nous recevons. Il faut lire les pages très inspirées qu’il consacre à la vertu de gratitude. « La Création n’est confiée à l’homme qu’aux conditions de l’Alliance », disposition qui, au-delà de l’écologie elle-même, devrait être considérée comme le critère et le principe de toute vie politique.
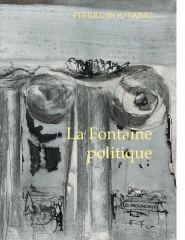 Avant d’aller plus avant, prévenons un malentendu. On conçoit que résumé ainsi, l’objet de ce livre puisse rebuter et ce n’est plus seulement La Fontaine qui risque de prendre ses jambes à son cou mais non moins l’éventuel lecteur de Boutang, redoutant de voir le fabuliste enseveli sous des considérations abstraites, dépossédé de son charme, de sa grâce, de sa légèreté, de son « sourire ». Il n’en est rien. Pierre Boutang ne cède à ce péché (familier à ses semblables) d’abaisser la fable au statut de servante de la philosophie, et le fabuliste à celui de simple illustrateur de thèses et de concepts.
Avant d’aller plus avant, prévenons un malentendu. On conçoit que résumé ainsi, l’objet de ce livre puisse rebuter et ce n’est plus seulement La Fontaine qui risque de prendre ses jambes à son cou mais non moins l’éventuel lecteur de Boutang, redoutant de voir le fabuliste enseveli sous des considérations abstraites, dépossédé de son charme, de sa grâce, de sa légèreté, de son « sourire ». Il n’en est rien. Pierre Boutang ne cède à ce péché (familier à ses semblables) d’abaisser la fable au statut de servante de la philosophie, et le fabuliste à celui de simple illustrateur de thèses et de concepts.
Car précisément, par-delà La Fontaine, un des enjeux majeurs de cet ouvrage est de rendre leurs lettres de noblesse aux œuvres de fiction en tant qu’œuvres de fiction, d’exalter, de faire rayonner la puissance de vérité et de signification du mythe, de la fable, des histoires. La condition humaine ne se laisse pas dire dans la langue de la science ou du concept, non plus, soit dit en passant, dans la langue de carton des technocrates, des politiques et des médias. Et c’est bien pourquoi nous avons tant besoin des poètes, de leurs mots, de leurs fables. « Grâce à l’art, disait Soljenitsyne, il nous arrive d’avoir des révélations, même vagues, mêmes brèves, qu’aucun raisonnement si serré soit-il, ne pourrait faire naître ». L’art est en effet le lieu de l’épiphanie de la vérité, d’une vérité humaine, toute humaine.
Le projet de ce La Fontaine politique, qui paraît pour la première fois en 1981, remontait à loin, au début des années 1950, Boutang devait surseoir à son exécution mais sans jamais y avoir vraiment renoncé. La rencontre avec l’œuvre du philosophe Giambattista Vico fut l’étincelle qui ralluma la mèche, en quelque sorte. La scienza nuova lui donna la clef des Fables … « J’y découvrais, se souvient-il, une philosophie de l’être et de l’homme » et une philosophie qui donnait à la fable, au mythe, leurs fondements anthropologiques. D’où vient que les hommes, depuis l’aube de l’humanité, racontent des histoires ? D’où vient ce que La Fontaine lui-même appelle le « pouvoir des fables », pouvoir irrésistible, sans rival: « Et moi-même, confesse le fabuliste, au moment que je fais cette moralité, /Si peau d’âne m’était conté, j’y prendrais un plaisir extrême » (VIII, IV) ? Vico est en effet ce philosophe qui, contre Descartes, pour dire les choses rapidement, réhabilite l’imagination, le vraisemblable, le mythe, refuse d’abandonner à la rationalité scientifique et à ses critères, le monopole de la vérité. Souvenons-nous de Flaubert: « Pécuchet voulut faire lire [à Bouvard] Vico. Comment admettre, objectait Bouvard, que des fables soient plus vraies que les vérités des historiens ? »» – , échos d’une époque où, notons-le au passage, grâce à Michelet qui s’en faisait le traducteur, l’auteur de la Scienza Nuova était redécouvert.
 Boutang puisa chez « le grand, le sublime Vico » (photo) différents outils conceptuels, et tout particulièrement, la notion d’ « universaux fantastiques ». Que désigne cette expression peu amène à l’oreille, qui sent son jargon philosophique ? « Fantastique» s’entend en son sens grec étymologique, produit par la « fantasia », par l’imagination mais une imagination qui n’est pas la folle du logis, mais l’ « ouvrière d’universaux », c’est-à-dire de généralités, de vérités qui mordent sur la condition humaine, qui mettent en forme les invariants de l’humaine condition. Des universaux, et c’est là leur spécificité par rapport aux universaux produits par les sciences ou la philosophie, sans abstraction, qui procèdent du particulier, qui se donnent sous la forme colorée, chatoyante, concrète d’histoires singulières, de récits. Et Boutang se propose d’établir une sorte de table des universaux, des catégories d’intelligibilité, du vocabulaire de la sensibilité et de l’intelligence que recèlent Les Fables de La Fontaine.
Boutang puisa chez « le grand, le sublime Vico » (photo) différents outils conceptuels, et tout particulièrement, la notion d’ « universaux fantastiques ». Que désigne cette expression peu amène à l’oreille, qui sent son jargon philosophique ? « Fantastique» s’entend en son sens grec étymologique, produit par la « fantasia », par l’imagination mais une imagination qui n’est pas la folle du logis, mais l’ « ouvrière d’universaux », c’est-à-dire de généralités, de vérités qui mordent sur la condition humaine, qui mettent en forme les invariants de l’humaine condition. Des universaux, et c’est là leur spécificité par rapport aux universaux produits par les sciences ou la philosophie, sans abstraction, qui procèdent du particulier, qui se donnent sous la forme colorée, chatoyante, concrète d’histoires singulières, de récits. Et Boutang se propose d’établir une sorte de table des universaux, des catégories d’intelligibilité, du vocabulaire de la sensibilité et de l’intelligence que recèlent Les Fables de La Fontaine.
Aristote est l’autre grande figure philosophique invoquée, sollicitée par Boutang. Et là encore le détour se révèle fécond et nullement forcé. Car il ne s’agit pas d’ « éclairer » La Fontaine par Aristote mais de faire apparaître qu’il y a chez le fabuliste une pensée de la condition politique et morale des hommes aussi consistante, aussi puissante que chez le philosophe. Chacune des « vertus » requises par et pour l’action, les qualités qui font le citoyen, dont Aristote fait en quelque sorte l’inventaire dans L’Éthique à Nicomaque, ont trouvé en La Fontaine leur poète, leur conteur. Phronesis, kairos, c‘est-à-dire repérage du moment opportun, rôle de l’opinion, du conflit des opinions dans la prise de décision, La Fontaine met en scène ces notions, leur donne un contenu narratif et opère à l’avance la critique radicale des complaisances électoralistes dont la totalité de notre personnel politique ne sait plus comment se dépêtrer. C’est ainsi que Boutang propose une lecture extrêmement stimulante du Meunier, son fils et l’âne.
Et l’épreuve de la mise en regard se révèle âpre pour le philosophe : comment rivaliser avec la saveur d’une fable, avec « la langue des dieux telle que La Fontaine en use » et grâce à laquelle il fait droit à cet excès de sens que recèle l’expérience vivante, concrète ? C’est elle que charriaient les proverbes et que le poète restitue à sa manière pour constituer le vrai socle de l’antique sagesse populaire et la transmettre à nos riches autant qu’aux pauvres auxquels elle manque si cruellement.
 Le thème de l’amitié en offre une belle illustration. Aristote est le philosophe par excellence de cette vertu, mais les deux livres de l’Éthique à Nicomaque qu’il lui consacre pâlissent face à ce « chef d’œuvre absolu » qu’est « Le Corbeau, la Gazelle, le rat, la tortue » (XII, 15): cet «universal fantastique complexe, [cette] délicate machine de l’imaginaire ne contredit point aux chapitres d’Aristote mais combien plus elle parle à tout homme encore capable de devenir pareil à des enfants » » , « à quelle profondeur elle pénètre dans nos vies » ?
Le thème de l’amitié en offre une belle illustration. Aristote est le philosophe par excellence de cette vertu, mais les deux livres de l’Éthique à Nicomaque qu’il lui consacre pâlissent face à ce « chef d’œuvre absolu » qu’est « Le Corbeau, la Gazelle, le rat, la tortue » (XII, 15): cet «universal fantastique complexe, [cette] délicate machine de l’imaginaire ne contredit point aux chapitres d’Aristote mais combien plus elle parle à tout homme encore capable de devenir pareil à des enfants » » , « à quelle profondeur elle pénètre dans nos vies » ?
Aristote, La Fontaine, Vico: ces trois-là partagent une même sagesse des limites, une même attention à la condition humaine dans sa finitude qu’ils respectent et nous apprennent à aimer. Ils consentent à l’essentielle ambiguïté des hommes et du monde, ils ignorent tout de l’hubrys de ceux qui entendent régénérer l’humanité, « changer les mentalités » avec des taux de croissance, les seules prouesses de la technique et des lois toujours plus dispendieuses. Ils sont résolument du côté de Philinte. La Fontaine , écrit Boutang, « ne prétend pas abolir l’amour-propre, ni le traquer en ses secrets replis »: « quelques politesses que le fabuliste ait faites à [La Rochefoucauld], ajoute-il magnifiquement, il n’a jamais pu croire que sa chasse impitoyable, et presque délirante, au moi trop humain pût s’ouvrir sur autre chose que le désespoir ».
En plaçant ainsi son étude sur La Fontaine sous le signe d’Aristote et de Vico, Boutang inscrit La Fontaine dans une famille de pensée, une tradition cachée (dont l’histoire reste à écrire) dont la figure tutélaire est en effet Aristote et se poursuit avec Vico, en passant par Montaigne, Molière, conduisant jusqu’à Albert Camus, Hannah Arendt et qu’il nous appartient de maintenir vivante aujourd’hui. Il y aura toujours deux familles de penseurs, ceux qui consentent à la finitude humaine et ceux qui mènent la rébellion contre cette limitation, et s’engagent dans des politiques d’ingénierie sociale, culturelle et anthropologique désastreuses. L’histoire, de la Terreur de 1793 au léninisme et au stalinisme du XXe siècle, est là pour nous instruire du prix humain auquel se paie cette impossible réconciliation avec l’homme.
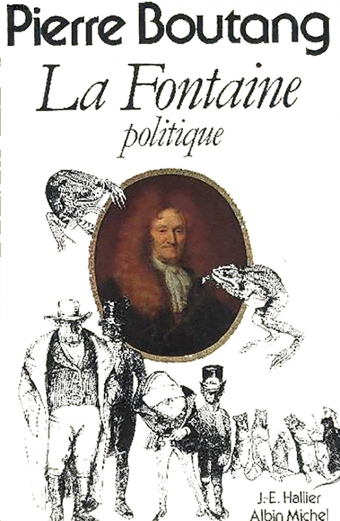 « La tâche terminée, écrit Boutang au moment de clore son La Fontaine politique, j’avoue qu’elle m’a été joyeuse, et continûment ». Nous n’en doutons pas un instant. Boutang a le goût, le sens des mots, sa verve interprétative est souvent inspirée, son enjouement, communicatif – même si, et on ne le dissimulera pas, la lecture de cet ouvrage n’est guère aisée, elle demande de la patience, des efforts. Mais on aurait tort de se priver de cette extraordinaire occasion de revisiter ou de visiter ce continent que sont Les Fables – « musarder dans les fables », dit joliment Boutang, mais il fait plus qu’y musarder, il s’y promène avec une agilité, une souplesse, tout à fait vertigineuse (est-il une seule fable qui ne soit pas convoquée par le philosophe ?) L’effet le plus assuré de ce livre, et qui à soi seul en justifie la lecture, est de conduire à La Fontaine…Et de prendre exemple sur Boutang, de lire le poète de telle sorte que l’on vive avec ses histoires, avec ses mots. Que La Fontaine nous devienne réellement compagnon de vie et de pensée. ■
« La tâche terminée, écrit Boutang au moment de clore son La Fontaine politique, j’avoue qu’elle m’a été joyeuse, et continûment ». Nous n’en doutons pas un instant. Boutang a le goût, le sens des mots, sa verve interprétative est souvent inspirée, son enjouement, communicatif – même si, et on ne le dissimulera pas, la lecture de cet ouvrage n’est guère aisée, elle demande de la patience, des efforts. Mais on aurait tort de se priver de cette extraordinaire occasion de revisiter ou de visiter ce continent que sont Les Fables – « musarder dans les fables », dit joliment Boutang, mais il fait plus qu’y musarder, il s’y promène avec une agilité, une souplesse, tout à fait vertigineuse (est-il une seule fable qui ne soit pas convoquée par le philosophe ?) L’effet le plus assuré de ce livre, et qui à soi seul en justifie la lecture, est de conduire à La Fontaine…Et de prendre exemple sur Boutang, de lire le poète de telle sorte que l’on vive avec ses histoires, avec ses mots. Que La Fontaine nous devienne réellement compagnon de vie et de pensée. ■
Bérénice Levet est docteur en philosophie et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Elle vient de faire paraître Libérons-nous du féminisme ! aux éditions de l’Observatoire.











