
PAR PIERRE BUILLY.
Orgueil et préjugés de Joe Wright (2006).
Gigot à la menthe.
Est-ce parce que je suis en ce moment plongé avec délice dans le deuxième tome en Pléiade des Œuvres romanesques complètes de Jane Austen (Mansfielsd Park, Emma, Persuasion) que j’ai pris tant de plaisir à retrouver le ton si particulier, fait de distance policée et d’humour calme de la grande romancière anglaise, en regardant Orgueil et préjugés, une des adaptations les plus récentes d’un de ses livres les plus connus et les plus réussis ? C’est bien possible, mais je crois aussi que la pieuse façon de présenter à l’écran les pratiques et les façons d’être de cette société courtoise, affable, corsetée, contraignante – c’est-à-dire civilisée – mérite beaucoup d’admiration tant elle reproduit, sans s’en moquer, moins encore en paraissant les mépriser, des usages qui pourront paraître aux sauvageons d’aujourd’hui plus éloignés que ne le seraient les pratiques de Cromagnon si on les restituait ; et qui, de fait, en sont bien davantage abyssalement lointaines.
 Je suis d’ailleurs absolument étonné que ce film, qui fait appel à un minimum de connaissances historiques et sociologiques ait pu être tourné, dans le cadre d’une production franco-anglo-étasunienne avec, manifestement, beaucoup de moyens et une distribution internationale. Et tout cela pour un public qui n’en aura certainement pas perçu le quart du tiers de la saveur, pour n’avoir pas compris la hardiesse du récit de Jane Austen et donc n’avoir pas perçu les transgressions que l’histoire recèle. On ne le dira jamais assez : l’Angleterre n’est pas la France : sa noblesse s’est emparée d’une large part du pouvoir en obligeant Jean sans Terre, le frère de Richard cœur de Lion (le souverain pour qui se bat le cher Robin des bois) à lui abandonner nombre de ses prérogatives, lors de la promulgation de la Grande charte (Magna carta) en 1215, après notre victoire à Bouvines.
Je suis d’ailleurs absolument étonné que ce film, qui fait appel à un minimum de connaissances historiques et sociologiques ait pu être tourné, dans le cadre d’une production franco-anglo-étasunienne avec, manifestement, beaucoup de moyens et une distribution internationale. Et tout cela pour un public qui n’en aura certainement pas perçu le quart du tiers de la saveur, pour n’avoir pas compris la hardiesse du récit de Jane Austen et donc n’avoir pas perçu les transgressions que l’histoire recèle. On ne le dira jamais assez : l’Angleterre n’est pas la France : sa noblesse s’est emparée d’une large part du pouvoir en obligeant Jean sans Terre, le frère de Richard cœur de Lion (le souverain pour qui se bat le cher Robin des bois) à lui abandonner nombre de ses prérogatives, lors de la promulgation de la Grande charte (Magna carta) en 1215, après notre victoire à Bouvines.
 Cette aristocratie terrienne, en face de dynasties multiples, faibles, controversées, a conservé sa substance des siècles durant. L’État n’a pas, comme chez nous, décapité les féodaux : nul Richelieu, Outre-Manche, qui arase les orgueilleux châteaux. Une multiplicité de propriétaires terriens et un prolétariat rural qui se soumet entièrement. Au sommet, la noblesse, richissime (et qui le demeure encore aujourd’hui) ; en dessous, la gentry qui connaît des sorts divers.
Cette aristocratie terrienne, en face de dynasties multiples, faibles, controversées, a conservé sa substance des siècles durant. L’État n’a pas, comme chez nous, décapité les féodaux : nul Richelieu, Outre-Manche, qui arase les orgueilleux châteaux. Une multiplicité de propriétaires terriens et un prolétariat rural qui se soumet entièrement. Au sommet, la noblesse, richissime (et qui le demeure encore aujourd’hui) ; en dessous, la gentry qui connaît des sorts divers.
L’audace d’Orgueil et préjugés est de faire se croiser l’une et l’autre classe.
 On voudra bien considérer que le peuple n’est là-dedans pour rien du tout ; dans les romans de Jane Austen, il n’existe littéralement pas, il n’a pas de vie autonome : les nombreux régisseurs, serviteurs, agriculteurs ne sont là qu’en profils perdus, pour délacer les robes des dames et cuisiner des gigots de mouton, sans qu’on les voie jamais. Il serait vain et niais de s’en indigner : tout simplement le regard passe au-dessus.
On voudra bien considérer que le peuple n’est là-dedans pour rien du tout ; dans les romans de Jane Austen, il n’existe littéralement pas, il n’a pas de vie autonome : les nombreux régisseurs, serviteurs, agriculteurs ne sont là qu’en profils perdus, pour délacer les robes des dames et cuisiner des gigots de mouton, sans qu’on les voie jamais. Il serait vain et niais de s’en indigner : tout simplement le regard passe au-dessus.
La préoccupation principale de l’aristocratie est naturellement de garder son rang en essayant d’empêcher quiconque de parvenir à son empyrée. Celle de la gentry est de ne pas s’enfoncer ou, au mieux, d’escalader une marche. Mais dès qu’une famille de cette classe sociale (qui, au demeurant, s’enfonce graduellement dans la gêne financière) est dotée de cinq filles à marier, les choses pour elle, deviennent d’une complexité infinie. À dire vrai, voilà qui fut jadis l’angoisse existentielle de la petite bourgeoisie, en France y compris : qu’on se souvienne seulement des manigances de Mme Josserand (Jane Marken) dans Pot-Bouille, qui essaye désespérément de placer ses filles, quitte à les vendre à bas prix.
 On comprendra mieux ainsi l’obsession de Mme Bennet (Brenda Blethyn) et sa facilité roublarde à tout accepter pour se débarrasser de ses filles, jusqu’à consentir avec joie et en tout cas sans scrupule à céder la très jeune Lydia (Jena Malone), qui n’a que 15 ans, mais s’est enfuie avec une canaille, Wickham (Rupert Friend). Une de casée !
On comprendra mieux ainsi l’obsession de Mme Bennet (Brenda Blethyn) et sa facilité roublarde à tout accepter pour se débarrasser de ses filles, jusqu’à consentir avec joie et en tout cas sans scrupule à céder la très jeune Lydia (Jena Malone), qui n’a que 15 ans, mais s’est enfuie avec une canaille, Wickham (Rupert Friend). Une de casée !
Et bonheur extrême de voir la très jolie Jane (Rosamund Pike) courtisée par le riche Bingley (Simon Woods). Mais qui aurait pu penser que la plus fantasque, la plus primesautière, la plus spirituelle des filles, Elizabeth, Lizzy (Keira Knightley) parviendrait à gagner l’amour du sombre, réservé, hautain Darcy (Matthew Macfadyen), encore plus riche que tout le monde et présumé inatteignable ?
 Un peu plus de deux heures de film pour en arriver à une conclusion qu’on ne pouvait que prévoir dès les premières images ? Certes ! Mais deux heures ravissantes, enchantées, intelligentes, tournées avec une très grande abondance de moyens (paysages, maisons, châteaux, costumes, figurants) et avec beaucoup de fidélité d’esprit au roman. Je ne dirai pas que c’est du cinéma bouleversant, mais c’est du cinéma consciencieux et fidèle. Est-ce qu’on ne peut pas en être ravi ? ■
Un peu plus de deux heures de film pour en arriver à une conclusion qu’on ne pouvait que prévoir dès les premières images ? Certes ! Mais deux heures ravissantes, enchantées, intelligentes, tournées avec une très grande abondance de moyens (paysages, maisons, châteaux, costumes, figurants) et avec beaucoup de fidélité d’esprit au roman. Je ne dirai pas que c’est du cinéma bouleversant, mais c’est du cinéma consciencieux et fidèle. Est-ce qu’on ne peut pas en être ravi ? ■
DVD autour de 10 €


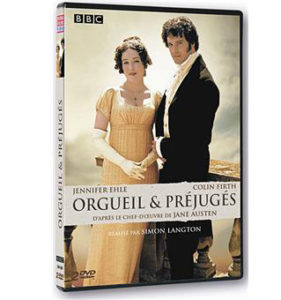












A mon avis votre commentaire est trop sociologique ; bien que cette dimension soit présente dans le film et dans l’oeuvre de ce très grand écrivain , sa grandeur réside plutôt dans le fait de savoir raisonnée pour trouver la meilleure solution éthique à des situations complexes . Bref Jane Austen est l’une des dernières représentante de la véritable prudence aristotélicienne . C’est ce qui la différencie par exemple de Balzac qui se situe tout entier du côté de la sociologie, traditionnelle, et des sentiments .
A mon avis votre commentaire est trop sociologique ; bien que cette dimension soit présente dans le film et dans l’oeuvre de ce très grand écrivain , sa grandeur réside plutôt dans le fait de savoir raisonner pour trouver la meilleure solution éthique à des situations complexes . Bref Jane Austen est l’une des dernières représentantes de la véritable prudence aristotélicienne . C’est ce qui la différencie par exemple de Balzac qui se situe tout entier du côté de la sociologie, traditionnelle, et des sentiments .
Vous n’avez sûrement pas tort ; j’ai découvert Jane Austen assez récemment et je n’ai sans doute pas pris la distance nécessaire.
d’autant que ma pratique n’est pas celle d’un critique professionnel, mais celle d’un amateur qui ne peut souvent d’empêcher de « s’ajouter » à ce qu’il expose.