
PAR MATHIEU BOCK-CÔTÉ.
 Cette tribune est parue dans Le Figaro du 7 mai. Elle montre notamment que l’immense offensive déconstructiviste menée aujourd’hui contre nos nations occidentales doit être combattue aussi sous l’angle de la culture et de la langue, dont la subversion intrinsèque constitue un puissant moyen largement utilisé par nos adversaires.
Cette tribune est parue dans Le Figaro du 7 mai. Elle montre notamment que l’immense offensive déconstructiviste menée aujourd’hui contre nos nations occidentales doit être combattue aussi sous l’angle de la culture et de la langue, dont la subversion intrinsèque constitue un puissant moyen largement utilisé par nos adversaires. ![]()
La reconquête du langage est désormais un acte de souveraineté, sans lequel rien d’essentiel ne sera possible.
Le meurtre d’un policier à Avignon par un «dealer» a suscité la plus grande colère. Il fait écho au lynchage d’un policier à Bagnolet par des «jeunes» hurlant «tuez-le, c’est un sale chien de flic».
Les termes utilisés avaient le mérite de la clarté: la pulsion meurtrière est confessée. La France, loin d’être le pays des «violences policières», est le pays des violences contre les policiers, auxquels on tend des guets-apens, que l’on agresse et, de temps en temps, que l’on assassine au cri d’Allah akbar, comme on l’a vu avec le sort réservé à Stéphanie Monfermé à la fin avril.
De façon générale, c’est un climat d’extrême agressivité qui s’installe. Des bandes conquérantes attaquent autant qu’elles le peuvent tous les symboles de l’État, au point même de tirer au mortier d’artifice sur des pompiers. Il faut transformer l’aveuglement en méthode sociologique pour ne pas le voir, comme on l’a constaté récemment à Tourcoing et Roubaix.
Profilage racial
Cette violence est théorisée et légitimée par certains sociologues chouchoutés médiatiquement qui présentent les forces policières comme une puissance d’occupation dans des territoires «racisés» appelés par la logique décoloniale à se soustraire à la souveraineté française. Dès lors, les «violences urbaines» sont présentées comme des soulèvements légitimes. Les mêmes se désoleront de temps en temps de leurs excès, mais toujours les comprendront: la France ne condamnerait-elle pas la jeunesse des «quartiers» au désespoir? Inversement, il suffit qu’un jeune homme issu de l’immigration se retrouve dans une situation conflictuelle avec les forces de l’ordre pour qu’on accuse ces dernières de céder au profilage racial et de se rendre coupable de «racisme systémique» ou même de verser dans le «racisme d’État».
L’inversion du réel pousse même de nombreux médias à propulser au cœur de la vie publique de nouvelles icônes indigénistes, toujours occupées à traduire la violence en insurrections décoloniales. La transformation d’Assa Traoré en figure messianique ces dernières années est intimement liée à cette légitimation de la violence de groupes délinquants de banlieues, présentée comme une manifestation d’autodéfense de populations persécutées.
 Mais les Français ne parviennent pas à s’habituer à l’idée de se faire tabasser dans leur propre pays et se demandent s’il est normal qu’on trouve en France des zones de non-France. Les idéologues du régime diversitaire nomment alors les choses pour mieux les taire, et les évoquent pour les arracher à leur signification. Le langage médiatique euphémise ainsi sa description du réel en allant jusqu’à l’aseptiser. Il faut tout faire pour neutraliser la dimension ethnoculturelle de nombre d’agressions, quitte, s’il le faut, à changer le prénom des assaillants, pour en dissimuler l’origine, pour éviter, de «stigmatiser» certaines catégories de la population. On parlera aussi de «bandes de jeunes», issus de «quartiers sensibles», commettant des «incivilités», alimentant un «sentiment d’insécurité», à combattre, pour éviter de faire «le jeu du populisme». Les euphémismes ne s’arrêtent pas là: on ne poignarde plus, on «attaque au couteau», on n’égorge plus, on «attaque à la gorge». Et désormais, tout devra être réduit à la question des «dealers» et de la «drogue». Telle est la nouvelle explication médiatiquement autorisée de la «nervosité des banlieues».
Mais les Français ne parviennent pas à s’habituer à l’idée de se faire tabasser dans leur propre pays et se demandent s’il est normal qu’on trouve en France des zones de non-France. Les idéologues du régime diversitaire nomment alors les choses pour mieux les taire, et les évoquent pour les arracher à leur signification. Le langage médiatique euphémise ainsi sa description du réel en allant jusqu’à l’aseptiser. Il faut tout faire pour neutraliser la dimension ethnoculturelle de nombre d’agressions, quitte, s’il le faut, à changer le prénom des assaillants, pour en dissimuler l’origine, pour éviter, de «stigmatiser» certaines catégories de la population. On parlera aussi de «bandes de jeunes», issus de «quartiers sensibles», commettant des «incivilités», alimentant un «sentiment d’insécurité», à combattre, pour éviter de faire «le jeu du populisme». Les euphémismes ne s’arrêtent pas là: on ne poignarde plus, on «attaque au couteau», on n’égorge plus, on «attaque à la gorge». Et désormais, tout devra être réduit à la question des «dealers» et de la «drogue». Telle est la nouvelle explication médiatiquement autorisée de la «nervosité des banlieues».
Schizophrénie politique
Le simple fait qu’il faille prendre des gants pour rappeler le lien entre l’immigration et l’insécurité nous rappelle à quel point pèse encore une effarante censure sur le réel. Le commun des mortels a appris à décoder ce qu’on lui dit en ne le lui disant pas. Dans sa tête se trouve un logiciel décrypteur: il sait ce qui se passe et ne peut être dit. Il sait quelle réalité se cache derrière chaque mot. Et sait que certains mots ne peuvent plus être prononcés. Il sait aussi que s’il s’arrache à la novlangue, on le passera à la bastonnade médiatique, on l’accusera de tenir des propos haineux: parler du réel, aujourd’hui, est d’extrême droite. Tel est le propre d’un régime idéocratique, qui oblige ses citoyens à parler dans un langage qui falsifie le rapport au réel.
Cela ne peut qu’entraîner une forme de schizophrénie politique: le dédoublement du langage témoigne d’une pensée étouffée, empêchée, multipliant les ruses pour s’exprimer, comme si à l’art d’écrire du philosophe, autrefois évoqué par Leo Strauss, s’ajoutait aujourd’hui l’art de dire de l’éditorialiste qui veut qu’on le comprenne sans risquer de se faire incriminer. De ce point de vue, la reconquête du langage est désormais un acte de souveraineté, sans lequel rien d’essentiel ne sera possible. ■
Mathieu Bock-Côté
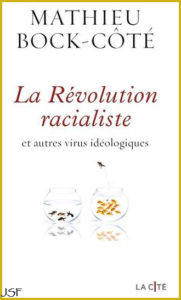 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime (Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime (Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Sélection photos © JSF












