
Par Pierre Builly.
Douce de Claude Autant-Lara (1943).
Noirceur et dévastation.
Introduction : Fin du 19ème siècle. Très bel hôtel particulier parisien. Férule orageuse et autoritaire de la vieille marquise de Bonafé. Son fils veuf, Enjalbert, sa rêveuse petite-fille, Douce. Et naturellement une foule de domestiques régentés par l’acariâtre Estelle, dévouée comme un chien à ses maîtres. Irène, la gouvernante de Douce, a pour amant secret le régisseur Fabien, dont Douce est amoureuse, comme une très jeune fille de ce milieu et de cette époque peut l’être. Mais Enjalbert de Bonafé voudrait se remarier avec Irène. Douce se jette dans les bras de Fabien qui part avec elle et se venge ainsi d’Irène et de ses maîtres, mais tout cela finira mal.
À mon sens, le plus impur chef-d’œuvre de Claude Autant-Lara, où chacun est accroché, fouillé, interrogé… On a très souvent présenté ce film comme une critique anarchiste et cruelle de la bonne conscience et de l’aveuglement de l’aristocratie de la fin du 19ème siècle ; sûrement y a-t-il cela, mais sans doute est-ce plus vaste.
Il fallait toute l’idiote naïveté, la cafardise prétendument bien-pensante, l’aveuglement souvent stupide de la Révolution nationale pour s’indigner vertueusement, en 1943 devant ce chef-d’œuvre noir, réalisé par un Autant-Lara misanthrope absolu, souvent méchant comme une teigne et en tout cas superbement inspiré par un scénario des deux grands scénaristes Pierre Bost et Jean Aurenche, sur la base d’un roman de Michel Davet qui n’a pas laissé grande trace et dont je suppose – témérairement, je le reconnais – que le texte était moins mouillé d’acide que ne l’est le film.
 Qu’on ait pu voir dans Douce seulement une critique des classes dominantes de la fin du 19ème siècle et l’histoire désespérée d’une très jeune fille abusée par un aigri social me laisse, à la dixième vision, assez pantois ; le film commence par un panoramique (un peu artisanal, j’en conviens, mais ça n’a pas beaucoup d’importance) sur les toits de Paris : on voit la Tour Eiffel en construction et c’est Noël (on est donc en 1887) ; qui connaît un peu Paris voit tout de suite qu’on est dans les beaux quartiers patriciens de la rive gauche, l’aristocratique faubourg Saint-Germain ; le panoramique s’arrête sur une église toute bruissante des préparatifs de la Nativité (Saint-Pierre du Gros Caillou, rue Saint Dominique ?) ; un confessionnal, un prêtre effaré qui, en quelques mots prémonitoires, trace le chemin de sa pénitente, Douce de Bonafé (Odette Joyeux), qui vient de lui avouer un amour absurde : « Je ne vous menace pas de l’Enfer : l’enfer, c’est ici-bas que vous le connaitrez !« . Tout est là : le romanesque passionnel de la mésalliance totale cassé d’emblée par l’évidence de l’appartenance sociale.
Qu’on ait pu voir dans Douce seulement une critique des classes dominantes de la fin du 19ème siècle et l’histoire désespérée d’une très jeune fille abusée par un aigri social me laisse, à la dixième vision, assez pantois ; le film commence par un panoramique (un peu artisanal, j’en conviens, mais ça n’a pas beaucoup d’importance) sur les toits de Paris : on voit la Tour Eiffel en construction et c’est Noël (on est donc en 1887) ; qui connaît un peu Paris voit tout de suite qu’on est dans les beaux quartiers patriciens de la rive gauche, l’aristocratique faubourg Saint-Germain ; le panoramique s’arrête sur une église toute bruissante des préparatifs de la Nativité (Saint-Pierre du Gros Caillou, rue Saint Dominique ?) ; un confessionnal, un prêtre effaré qui, en quelques mots prémonitoires, trace le chemin de sa pénitente, Douce de Bonafé (Odette Joyeux), qui vient de lui avouer un amour absurde : « Je ne vous menace pas de l’Enfer : l’enfer, c’est ici-bas que vous le connaitrez !« . Tout est là : le romanesque passionnel de la mésalliance totale cassé d’emblée par l’évidence de l’appartenance sociale.
 L’appartenance sociale, Autant-Lara ne manque pas de la faire valoir dès la séquence suivante : hôtel particulier, invraisemblable nombre de domestiques, burlesque installation d’un ascenseur dédié seulement à la terrible marquise de Bonafé (Marguerite Moreno qui n’a pas trouvé de plus grand rôle) ; qu’on juge que l’ordre social, figé, marmoréen, d’apparence (ou de réalité ?) immuable, est scandaleux, immoral, épouvantable même, est un point de vue qui se défend. N’empêche que c’est l’ordre, qui seul permet la Civilisation.
L’appartenance sociale, Autant-Lara ne manque pas de la faire valoir dès la séquence suivante : hôtel particulier, invraisemblable nombre de domestiques, burlesque installation d’un ascenseur dédié seulement à la terrible marquise de Bonafé (Marguerite Moreno qui n’a pas trouvé de plus grand rôle) ; qu’on juge que l’ordre social, figé, marmoréen, d’apparence (ou de réalité ?) immuable, est scandaleux, immoral, épouvantable même, est un point de vue qui se défend. N’empêche que c’est l’ordre, qui seul permet la Civilisation.
La scène fameuse où la vieille marquise de Bonnafé (Marguerite Moreno) quittant ses pauvres et leur souhaitant Patience et résignation se voit suivie par l’apostrophe de son brûlant régisseur (Roger Pigaut) Et moi impatience et révolte ! est typique à cet égard.
 Puisque la révolte du régisseur, sa volonté de prendre pied dans un ordre social dans lequel il n’est pas et ne peut pas être admis s’achèvera par la catastrophe absolue, la mort de Douce, l’horreur tombée davantage encore que sur une famille, sur une « Maison » (le cri de haine de la vieille nourrice, Gabrielle Fontan, pour ceux qui sont venus tout assassiner) et le renvoi des deux révoltés, le régisseur et sa complice (Madeleine Robinson) venus perturber ce qui était un ordre, sans doute injuste, mais apaisé pour ceux qui l’acceptaient.
Puisque la révolte du régisseur, sa volonté de prendre pied dans un ordre social dans lequel il n’est pas et ne peut pas être admis s’achèvera par la catastrophe absolue, la mort de Douce, l’horreur tombée davantage encore que sur une famille, sur une « Maison » (le cri de haine de la vieille nourrice, Gabrielle Fontan, pour ceux qui sont venus tout assassiner) et le renvoi des deux révoltés, le régisseur et sa complice (Madeleine Robinson) venus perturber ce qui était un ordre, sans doute injuste, mais apaisé pour ceux qui l’acceptaient.
Après le passage des révoltés, il n’y a plus rien ; c’est pire.
 Irène (Madeleine Robinson), dame de compagnie de Douce, et Fabien (Roger Pigaut), le régisseur des Bonafé, amants aigris, qui ne peuvent ni s’entendre, ni se séparer, (et, in fine, condamnés par le drame affreux de la mort de Douce, à vivre ensemble leur enfer) sont aussi criants d’hypocrisie et d’envie que la marquise est boursouflée de la fierté de son rang, mais finalement consciente de la fragilité de son bonheur, et son fils Enjalbert ((Jean Debucourt), le père de Douce, pénétré de sa propre médiocrité : finalement, la criante sévérité du film, c’est ça : chacun sait ce qu’il vaut, et ce n’est pas grand chose.
Irène (Madeleine Robinson), dame de compagnie de Douce, et Fabien (Roger Pigaut), le régisseur des Bonafé, amants aigris, qui ne peuvent ni s’entendre, ni se séparer, (et, in fine, condamnés par le drame affreux de la mort de Douce, à vivre ensemble leur enfer) sont aussi criants d’hypocrisie et d’envie que la marquise est boursouflée de la fierté de son rang, mais finalement consciente de la fragilité de son bonheur, et son fils Enjalbert ((Jean Debucourt), le père de Douce, pénétré de sa propre médiocrité : finalement, la criante sévérité du film, c’est ça : chacun sait ce qu’il vaut, et ce n’est pas grand chose.
 Il n’y a précisément que Douce, qui doit avoir quelque chose comme 16 ou 17 ans, qui s’illusionne un peu sur la vie, mais la réalité, la trivialité naturaliste de l’amour – de l’attirance à la fois physique et intellectuelle – qu’elle éprouve pour Fabien, le régisseur de ses domaines va vite la ramener à la raison ; au soir de ce qui pourrait être leur première nuit, dans cet hôtel d’habitude, où Fabien a coutume de recevoir Irène, dans ce premier soir de la vie qu’elle voudrait grande et qui n’est que banale, Douce renvoie celui qu’elle s’était imaginer aimer « Je suis glacée Fabien« , et elle tourne la clef dans la serrure : on n’a jamais mieux représenté le dégoût d’une jeune fille devant l’animalité du mâle…
Il n’y a précisément que Douce, qui doit avoir quelque chose comme 16 ou 17 ans, qui s’illusionne un peu sur la vie, mais la réalité, la trivialité naturaliste de l’amour – de l’attirance à la fois physique et intellectuelle – qu’elle éprouve pour Fabien, le régisseur de ses domaines va vite la ramener à la raison ; au soir de ce qui pourrait être leur première nuit, dans cet hôtel d’habitude, où Fabien a coutume de recevoir Irène, dans ce premier soir de la vie qu’elle voudrait grande et qui n’est que banale, Douce renvoie celui qu’elle s’était imaginer aimer « Je suis glacée Fabien« , et elle tourne la clef dans la serrure : on n’a jamais mieux représenté le dégoût d’une jeune fille devant l’animalité du mâle…
Film admirable, ponctué de vacheries de dialogue (« Je déteste refuser les permissions, aussi je vous prie de ne pas m’en demander« , « Il fait froid comme en temps de guerre« , « Je me l’offre, je l’accepte et je me dis merci !« ) , et plein d’amour (d’Enjalbert, qui espère encore que sa petite fille va lui revenir, à la fois souillée, mais intacte : « Ce ne sera pas Douce qui est partie, mais Douce qui revient…« ), doté d’une musique inoubliable de René Cloerec, fier, désespérant, accablant, Douce est un des plus beaux films du cinéma français. ■
DVD autour de 15 €
Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

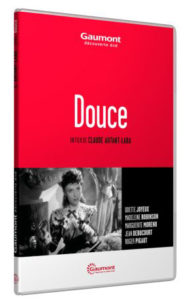












Franchement, Builly devrait faire preuve d’un peu plus de rigueur dans ses critiques cinématographiques. Il écrit: « Il fallait toute l’idiote naïveté, la cafardise prétendument bien-pensante, l’aveuglement souvent stupide de la Révolution nationale pour s’indigner vertueusement, en 1943 devant ce chef-d’œuvre noir. » Quel besoin a-t-il d’accumuler les adjectifs pour fustiger une critique, et en profiter pour couvrir d’injures, non pas l’auteur ou les auteurs de la critique, dont il ne cite pas le nom, mais…la Révolution nationale, qui serait collectivement coupable de ces péchés? Ce film n’a pas été censuré, que je sache, il est paru sous l’empire du Régime de Vichy, en novembre 43. Et la période de l’occupation fut une ère de grande floraison du cinéma français. C’est devenu un « must » pour les ignorants de l’histoire, de dénigrer, le plus souvent sans justice, le Régime du Maréchal. Si on peut le pardonner à de très jeunes gens, c’est inacceptable pour un homme qui prétend avoir de la mémoire.
Je n’ai pas la patience d’aller chercher dans la presse vichyste et collaborationniste le torrent d’injures qui s’est abattue sur « Douce ». La chose a été relatée dans plusieurs histoires du cinéma.
Je sais que Vichy avait fait censurer la réplique de Mme de Bonafé qui souhaite à « ses pauvres » (comme toues les dames d’oeuvre, « Patience et résignation ». Le mot faisait trop songer à l’attitude du régime envers les Français.
Tu as tout à fait raison de dire que la sombre période de l’Occupation a été extrêmement fructueuse pour le cinéma. Ce qui a d’ailleurs conduit Autant-Lara, à devenir tête de liste du Front National et à tonner contre les Juifs. Tout simplement parce que le flux invasif du cinéma étasunien était tari.
Ce que je regrette, dans mon avis, c’est que peu de monde ait vu que, finalement, la critique au fer rouge de l’ordre social injuste mais stable allait dans le sens d’un Ordre supérieur.
Je lis attentivement : le cinema a fleuri sous l’Occupation « Tout simplement parce que le flux invasif du cinéma étasunien était tari. »
Voila pourquoi votre fille est muette… Je veux bien que l’oppression de Hollywood soit plus pesante que celle de la Continental d’Alfred Greven, l’ami de Goering qui a produit ( excusez du peu !) 26 films , dont L’assassinat du père Noël de Christian-Jaque, Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot ou Au bonheur des dames d’André Cayatte d’après Émile Zola, auteur mis à l’index par les nazis .
Mais est ce la raison principale ? Je note : « un autre phénomène, tout aussi inespéré, s’était produit : l’augmentation vertigineuse du nombre de spectateurs. Les recettes, qui étaient en 1938 de 452 millions de francs, atteignent, pour l’année 1943, 915 millions ! » Pourquoi ? Parce que les spectateurs « confinés » par l’Occupant n’avaient pas d’autres distractions que le cinema….
« A de rares exceptions près, les artistes français se garderont de collaborer. Ils travailleront en ignorant les allemands et ne montreront aucune complaisance suspecte pour les thèses national-socialistes. Il faut noter qu’aucun producteur et pas même la Continental n’ait entrepris un film à la gloire de l’Allemagne hitlérienne. » Et enfin, le départ vers les USA de metteurs en scéne patentés va favoriser l’essort des jeunes : « d’une véritable nouvelle vague, dont certains deviendront immédiatement les piliers du nouveau cinéma français comme Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker, Robert Bresson ou Claude Autant-Lara. »
Certes, certes, il y avait du monde dans les salles pour les raisons évidentes que c’étaient les rares endroits où l’on pouvait rêver. Mais le succès public des films n’est pas gage de qualité. En France, des trucs aussi médiocres que « Bienvenue chez les ch’tis » ou « Intouchables », « La grande vadrouille » ou « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » ont empli les salles.
Beaucoup plus que « La grande illusion », « La belle équipe », « Douce », « Madame de… », « L’Atalante », « Un revenant », etc. (je demeure volontairement dans le siècle dernier).
Pour le reste, beaucoup de réalisateurs et d’acteurs ont, comme la plupart des Français, essayé de survivre. Peu de Collabos, peu de Résistants…
En revanche les désastreux accords « Blum-Byrnes » de mai 1946, qui a ouvert le cinéma français à la déferlante de toutes les conneries étasuniennes a donné un coup rude à la production française. Mais, Dieu merci, ne l’a pas tuée.