
Par Pierre Builly.
Trois de Saint-Cyr de Jean-Paul Polin (1938).
Voir et complimenter l’Armée française.
J’ai pu voir Trois de Saint-Cyr le 2 décembre 2013, à l’amphithéâtre Austerlitz du Musée de l’Armée, aux Invalides (2 décembre/Austerlitz : voyez le clin d’œil !). Un aréopage distingué d’anciens Cyrards, mais aussi d’historiens du cinéma (le professeur Jean Tulard, notamment) présentait le film et a apporté d’intéressantes précisions sur quoi je reviendrai.
Que dire du film ? Il a été tourné en 1938, c’est-à-dire au moment où montait, de façon presque inéluctable, le péril allemand : remilitarisation de la rive gauche du Rhin, Anschluss de l’Autriche, dislocation de la Tchécoslovaquie scellée par les accords de Munich, en septembre 38 et il prenait place dans une veine patriotique du cinéma français, qui reflétait de justes inquiétudes, mais qui n’a pas tout de même laissé une grande trace dans les mémoires (Deuxième bureau contre Kommandantur de René Jayet, Le Chemin de l’honneur du même Jean-Paul Polin qui a réalisé Trois de Saint-Cyr).
On peut se demander d’ailleurs pourquoi le cinéma français n’a pas su produire des œuvres intelligentes de qualité exaltant son Armée comme l’ont fait les Étasuniens ou les Britanniques (Les trois lanciers du Bengale) : hors ce qui touche à l’épopée napoléonienne (souvent un chant d’admiration pour le grand homme), les films que l’on pourrait qualifier de patriotiques sont plutôt orientés vers la célébration de la Nation en armes, lors de la Révolution (La Marseillaise, de Renoir) ou vers la révolte des Résistants (La bataille du rail ou L’armée des ombres) ; il y aurait bien un peu Paris brûle-t-il ?, mais qui n’est pas exclusivement centré sur le rôle des soldats, loin de là.
 Toujours est-il que Trois de Saint-Cyr est un témoignage fort intéressant sur l’époque de son tournage, mais sûrement pas un film qui laisse une trace majeure. Cela écrit, je n’ai pas trouvé le film ennuyeux et je lui reconnais de belles qualités.
Toujours est-il que Trois de Saint-Cyr est un témoignage fort intéressant sur l’époque de son tournage, mais sûrement pas un film qui laisse une trace majeure. Cela écrit, je n’ai pas trouvé le film ennuyeux et je lui reconnais de belles qualités.
J’ai failli, hier, lors du débat qui a suivi la projection, demander cum grano salis aux historiens du cinéma présent s’ils ne voyaient pas une analogie entre le film de Polin et Full metal jacket du grand Kubrick : dans l’un et l’autre cas, il y a deux parties : la formation (des Marines ici, des Officiers là) puis le combat (au Vietnam ici, en Syrie là) ; la comparaison s’arrête vite, parce que les deux segments du film de Kubrick sont également magnifiques, et que seul le premier du film de Polin vaut quelque chose.
 Il s’agit donc, dans Trois de Saint-Cyr de présenter, d’abord, la vie de l’École spéciale militaire qui cantonnait alors en Seine-et-Oise avant d’être reconstruite à Coëtquidan après la Guerre, au travers de quelques élèves officiers bien typés : Pierre Mercier (Jean Chevrier) Major de promotion, Paul Parent (Roland Toutain), Père Système de cette promotion (c’est-à-dire selon les rituels de l’École et, à ce titre chargé d’organiser le bizutage des élèves de Première année) et Jean Le Moyne (Jean Mercanton), précisément leur cadet et bizuth. Puis quelques utilités, notamment Jean Parédès, déjà gloussant et tortillant. Tous ces jeunes gens défilent, font de l’ordre serré, ingurgitent des cours de théorie, crapahutent, donnent et subissent brimades idiotes et formatrices.
Il s’agit donc, dans Trois de Saint-Cyr de présenter, d’abord, la vie de l’École spéciale militaire qui cantonnait alors en Seine-et-Oise avant d’être reconstruite à Coëtquidan après la Guerre, au travers de quelques élèves officiers bien typés : Pierre Mercier (Jean Chevrier) Major de promotion, Paul Parent (Roland Toutain), Père Système de cette promotion (c’est-à-dire selon les rituels de l’École et, à ce titre chargé d’organiser le bizutage des élèves de Première année) et Jean Le Moyne (Jean Mercanton), précisément leur cadet et bizuth. Puis quelques utilités, notamment Jean Parédès, déjà gloussant et tortillant. Tous ces jeunes gens défilent, font de l’ordre serré, ingurgitent des cours de théorie, crapahutent, donnent et subissent brimades idiotes et formatrices.
 Les jeunes Parent et Le Moyne sont camarades d’enfance. Le Moyne est, par ailleurs, le fils d’un richissime financier (Léon Bellières) qui ne voit pas d’un bon œil son fils s’engager dans la carrière des armes et le frère de Françoise (Hélène Perdrières), jeune fille pimpante qui tombe immédiatement amoureuse du major Mercier et le séduit elle aussi, bien que le père système Parent essaye de la lui disputer.
Les jeunes Parent et Le Moyne sont camarades d’enfance. Le Moyne est, par ailleurs, le fils d’un richissime financier (Léon Bellières) qui ne voit pas d’un bon œil son fils s’engager dans la carrière des armes et le frère de Françoise (Hélène Perdrières), jeune fille pimpante qui tombe immédiatement amoureuse du major Mercier et le séduit elle aussi, bien que le père système Parent essaye de la lui disputer.
 L’intrigue sentimentale est classique ; la partie consacrée à la révolte des Druzes l’est tout autant et tournée sans grande originalité. Le meilleur est donc la présentation de Saint-Cyr, où Polin a disposé du concours actif des cadres et des élèves, ce qui donne un son d’authenticité au film ; lors de la projection d’hier, d’ailleurs, figurait à la tribune un des cyrards qui a raconté quelques anecdotes de tournage amusantes, notamment l’incapacité de Jean Mercanton à ranger parfaitement son paquetage et de l’aide que lui et ses camarades lui ont apportée.
L’intrigue sentimentale est classique ; la partie consacrée à la révolte des Druzes l’est tout autant et tournée sans grande originalité. Le meilleur est donc la présentation de Saint-Cyr, où Polin a disposé du concours actif des cadres et des élèves, ce qui donne un son d’authenticité au film ; lors de la projection d’hier, d’ailleurs, figurait à la tribune un des cyrards qui a raconté quelques anecdotes de tournage amusantes, notamment l’incapacité de Jean Mercanton à ranger parfaitement son paquetage et de l’aide que lui et ses camarades lui ont apportée.
Ce qui est bien plus enquiquinant est que tous les spécialistes d’histoire militaire réunis hier dans l’amphi Austerlitz relevaient que l’armement français mis en scène – et qui était réellement l’armement de l’Armée française en 1938 – était un matériel archaïque et obsolète, mitrailleuses datant de 1914, fusils Lebel (qui était innovant lors de son adoption en… 1887), chenillettes poussives… Et le professeur Tulard a conclu la séance en indiquant combien il serait intéressant de voir en parallèle les films allemands de la même époque que ceux de Polin, notamment ceux de Karl Ritter…
Si vis pacem, para bellum, comme dit l’autre. ■
DVD à un prix indécent (90 € sur Amazon).
Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

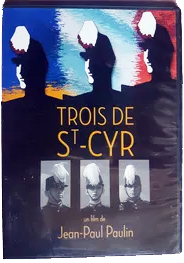












Voir la suite de commentaires à propos d’Alamo.
Merci pour cette analyse sur ce film que je vis en 1940, en pleine drôle de guerre et qui m’a marqué, car le second auquel j’assistais, comme je l’ai dit déjà.
L’armement que j’observais de mes yeux d’enfant m’effarait. Je voyais mon père charger sabre au clair, avec son burnous blanc et rouge de Chasseurs d’Afrique à la Jumenterie de Tiaret et je bénis le ciel et la signature de l’Armistice car les Panzers n’en auraient fait qu’une bouchée. Je revois la carriole tiré par un cheval hectique, le nez dans le picotin, avec un soldat las, tenant les rénes, attendant un gradé au pied de ma maison, et la mitrailleuse embossée à l’arrière, dérisoire pendant que nous suivions sur la carte l’avancée fulgurante de Gudérian.
Clemenceau disait de Joffre: « une merveille d’impréparation militaire », mais alors, en 1940, c’était encore pire… Un simple exemple: nos pilotes de chasse n’avaient pas de liaison radio, alors que les « Boches » comme on disait l’époque, en étaient pourvus. Je tiens celà de mon Colonel de Parachutistes en 1959 qui était dans la chasse en 1940. Lisez de Pierre Ordioni qui a vécu ce drame: « Les Cinq jours de Toul : du 18 au 22 juin 1940 » (Robert Laffont, 1967 ; Éditions du Polygone, 2001). et aussi « Commandos et Cinquième Colonne en mai 1940 : la bataille de Longwy » (Nouvelles Éditions Latines, 1970). C’est absolument édifiant !