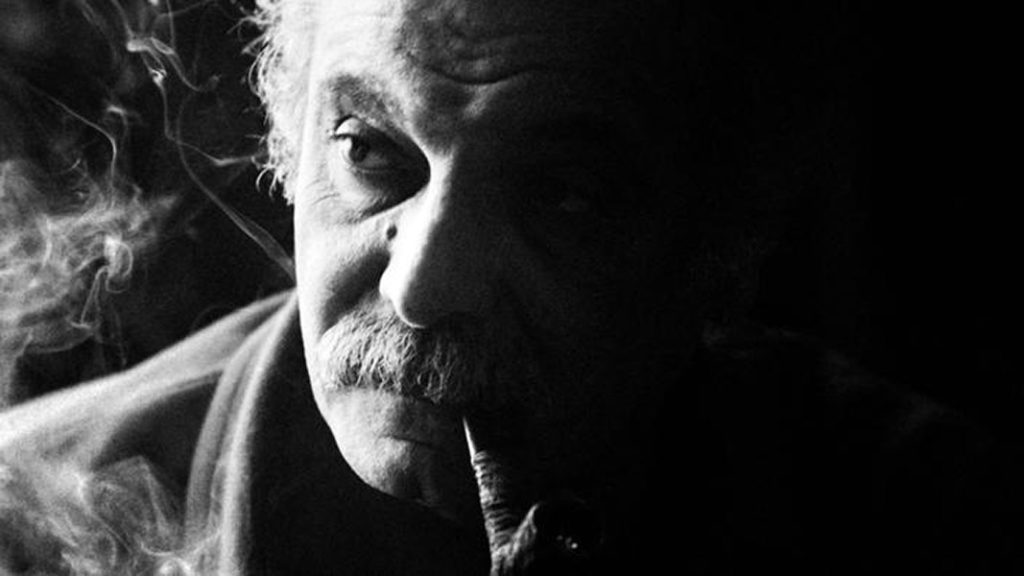
ENTRETIEN par Aziliz Le Corre.
 Paru dans Le Figaro d’hier vendredi 12 novembre. Où il s’agit encore d’un antimoderne à sa façon qui, souvent, force la sympathie pour avoir servi, souvent encore, et de belle manière la poésie française.
Paru dans Le Figaro d’hier vendredi 12 novembre. Où il s’agit encore d’un antimoderne à sa façon qui, souvent, force la sympathie pour avoir servi, souvent encore, et de belle manière la poésie française. ![]()
Dans un essai enlevé, le journaliste Théophane Leroux dresse un portrait de Georges Brassens : bon copain, chanteur gaillard et anarchiste rétif au culte du progrès.
Théophane Leroux est journaliste et auteur de Brassens, à rebrousse-poil aux éditions Première Partie.
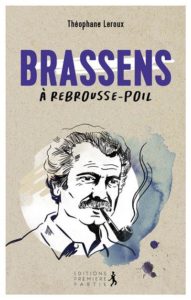 FIGAROVOX. – Vous avez écrit ce livre pendant la crise sanitaire. Brassens aurait-il supporté cet isolement que nous avons connu lors des confinements à répétition ?
FIGAROVOX. – Vous avez écrit ce livre pendant la crise sanitaire. Brassens aurait-il supporté cet isolement que nous avons connu lors des confinements à répétition ?
Théophane LEROUX. – Ce n’est pas forcément facile d’imaginer Brassens confiné. Le personnage est complexe, parfois contradictoire et sa réaction aurait sans doute été à son image : ambivalente. D’un côté, Brassens aimait bien avoir sa tranquillité et voir son pré carré respecté : c’est pour cela qu’il n’a jamais cohabité avec la femme de sa vie, pour ne pas avoir à partager – ou plutôt à subir –les mille petits tracas du quotidien. On peut imaginer qu’il aurait pu se réjouir, à première vue, de pouvoir profiter de la tranquillité forcée, du silence imposé et du temps donné par le confinement.
Mais Brassens, c’est peut-être d’abord le copain par excellence, celui qui laissait porte ouverte à ses différents cercles d’amis. Il est difficile, dans ce cas, d’imaginer qu’il aurait apprécié cette séparation forcée. À quoi bon, sinon, chanter Les copains d’abord ou Au bois de mon cœur ?
J’ai été très frappé en écrivant mon livre du décalage croissant entre ce que je vivais dans mon appartement et ce que Brassens décrivait dans ses chansons : qu’il chante un enterrement, une femme volage ou un arbre, il y a toujours du monde, du brassage, du mouvement, des humains. Brassens est un chanteur incarné, un homme de chair et de sang : je ne suis pas sûr qu’une société du sans contact, des distances sanitaires, des masques et des visières, des enterrements à la va-vite et sous plastique lui aurait convenu. Comme elle ne convient à personne, d’ailleurs.
Si dans l’imaginaire collectif le chanteur fredonne surtout des chansons à boire, diriez-vous que celui-ci est un poète ?
On imagine volontiers Brassens comme auteur de chansons légères ou gaillardes, mais aussi engagées – et toujours dans l’air du temps, n’est-ce pas ? Il n’aimait pas vraiment se définir comme poète, mais il est évident qu’il en est un, peut-être l’un des meilleurs de la seconde moitié du XXe siècle.
L’homme à la moustache, avant de connaître le succès, a lu et relu les grands classiques de la poésie française, de Villon à Hugo en passant par Apollinaire ou Aragon. Il a mis beaucoup de poésies en chanson, et contribué à en sortir quelques-uns de l’oubli, comme Richepin dont il chante Les oiseaux de passage ou Antoine Pol, qu’il a sublimé en chantant Les passantes.
Au-delà de ces filiations, le texte de Brassens est fouillé, truffé de références plus ou moins implicites à la littérature classique. Même dans ses chansons les plus gaillardes : «Je suis hanté : le rut, le rut, le rut, le rut !» dans Le Bulletin de santé est une parodie évidente de Mallarmée : «Je suis hanté ! L’Azur ! L’Azur ! L’Azur ! L’Azur !» Mais Brassens n’est pas qu’un aimable imitateur : ses textes sont somptueux, polis par les années de travail – Supplique pour être enterré sur la plage de Sète lui a pris sept ans d’écriture – et certains traverseront sans doute les siècles, comme ceux de Villon, son modèle. Et Brassens n’est pas non plus qu’un grand auteur de texte : c’est aussi un excellent musicien, dont les musiques sont travaillées d’arrache-pied pour paraître simples.
Peut-on définir cet homme à la pipe et à la moustache comme un anti-moderne ?
Tout dépend de ce que vous entendez par anti-moderne : s’il s’agit d’une personne rétive à toute forme d’innovation, une sorte d’ours réactionnaire, ce n’est pas le cas. Brassens adulait les nouvelles technologies de son époque, il collectionnait les enregistreurs et les caméras – et les armes aussi – dont il était fasciné.
Cela dit, l’ensemble de ses textes et de ses déclarations tendent à prouver chez lui un vrai amour pour le passé, qui se teinte parfois d’une certaine nostalgie. On pourrait faire une longue liste des chansons de Brassens qui font l’éloge d’un passé plus ou moins fantasmé : du Moyenâgeux, dans laquelle il déclare ne regretter qu’une seule chose : de n’être pas né au Moyen-Âge aux Châteaux de sable où il chante la nostalgie de son enfance, il y a toute une palette de l’histoire de France qui se révèle sous nos yeux.
Mais Brassens se fait aussi le féroce contempteur des aberrations de son temps : il regrette que sa ville natale, Cette, ait été rebaptisée Sète pour ne pas être confondu avec le pronom. Il brocarde le progrès forcené et la bétonisation qu’il constate tous les jours : «Dieu merci ! Le béton, les Romains l’ignoraient. / Leurs ruines sont si belles qu’on en mangerait ! / Taudis à retardement. Le béton est un con !» écrivait-il dans son carnet. Il regrette le désenchantement du monde dans Le grand pan, il s’indigne avec Bruant de la gentrification de Paris en reprenant La place Maubert… Décroissant avant Greta, il crée un éphémère Parti préhistorique et conchie le progrès dans une chanson, Le Progrès, où il s’offusque de la perte du charme et de la poésie des petites choses du quotidien… En cela, Brassens est bien anti-moderne.
Quel était son rapport à la politique ?
Brassens est passé d’un anarchisme militant à une position plus tempérée, et plus individualiste. Le Brassens qui meurt à soixante ans n’est plus capable de crier «mort aux vaches !» ou «à bas la calotte !» : il a rencontré des personnes l’ayant fait réfléchir à ses idées. Il n’en demeure pas moins fidèle à un idéal anarchiste que l’on peut résumer avec les paroles de Don Juan : «Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacro-saint / se borne à ne pas trop emmerder ses voisins».
Le chanteur disait souvent qu’il n’avait pas de «solution collective» à proposer aux autres, et qu’il se contentait donc – plutôt avec succès, au vu des nombreux témoignages – à être aussi sympathique que possible avec son prochain. Il détestait les groupes, la masse, les foules, les endoctrineurs et les endoctrinés. Brassens est conscient que chaque idéologie peut contenir en germe une dictature, et que, bien souvent, le combat politique ne se fait que pour prendre le pouvoir des mains de l’autre. Nombre de ses chansons brocardent les manifestations bruyantes et les émeutes. Brassens a détesté la période de Mai 68, au grand dam de beaucoup de ses admirateurs, qui n’applaudissaient sa liberté que lorsqu’elle flattait leurs idées. Lorsqu’on lui demandait ce qu’il avait fait durant ce fameux mois de mai, il répondait : «des calculs rénaux».
Je me permets de reprendre le titre d’un de vos chapitres… «Et Dieu dans tout ça» ?
Juger de la relation entre un homme et Dieu est toujours une chose délicate, je n’ai en tout cas pas eu accès aux archives que Saint-Pierre doit tenir dans le firmament, et n’étant pas pape, il m’est impossible d’inscrire Georges Brassens au canon de l’Église catholique.
On a toujours en tête l’image d’un Georges Brassens anticlérical et athée militant. On l’aura compris, la réalité est bien plus complexe que la caricature que les brassensistes «canal historique» veulent bien colporter. L’étude des textes, des carnets et des déclarations de Brassens montre qu’il n’était pas du tout catégorique sur la question de l’existence de Dieu. Ses chansons sont truffées de références bibliques, de références à Dieu – le fameux «Père éternel» de la Chanson pour l’auvergnat – et il a déclaré sans aucun complexe que son poème préféré était la Bible et son poète préféré, le Christ.
Il a passé son temps à souffler le chaud et le froid à ce sujet. Un jour, il disait «Dieu, s’il existait, comme je l’aimerais !», et un autre, il écrivait dans son carnet : «je crois en Dieu, mais comme je suis un menteur, je dis le contraire». Tout en se moquant des bigots et des hypocrites, il confessait croire en une «présence», inculquée par sa mère, une bigote d’origine italienne.
S’il n’avait pas réussi à trancher cette question, il estimait tout de même – et sans doute à raison – vivre de manière suffisamment honnête et bienveillante pour être considéré comme chrétien. Il a déclaré un jour : «Je suis un chrétien dans ce qui est essentiel parce que j’aime vraiment les gens. Je me dis que, si Dieu existe, il n’accueillera pas trop mal Brassens». Nous avons toutes les raisons de penser comme lui. ■
Brassens, à rebrousse-poil, Théophane Leroux, éditions Première Partie, 142 p., 16€. Éditions Première Partie












Brassens nous a montré comment retrouver notre passé, notre histoire. Je souscrit au jugement qu’il s’agit d’un des plus grands poètes du XXème siècle. Dans les années soixante j’ai eu une amie suédoise dont le prof de français faisait travailler les textes de Brassens. Le voir sur scène tissait immédiatement un lien d’empathie. Je pense que le Seigneur l’a accueilli car il a chanté et donné de l’amour.