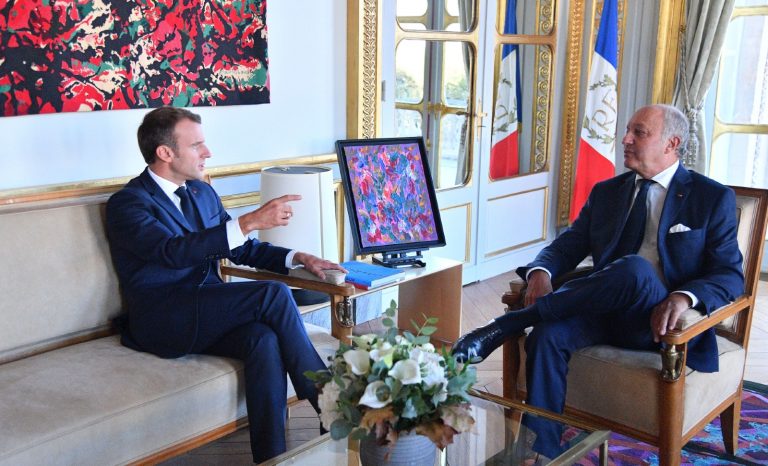
Par Jérôme Blanchet-Gravel
 Cet intéressant entretien réalisé par Jérôme Blanchet-Gravel avec l’avocat Ghislain Benhessa, est paru dans Causeur le 23 novembre. Sur les points discutables de cet entretien, la sagacité du lecteur s’exprimera, comme toujours ici. Nous avons dit, quant à nous, nos réserves sur cette sorte d’unanimité à croire que les Institutions forgées par De Gaulle en 1958 disposeraient des qualités pérennes que ce dernier leur attribuait ou feignait de leur attribuer, pensant qu’en tout cas, elles dureraient bien autant que lui. Les mécanismes profonds de la démocratie à la française nous semblent avoir eu raison de tout ce qu’elles pouvaient contenir de positif en leur origine. Elles ont vécu ce que vivent les roses. Et la question du régime utile à la France nous paraît rester posée.
Cet intéressant entretien réalisé par Jérôme Blanchet-Gravel avec l’avocat Ghislain Benhessa, est paru dans Causeur le 23 novembre. Sur les points discutables de cet entretien, la sagacité du lecteur s’exprimera, comme toujours ici. Nous avons dit, quant à nous, nos réserves sur cette sorte d’unanimité à croire que les Institutions forgées par De Gaulle en 1958 disposeraient des qualités pérennes que ce dernier leur attribuait ou feignait de leur attribuer, pensant qu’en tout cas, elles dureraient bien autant que lui. Les mécanismes profonds de la démocratie à la française nous semblent avoir eu raison de tout ce qu’elles pouvaient contenir de positif en leur origine. Elles ont vécu ce que vivent les roses. Et la question du régime utile à la France nous paraît rester posée. ![]()
Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’État de droit a progressivement changé de forme. Dans un nouvel essai (Le Totem de l’État de droit, concept flou, conséquences claires, L’artilleur) l’avocat Ghislain Benhessa déplore le déclin des souverainetés au profit d’un État de droit mal défini aux allures de fourre-tout progressiste.
Jérôme Blanchet-Gravel. L’une des thèses centrales de votre livre est que l’État de droit est passé d’une simple architecture juridique sous forme de hiérarchie des normes, à une notion floue dont on se sert pour restreindre la souveraineté des peuples et des parlements… Comment revenir à l’équilibre d’antan entre le politique et le juridique? Est-ce encore possible ?
Ghislain Benhessa. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’État de droit a progressivement changé de forme. Pour faire court, on est passé d’un principe fonctionnel – une pyramide des normes avec à son sommet la Constitution – à un attelage composite de droits et de libertés hétérogènes au service, d’abord de l’individu, ensuite des minorités. Cette révolution est le résultat combiné du traumatisme de la Shoah et de la prise de pouvoir des juges. D’un côté, on a édifié des barrières de protection pour éviter les horreurs passées et assurer, en toutes circonstances, la défense des libertés individuelles. De l’autre, on a voulu mettre la politique sous la surveillance des juges, érigés en contre-pouvoir ultime.
C’est le sens du développement de la Cour de justice de l’Union européenne, bras armé du droit sécrété par les instances de Bruxelles, et de la Cour européenne des droits de l’Homme – étant précisé que leurs jurisprudences se nourrissent l’une de l’autre. Le problème, c’est qu’à mettre sous surveillance la politique, on a confié les clefs du camion aux juges qui, dans l’ombre des prétoires, par la grâce de décisions que seuls les initiés connaissent, en sont venus à mettre la démocratie sous tutelle. Y compris dans des domaines régaliens par excellence – immigration, insécurité, éducation, armée –, l’office des juges a une influence directe, au nom du respect des valeurs de l’État de droit, dont le sacro-saint principe de non-discrimination.
Toutefois, je ne crois pas que cette situation soit immuable. Qui aurait imaginé, il y a quelque temps, des candidats de droite comme Michel Barnier, ancien commissaire européen, appeler à la mise en place d’un «bouclier constitutionnel» pour sanctuariser la capacité d’agir de la France face aux assauts des juges européens? Et je ne parle même pas de la remise en cause du droit du sol, partagée par la plupart des candidats LR, comme de leur insistance sur le référendum, considéré, jusqu’il y a peu de temps, comme un outil d’extrême droite… Évidemment, le chemin est encore long, et certaines promesses sonnent davantage comme des postures électorales que comme des changements concrets. Il n’empêche qu’au moment même où l’Europe fait tout pour sanctionner les pays de l’Est – Pologne et Hongrie en tête – au nom des valeurs de l’État de droit et de la suprématie de sa jurisprudence, nos politiques redécouvrent, en parallèle, les vertus de la souveraineté populaire! Certes, le combat ne fait que commencer. Mais il s’amorce.
L’un des thèmes classiques de la science-fiction est l’Homme qui finit esclave de la technologie qu’il a lui-même créée. De la même manière, avons-nous créé un «monstre» auquel nous sommes maintenant enchaînés, l’État de droit ?
Absolument. À l’origine, l’État de droit est une construction née du cerveau de quelques juristes au début du XXème siècle, l’Autrichien Hans Kelsen en tête. Certes, on en trouve des traces auparavant, notamment dans les pays anglo-saxons, attachés à ce qu’ils nomment le Rule of Law, considéré, à tort, comme l’équivalent de notre État de droit. Toutefois, la «machine» de l’État de droit que nous connaissons est le fruit d’une construction artificielle jaillie, couche par couche, durant les dernières décennies. Partir du principe que le droit pouvait réguler la politique, l’enserrer dans des limites n’était pas, en soi, une idée stupide. Le problème, c’est que «tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser», pour reprendre la célèbre formule de Montesquieu.
Or, en pensant que le droit serait objectif par rapport à la politique, que le travail des juges serait neutre car dépendant de la règle qu’ils appliquent, on a oublié que, par nature, la jurisprudence est elle-même politique. Il n’y a pas, d’un côté, des juges hors-sol et sans affect, consacrés à l’application du droit pur et parfait et, de l’autre, d’obscurs politiques mus par le seul désir de satisfaire les bas instincts du peuple. La prise de pouvoir des juges a fait basculer l’Occident – et avant tout l’Europe – dans le fantasme d’un monde pacifié par le règne du droit. C’est là l’erreur majeure, qui résulte autant de la naïveté de nos dirigeants que de la victoire de l’idéologie de la culpabilité et du ressentiment.
Au fond, la montée en puissance de l’État de droit a fait croire qu’à terme, l’idéal kantien de la paix perpétuelle pouvait triompher. C’est évidemment faux, et certains en prennent enfin conscience. Mais déconstruire une machine aussi bien huilée – et dont les dévots sont légion – prendra beaucoup de temps. D’autant qu’en classant immédiatement les sceptiques parmi les populistes et les extrémistes, nos élites ne font pas grand-chose pour accepter le dialogue et ouvrir le débat.
Dans un passage surprenant, vous dites que l’État de droit est appelé à survivre à la crise sanitaire. En êtes-vous certain, alors que la plupart des États dans le monde ont récupéré une grande partie d’un pouvoir dont plusieurs abusent encore aujourd’hui ?
C’est là l’une des grandes perversités de l’idéologie qui sous-tend l’État de droit et que je nomme, dans mon livre, l’échelle des libertés. D’une part, la plupart des pays occidentaux se soumettent chaque jour davantage à l’idéologie diversitaire portée par les associations et les groupes de pression. La liberté de changer et de rechanger de sexe, maintes fois célébrée par la Cour européenne des droits de l’Homme, vise à permettre à chacun de s’auto-construire au nom de sa fluidité de genre. Sous ce prisme, l’État de droit comme promotion des libertés – et correction de toutes les discriminations – a de beaux jours devant lui.
D’autre part, la crise sanitaire a révélé combien ce qu’on peut appeler les «vieilles» libertés – dont l’une des plus essentielles, celle de sortir de chez soi – sont bien plus aisément suppressibles que les nouvelles libertés des minorités actives. Au fond, l’État de droit est soucieux des libertés «à la pointe» qui correspondent aux revendications des minorités luttant contre leur «invisibilisation», pour reprendre le lexique à la mode, alors qu’il traite avec mépris les libertés élémentaires. C’est ce paradoxe que la Covid-19 a révélé au grand jour. Émettre le moindre doute quant au règne du tout-sanitaire conduit à la mort sociale – preuve en est l’opprobre jeté sur les opposants au passe sanitaire –, au même moment où le Robert ajoute le pronom «iel» dans son dictionnaire. C’est pourquoi je tente d’expliquer l’idéologie qui se cache derrière la mainmise croissante de l’État de droit. Elle n’est pas neutre, et reflète la grille de lecture plaquée sur les libertés.
Vous associez étroitement la montée de l’État de droit en France comme nouvelle «valeur suprême» à la construction européenne et à la philosophie de Jürgen Habermas. Comptez-vous sur Éric Zemmour pour rétablir le modèle gaulliste que vous défendez ?
Comme sur nombre de sujets – l’immigration, l’insécurité, etc. –, Éric Zemmour sort le bazooka pour tirer sur l’État de droit. Si certains se sont déjà offusqués, avant lui, de l’emprise délirante des juges européens sur la capacité d’action de la France, il a imposé à heure de grande écoute un thème jusque-là réservé aux experts, la plupart du temps soumis à la chape de plomb du politiquement correct.
Vous savez, il suffit de suivre un cours de première année de fac de droit pour s’apercevoir qu’en toute quiétude et sans la moindre réserve, les étudiants intègrent que la France est soumise au droit international, qu’elle doit se conformer aux décisions des juges européens, comme si cela allait de soi. Alors que la Constitution est l’instrument sacré du peuple souverain, la mise sous tutelle de la France est enseignée comme un présupposé. Le Général de Gaulle se retournerait dans sa tombe… Éric Zemmour a le mérite d’avoir mis le sujet sur la table, rappelant, à juste titre, que dans la perspective de de Gaulle, le président de la République devait être le gardien de la Constitution. Pas le Conseil constitutionnel, comme ce dernier l’affirme depuis la mort du Général.
En revanche, par-delà la figure de Zemmour, je pense que tous ceux qui croient en la pérennité de nos institutions devraient se souvenir des leçons du gaullisme constitutionnel. L’avenir ne passe pas par un « grand soir » mais par un retour aux origines. À notre époque de tabula rasa et de cancel culture, un peu d’histoire nous ferait le plus grand bien. ■
Auteur et journaliste. Dernier livre paru: La Face cachée du multiculturalisme (Éd. du Cerf)













