
PAR MATHIEU BOCK-CÔTÉ.
 Cette chronique est parue dans Le Figaro du 21 mai. L’analyse de Mathieu Bock-Côté nous paraît parfaite et aisément intégrable pour un esprit de formation maurrassienne. !
Cette chronique est parue dans Le Figaro du 21 mai. L’analyse de Mathieu Bock-Côté nous paraît parfaite et aisément intégrable pour un esprit de formation maurrassienne. ! ![]()
CHRONIQUE – Le technocrate est jugé sans âme, et réputé ne voir la société que dans une perspective comptable. Et pourtant, encore une fois, il arrive que la classe politico-médiatique chante ses vertus.
 « le politique est inscrit dans la nature humaine, et on ne peut le refouler ou le nier sans qu’il ne surgisse tôt ou tard dans la cité »
« le politique est inscrit dans la nature humaine, et on ne peut le refouler ou le nier sans qu’il ne surgisse tôt ou tard dans la cité »
Technocrate: depuis les premières rumeurs la conduisant à Matignon, jusqu’à sa nomination cette semaine au poste de premier ministre, c’est ainsi qu’on a d’abord présenté Élisabeth Borne. Le terme est équivoque: il se réfère tout à la fois à une figure politique terne, sans charisme, et à une compétence technique supérieure, définissant une personne «connaissant bien ses dossiers». Le terme passe rarement pour un compliment: le technocrate est jugé sans âme, et réputé ne voir la société que dans une perspective comptable. Et pourtant, encore une fois, il arrive que la classe politico-médiatique chante ses vertus: à la différence des politiques sensibles aux humeurs populaires et aux diktats de l’opinion publique, et pour cela toujours tentés par la démagogie, le technocrate ferait les choix éclairés.
Il faut toutefois aller au-delà de cette définition mi-figue mi-raisin pour voir de quelle manière la figure du technocrate, aujourd’hui, s’inscrit dans une mutation bien plus large de l’imaginaire politique occidental. Longtemps, presque de tout temps, on admettait que la politique avait une charge irréductiblement passionnelle. Ce terme ne doit pas être entendu comme un synonyme d’irrationnel mais nous rappelle simplement que la politique engage l’homme existentiellement, que la cité touche l’âme des individus et des peuples, et que les grands projets qui s’affrontent dans la vie publique témoignent de conceptions contrastées et souvent conflictuelles de l’être humain. C’est ce qui a poussé les hommes à s’engager, à sacrifier souvent leur bien-être matériel, et quelquefois leur vie, lorsqu’ils ont occupé les fonctions liées à la mission régalienne de l’État.
Mais notre époque entend assécher les passions politiques: à tout le moins, tel est le pari de la modernité crépusculaire, qui n’imagine plus le débat public comme un affrontement civilisé entre grands projets mais comme une entreprise de disciplinarisation de la société, où une classe de sachants impose les réformes qui seraient les seules possibles pour qu’une société conserve son rang dans la mondialisation. Telle est la fonction du technocrate: sans poésie, mais avec réalisme, il représenterait la meilleure part du métier de politique, délivré du vil souci d’avoir à flatter les masses, et gérant les processus modernisateurs se dérobant à la querelle publique. Voyons-y une pathologie politique propre à la modernité. De là le congédiement des enjeux «identitaires» et civilisationnels, assimilés aux passions tristes. La réduction du politique aux politiques publiques caractérise cette désymbolisation de l’État, pour reprendre la formule de Régis Debray.
Cela se voit dans la représentation dominante du débat public: à l’affrontement entre la gauche et la droite, ou entre les mondialistes et les populistes, ou entre les progressistes et les conservateurs, se substitue celui entre le camp de la raison et les extrêmes. Le politique vient ainsi s’abolir dans la raison technocratique. La délibération devient inutile: elle est remplacée par la pédagogie. Ceux qui savent expliquent à ceux qui ne savent pas. Quant à ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas savoir, il faudra les combattre. De ce point de vue, l’affrontement entre le camp de la raison et les extrêmes réintroduit une charge affective dans la politique, mais il s’agit d’une charge empoisonnée, puisqu’il s’agit désormais de bannir ou même d’éradiquer de la cité son résidu archaïque, en en finissant politiquement et sociologiquement avec les catégories de la population qui continuent de plébisciter l’ancien monde en votant pour les partis qui prétendent le continuer. Il n’est pas rare qu’on assimile son refus de se laisser dissoudre à une forme de haine et de ressentiment. Contre ce résidu, tout est permis.
Mais la figure du technocrate révèle vite ses limites. Le marketing politique, qui se présente comme une opération de manipulation de l’univers symbolique, cherche alors à lui fournir un supplément d’âme. Mais il y a quelque chose de contre-nature à vouloir arraisonner selon les codes de la rationalité technicienne la charge existentielle de la vie d’un peuple. L’univers symbolique, celui des affects et des passions, est intégralement soumis à l’empire de la technique. La société devient intégralement planifiable: la négation du politique culmine dans un rationalisme et un constructivisme exacerbés. La société devient une pure production des gestionnaires qui croient possible de l’extraire du tragique et de l’histoire, en la soumettant à la rationalité du plan – désormais, de la planification écologique. Mais toujours le politique se venge – si on préfère le dire autrement, le réel reprend ses droits. Car le politique est inscrit dans la nature humaine, et on ne peut le refouler ou le nier sans qu’il ne surgisse tôt ou tard dans la cité, aussi fortement qu’on l’aura réprimé. ■

Mathieu Bock-Côté
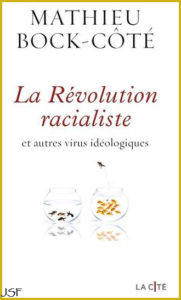 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Sélection photos © JSF












Tout cela ne date pas d’hier, hélas ! Une des premières bouffées de mépris que j’ai ressenties pour Giscard d’Estaing a été le démantèlement, en septembre 1974, du plus beau paquebot du monde, le « France », sous prétexte qu’il n’était pas rentable…
Giscard a été le prélude et l’initiateur de tous nos renoncements.
Quel bonheur d’avoir avec mon petit suffrage, contribué à le battre en 1981 ! Mitterrand, au moins, avait le sens de la grandeur.
D’accord avec toi Pierre comme presque toujours!
ma détéstation de Giscard vient d’un soir ou Président de la République Française il nfait une encyclique aux termes de la quelle il dit , avec sa bouchen cul de poule »la France est une puissace MOYEEEEEEENNE!
et bien entendu j’ai voté MITTERRAND!
BV