
II.
À cette époque, se trouvait à Moscou une princesse géorgienne, personnalité douteuse, presque suspecte. Elle frisait déjà la quarantaine. Dans sa jeunesse, elle avait probablement fleuri de cette beauté particulière aux Orientales, qui se flétrit si vite. Maintenant, elle se mettait du blanc, du rouge, et se teignait les cheveux en jaune. Des bruits divers, qui n’étaient ni très avantageux, ni très clairs, couraient sur son compte ; personne n’avait connu son mari, et elle n’avait jamais habité longtemps la même ville.
On ne lui connaissait ni famille ni fortune, et pourtant elle vivait assez ouvertement à crédit ou d’autre façon ; elle tenait, comme on dit, un salon, et recevait une société quelque peu mêlée : des jeunes gens, pour la plupart. Tout dans sa maison, à commencer par sa toilette, ses meubles, sa table, et en finissant par ses équipages et ses domestiques, tout portait le cachet de quelque chose de passager, de médiocre, de « camelote » en un mot. Mais ni la princesse ni ses visiteurs ne semblaient exiger mieux. La princesse avait la réputation d’être amateur de musique, de littérature et protectrice des arts et des artistes ; et, en effet, elle s’intéressait à toutes les choses jusqu’à l’exaltation, exaltation qui n’était pas tout à fait factice. Évidemment, il y avait en elle une petite veine esthétique. De plus, elle était très accessible, très aimable, bon enfant même, et, ce que beaucoup ne soupçonnaient pas, elle avait le cœur tendre et très compatissant, qualités rares et d’autant plus précieuses dans des personnes de ce genre ! « C’est une écervelée, avait dit d’elle un plaisant ; mais elle ne peut rater son paradis, car elle pardonne tout et tout lui sera pardonné ! » On disait aussi d’elle que, lorsqu’elle disparaissait de quelque ville, elle y laissait autant de gens à qui elle avait fait du bien que de créanciers.
Kupfer, comme il fallait s’y attendre, fut introduit dans la maison. Il devint bientôt intime, trop intime, disaient les mauvaises langues. Quant à lui, il parlait toujours de la princesse, non seulement avec affection, mais avec respect. Il la traitait de femme d’or. Quoi qu’on en dît, il croyait fermement et à son amour de l’art et à son intelligence de l’art.
Voici qu’un jour, étant à dîner chez les Aratov, après avoir longuement causé de la princesse et de ses soirées, Kupfer se mit à tâcher de persuader Jacques de quitter, ne fût-ce que pour une fois, sa vie d’anachorète et de lui permettre de le présenter à sa chère amie : Jacques commença par ne rien vouloir entendre. « Mais que t’imagines-tu ? s’écria enfin Kupfer ; de quelle sorte de présentation s’agit-il ? Je te prendrai tout bonnement comme te voilà là, en redingote, et je te mènerai à l’une de ses soirées. Point d’étiquette chez elle, frère ! Tu es un savant, toi, tu aimes la littérature et la musique. (Dans le cabinet d’Aratov se trouvait en effet un pianino, sur lequel il prenait quelquefois des accords diminués.) Eh bien ! dans sa maison, il y a de tout cela, en veux tu, en voilà ; tu y rencontreras aussi des gens sympathiques, sans prétention ! Et puis, enfin, il est impossible à ton âge et avec ton extérieur… (Aratov baissa les yeux et fit un mouvement de la main), oui, oui, avec ton extérieur, de fuir ainsi le monde, la société. Ce n’est pas chez des généraux que je te mène, d’autant plus que je ne connais pas moi-même de généraux. Ne fais pas l’obstiné, mon petit pigeon. La morale est une bonne et respectable chose, mais il ne faut pas la pousser jusqu’à l’ascétisme… Tu ne te prépares pas à devenir moine, n’est-ce pas ? »
Aratov pourtant continuait à faire l’obstiné ; mais à l’aide de Kupfer vint inopinément Platonida. Quoi qu’elle ne comprit pas bien ce que voulait dire ce mot « ascétisme », elle trouva aussi que son petit Jacques ferait bien de se distraire, et, comme on dit, de voir et se faire voir.
– D’autant plus, ajouta-t-elle, que j’ai la plus grande confiance en Féodor Féodovitch et il ne te mènera pas dans un endroit qui ne soit…
– Je vous le ramènerai dans toute son impeccabilité, s’écria Kupfer, sur lequel Platonida, malgré toute sa confiance, jetait des regards inquiets.
Aratov rougit jusqu’aux oreilles, mais cessa de protester.
 La conclusion fut que, dès le jour suivant, Kupfer le mena à une soirée chez la princesse. Mais Aratov n’y resta pas longtemps. En premier lieu, il y trouva une vingtaine de visiteurs, hommes et femmes, sympathiques peut-être, mais qui, dans tous les cas, lui étaient étrangers ; et cela le gênait, quoiqu’il n’eût pas l’occasion de beaucoup causer, ce qu’il redoutait par-dessus tout. En second lieu, la maîtresse de la maison ne lui plut pas, quoiqu’elle l’eût reçu d’une façon simple et affable. Tout en elle lui déplaisait : ce visage maquillé, ces cheveux jaunes ébouriffés et cette voix enrouée et douceâtre, ce rire chevrotant, cette façon de rouler ses yeux vers le ciel, cet excès de décolletage et surtout ces mains grasses et luisantes chargées de bagues. S’étant fouillé dans un coin, Aratov tantôt parcourait rapidement les visages des visiteurs, ne pouvant trop les distinguer les uns des autres, tantôt regardait obstinément ses propres pieds. Quand enfin un artiste étranger, au visage fatigué, aux longs cheveux gras, avec un carreau de verre enchâssé sous un sourcil froncé, se plaça au piano, et, ayant frappé des deux mains sur le clavier et du pied sur la pédale, se mit à pourfendre une fantaisie de Liszt sur des thèmes de Wagner, Aratov n’y tint plus et disparut, emportant dans son âme une impression lourde et confuse, à travers laquelle perçait pourtant quelque chose dont il ne se rendait pas compte, quelque chose de significatif et même de menaçant. ■ (À suivre).
La conclusion fut que, dès le jour suivant, Kupfer le mena à une soirée chez la princesse. Mais Aratov n’y resta pas longtemps. En premier lieu, il y trouva une vingtaine de visiteurs, hommes et femmes, sympathiques peut-être, mais qui, dans tous les cas, lui étaient étrangers ; et cela le gênait, quoiqu’il n’eût pas l’occasion de beaucoup causer, ce qu’il redoutait par-dessus tout. En second lieu, la maîtresse de la maison ne lui plut pas, quoiqu’elle l’eût reçu d’une façon simple et affable. Tout en elle lui déplaisait : ce visage maquillé, ces cheveux jaunes ébouriffés et cette voix enrouée et douceâtre, ce rire chevrotant, cette façon de rouler ses yeux vers le ciel, cet excès de décolletage et surtout ces mains grasses et luisantes chargées de bagues. S’étant fouillé dans un coin, Aratov tantôt parcourait rapidement les visages des visiteurs, ne pouvant trop les distinguer les uns des autres, tantôt regardait obstinément ses propres pieds. Quand enfin un artiste étranger, au visage fatigué, aux longs cheveux gras, avec un carreau de verre enchâssé sous un sourcil froncé, se plaça au piano, et, ayant frappé des deux mains sur le clavier et du pied sur la pédale, se mit à pourfendre une fantaisie de Liszt sur des thèmes de Wagner, Aratov n’y tint plus et disparut, emportant dans son âme une impression lourde et confuse, à travers laquelle perçait pourtant quelque chose dont il ne se rendait pas compte, quelque chose de significatif et même de menaçant. ■ (À suivre).
Textes et images rassemblés par Rémi Hugues.
Nouvelle à paraître à l’automne 2022 éditée chez B2M.
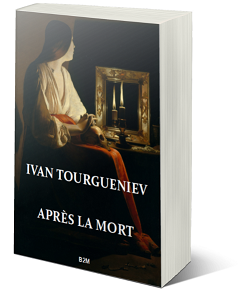
Commande ou renseignement : B2M – Belle-de-Mai Éditions commande.b2m_edition@laposte.net











