
IV.
Une grande salle dans une maison particulière de l’Ostojenka était à moitié pleine de visiteurs quand Aratov et Kupfer y firent leur entrée. On donnait quelquefois des représentations théâtrales dans cette salle ; mais cette fois on n’y voyait ni décors ni rideau. Les ordonnateurs de la matinée s’étaient contentés d’élever une estrade et d’y placer un piano, une paire de pupitres, quelques chaises et une table avec un verre d’eau. On avait suspendu un morceau de drap rouge devant la porte de la pièce réservée aux exécutants. La princesse, vêtue d’une robe d’un vert éclatant, était déjà installée au premier rang des sièges. Aratov prit place non loin d’elle, après avoir échangé un rapide salut.
Le public était mélangé. C’était, pour la plupart, de jeunes étudiants de diverses écoles. Kupfer, en sa qualité de commissaire, une rosette blanche sur le revers de son habit, se démenait de son mieux ; la princesse, visiblement agitée, se tournait, envoyait des sourires dans toutes les directions, interpellait ses voisins : il n’y avait autour d’elle que des hommes. Le premier sur l’estrade apparut un flûtiste, d’apparence étique ; il crachota, je veux dire il sifflota, un petit morceau tout aussi étique que lui-même. Deux messieurs crièrent bravo ! Puis vint un gros monsieur à lunettes, d’une apparence grave et même sévère, qui lut avec une sourde voix de basse un récit humoristique de Stchedrine. Le récit fut applaudi, pas le lecteur. Puis apparut le pianiste déjà connu d’Aratov.
Il tambourina sa même fantaisie de Liszt. Celui-là fut gratifié d’un rappel ; il saluait, la main appuyée sur le dossier de la chaise, et, après chaque inclination, il rejetait les cheveux en arrière, tout à fait comme Liszt. Enfin, après un assez long intervalle, le drap rouge remua, puis fut brusquement écarté – et Clara Militch parut.
Les applaudissements éclatèrent. Elle s’avança sur l’estrade d’un pas indécis ; elle s’arrêta, ayant croisé devant elle ses mains, belles mais grandes et non gantées, et resta immobile, sans faire de révérence, sans incliner la tête et sans sourire.
C’était une jeune fille de dix-neuf ans, grande, bien faite, un peu large d’épaules, le teint basané, d’un type moitié juif, moitié bohémien. Des yeux petits, très noirs sous d’épais sourcils qui se rejoignaient presque au-dessus d’un nez très droit et un peu court du bout, des lèvres fines à la courbe élégante, une énorme tresse noire, lourde même à l’œil, un front bas et immobile, comme en pierre, et de toutes petites oreilles, l’expression du visage rêveuse, presque farouche… Une nature passionnée, volontaire, sans grande bonté, sans grand esprit, mais certainement douée, se montrait dans toute sa personne.
Pendant quelque temps elle se tint les yeux baissés ; puis tout à coup elle se redressa, promenant sur les rangs des spectateurs son regard lent et triste, mais non attentif, et comme replié en lui-même. « Quels yeux tragiques elle a ! » remarqua un vieux beau à cheveux gris, avec un visage de cocotte allemande, collaborateur et correspondant de journaux, bien connu à Moscou, qui se tenait derrière Aratov.
Ce vieux beau était bête et ne disait que des bêtises, mais cette fois il avait raison. Aratov, qui, depuis l’apparition de Clara, ne l’avait pas quittée des yeux, se souvint seulement alors qu’effectivement il l’avait vue chez la princesse, et que non seulement il l’avait vue, mais qu’il avait remarqué que plusieurs fois son regard sombre s’étant fixé sur lui avec insistance. Et même maintenant,… ou bien se trompait-il ?
 L’ayant aperçu au premier rang, elle parut ressentir un mouvement de joie, rougit et le regarda de nouveau fixement ; puis, sans se retourner, elle recula de deux pas vers le piano, où déjà était assis son accompagnateur, l’artiste étranger aux longs cheveux. Elle devait chanter la romance de Glinka : « Dès que je t’ai connu… » Elle commença aussitôt, sans changer la pose de ses mains et sans regarder la musique. Elle avait une voix de contralto, sonore et veloutée ; elle prononçait les paroles avec une précision un peu lourde, son chant était monotone, sans nuances, mais pathétique. « Elle chante avec conviction, cette fille ! » remarqua de nouveau le vieux beau assis derrière Aratov, et de nouveau il disait vrai.
L’ayant aperçu au premier rang, elle parut ressentir un mouvement de joie, rougit et le regarda de nouveau fixement ; puis, sans se retourner, elle recula de deux pas vers le piano, où déjà était assis son accompagnateur, l’artiste étranger aux longs cheveux. Elle devait chanter la romance de Glinka : « Dès que je t’ai connu… » Elle commença aussitôt, sans changer la pose de ses mains et sans regarder la musique. Elle avait une voix de contralto, sonore et veloutée ; elle prononçait les paroles avec une précision un peu lourde, son chant était monotone, sans nuances, mais pathétique. « Elle chante avec conviction, cette fille ! » remarqua de nouveau le vieux beau assis derrière Aratov, et de nouveau il disait vrai.
 Les cris : Bis, bravo ! retentirent de tous côtés ; mais elle jeta un regard rapide sur Aratov qui ne criait ni n’applaudissait, – le chant de cette fille aux yeux sombres ne lui avait pas autrement plu, – fit un léger salut, et s’éloigna sans accepter le bras arrondi que lui présentait le pianiste chevelu. On la rappela, mais elle se fit attendre. Puis, revenant du même pas incertain, elle dit deux mots à voix basse à l’accompagnateur, qui dut changer la musique qu’il avait préparée, et elle se mit à chanter la romance de Tchaïkovski : « Celui-là seul qui connaît le désir de revoir… » Elle chanta cette romance tout autrement que la première, à demi-voix, comme si elle eût été fatiguée, et ce n’est qu’à l’avant-dernier vers : « Comprendra ce que j’ai souffert… » que s’arracha de sa poitrine un cri brûlant et passionné. Le dernier vers : « Et comme je souffre », elle le murmura à peine, appuyant douloureusement sur la dernière parole. Cette romance produisit moins d’impression sur le public que celle de Glinka. Cependant il y eut beaucoup d’applaudissements. Kupfer surtout se distingua : en frappant les paumes creuses de ses deux mains, il produisait un bruit particulièrement sonore. La princesse lui remit un grand bouquet ébouriffé pour qu’il l’offrît à la cantatrice. Mais elle n’eut l’air de remarquer ni la figure inclinée de Kupfer, ni le bouquet qu’il lui tendait au bout de son bras ; elle se retourna brusquement et s’en alla de nouveau sans attendre le pianiste qui avait bondi de sa chaise pour la reconduire, et, déconcerté, secoua sa chevelure comme Liszt ne l’avait peut-être jamais secouée. Pendant tout le temps qu’elle chantait, Aratov avait observé le visage de Clara. Il lui sembla, cette fois encore, qu’à travers les cils à demi fermés, ses yeux étaient tournés vers lui. Ce qui le frappait surtout, c’était l’immobilité de ce visage, de ce front, de ces sourcils. Ce n’est qu’à ce cri de passion qu’il avait vu briller un instant l’éclat vivant de deux rangées de dents serrées et blanches.
Les cris : Bis, bravo ! retentirent de tous côtés ; mais elle jeta un regard rapide sur Aratov qui ne criait ni n’applaudissait, – le chant de cette fille aux yeux sombres ne lui avait pas autrement plu, – fit un léger salut, et s’éloigna sans accepter le bras arrondi que lui présentait le pianiste chevelu. On la rappela, mais elle se fit attendre. Puis, revenant du même pas incertain, elle dit deux mots à voix basse à l’accompagnateur, qui dut changer la musique qu’il avait préparée, et elle se mit à chanter la romance de Tchaïkovski : « Celui-là seul qui connaît le désir de revoir… » Elle chanta cette romance tout autrement que la première, à demi-voix, comme si elle eût été fatiguée, et ce n’est qu’à l’avant-dernier vers : « Comprendra ce que j’ai souffert… » que s’arracha de sa poitrine un cri brûlant et passionné. Le dernier vers : « Et comme je souffre », elle le murmura à peine, appuyant douloureusement sur la dernière parole. Cette romance produisit moins d’impression sur le public que celle de Glinka. Cependant il y eut beaucoup d’applaudissements. Kupfer surtout se distingua : en frappant les paumes creuses de ses deux mains, il produisait un bruit particulièrement sonore. La princesse lui remit un grand bouquet ébouriffé pour qu’il l’offrît à la cantatrice. Mais elle n’eut l’air de remarquer ni la figure inclinée de Kupfer, ni le bouquet qu’il lui tendait au bout de son bras ; elle se retourna brusquement et s’en alla de nouveau sans attendre le pianiste qui avait bondi de sa chaise pour la reconduire, et, déconcerté, secoua sa chevelure comme Liszt ne l’avait peut-être jamais secouée. Pendant tout le temps qu’elle chantait, Aratov avait observé le visage de Clara. Il lui sembla, cette fois encore, qu’à travers les cils à demi fermés, ses yeux étaient tournés vers lui. Ce qui le frappait surtout, c’était l’immobilité de ce visage, de ce front, de ces sourcils. Ce n’est qu’à ce cri de passion qu’il avait vu briller un instant l’éclat vivant de deux rangées de dents serrées et blanches.
Kupfer s’approcha de lui :
– Eh bien, frère, qu’en dis-tu ? demanda-t-il tout rayonnant de satisfaction.
– La voix est bonne, répliqua Aratov, mais elle ne sait pas encore chanter, elle n’a pas la véritable école. (Pourquoi il avait dit tout cela, et quelle idée il avait de ce que c’est que l’« école », Dieu seul le sait !)
Kupfer s’étonna.
– Pas d’école ? dit-il lentement… Eh bien, elle peut encore l’acquérir. Mais aussi quelle âme !… Attends un peu, tu l’entendras quand elle lira la lettre de Tatiana.
Il s’éloigna d’Aratov en courant et celui-ci pensa : De l’âme ? avec un visage si immobile ? Il trouvait qu’elle se tenait et qu’elle se mouvait comme une personne magnétisée, comme une somnambule, et en même temps elle ne cessait de le regarder, oui, c’était indubitable !
Cependant, la matinée poursuivait son cours. Le gros homme à lunettes parut de nouveau. Malgré son extérieur solennel, il se croyait un comique : il lut une scène de Gogol sans exciter, cette fois, le moindre signe d’approbation. Le flûtiste passa de nouveau comme une ombre, le pianiste tonna de nouveau, un jeune garçon de douze ans, pommadé et frisé, mais avec des traces de larmes dans les yeux, piailla je ne sais quelles variations sur le violon. Ce qui put sembler singulier, c’est que, dans les entractes de la lecture et de la musique, arrivaient de temps en temps, de la chambre des artistes, les sons saccadés d’un cornet à piston, et que pourtant cet instrument ne parut pas. On sut plus tard que l’amateur qui s’était offert pour en jouer avait pris peur au moment de se présenter devant le public.
Et voici qu’enfin Clara Militch reparut. Elle tenait dans sa main un volume de Pouchkine. Cependant elle n’y regarda pas une seule fois pendant la lecture. Elle avait visiblement peur ; le petit volume tremblait dans ses doigts. Aratov remarqua aussi une expression d’abattement répandue maintenant sur son visage sévère. Elle prononça le premier vers : « Je vous écris, que dire de plus ? » très simplement, presque naïvement, et elle tendit les deux mains en avant d’un geste également naïf, sincère et comme sans défense. Puis elle commença à se hâter ; mais, à partir du vers : « Un autre ? non, jamais je ne donnerai mon cœur à un autre », elle se maîtrisa, et, quand elle arriva aux deux vers suivants : « Toute ma vie n’était qu’un gage que je te rencontrerais sûrement un jour », sa voix, jusqu’alors assez sourde, résonna tout à coup avec une exaltation enthousiaste et hardie, et ses yeux, avec la même hardiesse, se fixèrent droit sur Aratov. Elle continua ainsi, et c’est seulement vers la fin que sa voix baissa de nouveau, et dans sa voix comme sur son visage reparut le même abattement. Elle précipita les derniers vers, le volume glissa de ses mains et elle s’éloigna rapidement.
Le public se mit à applaudir avec fureur et à la rappeler. Un jeune séminariste, entre autres, hurlait avec tant de violence le nom de Militch, qu’un voisin le pria poliment et avec intérêt d’épargner en lui-même un futur protodiacre. Mais Aratov se leva aussitôt et se dirigea vers la sortie. Kupfer le rattrapa.
– Au nom du ciel, où vas-tu ? s’écria-t-il. Veux-tu que je te présente à Clara ?
– Non, non, merci, dit Aratov. Et il partit presque en courant pour retourner chez lui. ■ (À suivre).
Textes et images rassemblés par Rémi Hugues.
Nouvelle à paraître à l’automne 2022 éditée chez B2M.
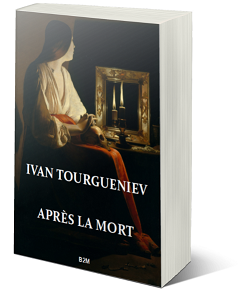
Commande ou renseignement : B2M – Belle-de-Mai Éditions commande.b2m_edition@laposte.net











