
VI.
Un commissionnaire lui apporta un billet d’une écriture féminine, grande et irrégulière, ainsi conçu :
« Si vous devinez qui vous écrit, et si cela ne vous ennuie pas, venez demain après dîner, vers cinq heures, au boulevard de la Tverskoï et attendez. On ne vous retiendra pas longtemps… Mais c’est très important, venez ! »
Il n’y avait pas de signature.
Aratov devina sans hésiter qui était sa correspondante, non sans un mouvement d’humeur.
– Quelle folie ! dit-il presque à haute voix ; il ne manquait plus que cela ! Naturellement je n’irai pas.
Il fit pourtant appeler le commissionnaire, duquel il n’apprit rien, sinon que le billet lui avait été remis dans la rue par une femme de chambre. L’ayant renvoyé, Aratov relut le billet et le jeta par terre. Mais, quelques instants après, il le ramassa, le relut encore, s’écria de nouveau : « Quelle folie ! » et le jeta, non plus à terre, mais dans un tiroir de sa table. Il revint à ses occupations habituelles, tantôt à l’une, tantôt à l’autre, mais cela n’allait plus. Il remarqua tout à coup qu’il s’était mis à attendre Kupfer. Voulait-il l’interroger, ou même lui communiquer… Mais Kupfer ne venait pas.
 Alors il prit un volume de Pouchkine, lut la lettre de Tatiana et se convainquit bientôt que cette « bohémienne » n’avait pas du tout compris le vrai sens de cette épître célèbre. Et cet imbécile de Kupfer qui s’écrie « Rachel Viardot ». Ensuite il s’approcha de son pianino, leva inconsciemment le couvercle, essaya de trouver sur les touches la mélodie de la romance de Tchaïkovski, mais referma aussitôt avec dépit l’instrument et se dirigea vers la chambre de sa tante, petite pièce toujours chauffée, avec une perpétuelle odeur de menthe, de sauge et d’autres plantes salutaires, et dans laquelle il y avait une si grande quantité d’étagères, de petits tapis, de petits bancs, de petits coussins, de petits meubles rembourrés, qu’un homme qui n’en avait pas l’habitude pouvait à peine s’y retourner et y respirer.
Alors il prit un volume de Pouchkine, lut la lettre de Tatiana et se convainquit bientôt que cette « bohémienne » n’avait pas du tout compris le vrai sens de cette épître célèbre. Et cet imbécile de Kupfer qui s’écrie « Rachel Viardot ». Ensuite il s’approcha de son pianino, leva inconsciemment le couvercle, essaya de trouver sur les touches la mélodie de la romance de Tchaïkovski, mais referma aussitôt avec dépit l’instrument et se dirigea vers la chambre de sa tante, petite pièce toujours chauffée, avec une perpétuelle odeur de menthe, de sauge et d’autres plantes salutaires, et dans laquelle il y avait une si grande quantité d’étagères, de petits tapis, de petits bancs, de petits coussins, de petits meubles rembourrés, qu’un homme qui n’en avait pas l’habitude pouvait à peine s’y retourner et y respirer.
Platonida se tenait près de la fenêtre, tricotant un cache-nez pour son Yacha. C’était le trente-huitième qu’elle lui faisait depuis sa naissance. Elle fut assez étonnée de le voir, car il la visitait rarement, se contentant, chaque fois qu’il avait besoin d’elle, de crier de son cabinet : « Tante Platocha ! »
Elle le fit pourtant asseoir et, dans l’attente de ses premières paroles, se dressa attentive, en le regardant, d’un œil à travers ses besicles, de l’autre par dessus. Elle ne s’enquit pas de sa santé et ne lui proposa pas de tilleul ; elle se doutait bien qu’il était venu pour autre chose.
Aratov, après un peu d’hésitation, se mit à parler… à parler de sa mère, et comment elle avait vécu avec son père, et comment elle avait fait sa connaissance. Il savait tout cela fort bien, mais il éprouvait le besoin de parler précisément de ces choses. Malheureusement Platonida ne savait pas du tout raconter ; elle répondait très brièvement, comme si elle eût soupçonné que ce n’était pas non plus pour cela que son Yacha était venu la trouver.
– Eh bien, quoi ? répétait-elle, en agitant hâtivement et comme avec dépit ses aiguilles, certainement… ta mère était une colombe, comme sont toutes les colombes… et ton père l’aimait comme il convient à un mari, fidèlement et honnêtement, jusqu’au tombeau, et il n’a jamais aimé une autre femme, ajouta-t-elle en élevant la voix et en arrachant les besicles de son nez.
– Et… elle était d’un naturel timide ? demanda Aratov après un moment de silence.
– Naturellement, timide, comme il convient à notre sexe. Les hardies, cela n’a poussé que dans les derniers temps.
– Et de votre temps, il n’y en avait donc pas, de hardies ?
– Il y en avait de notre temps aussi ; comment n’y en aurait-il pas eu ? Mais qui ? Quelque rien du tout. Elle a son jupon tout crotté ; elle se jette de-ci de-là, l’effrontée. Qu’est-ce que ça lui fait ? Un imbécile lui tombe sous la main, c’est justement son affaire, et les hommes posés la dédaignent. Rappelle-toi bien, en as-tu jamais vu de pareilles dans notre maison ?
Aratov ne répondit rien et retourna dans son cabinet. Platonida le suivit du regard, hocha la tête, rajusta ses besicles et se remit à son cache-nez, mais plus d’une fois devint rêveuse et laissa retomber ses aiguilles sur ses genoux.
– Non ! non ! se disait Aratov toute la soirée. Et de nouveau, il se reprenait à penser à ce billet, à cette bohémienne, à cet appel auquel il ne se rendrait certainement pas. Même la nuit il n’eut pas de repos. Il croyait toujours voir ces yeux noirs, tantôt à demi voilés, tantôt tout grands ouverts, et toujours obstinément fixés sur lui, et ces traits immobiles avec leur expression impérieuse et morne.
La matinée suivante il se mit encore à espérer la visite de Kupfer ; il fut même sur le point de lui écrire. Du reste, il ne travailla pas, il ne fit que se promener de long en large dans sa chambre. Il continuait à ne pas vouloir admettre la pensée qu’il irait à ce sot rendez-vous… et, vers trois heures et demie, après un dîner hâtivement avalé, il jeta un manteau sur ses épaules, enfonça son bonnet sur sa tête, et, évitant d’être vu par sa tante, bondit dans la rue et se dirigea vers le boulevard Tverskoï. ■ (À suivre).
Textes et images rassemblés par Rémi Hugues.
Nouvelle à paraître à l’automne 2022 éditée chez B2M.
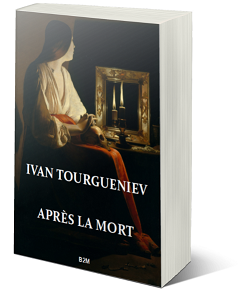
Commande ou renseignement : B2M – Belle-de-Mai Éditions commande.b2m_edition@laposte.net











