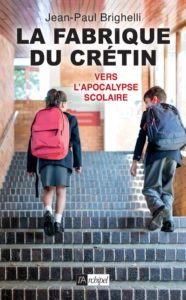Par Jean-Paul Brighelli.
![]() C’est un article une fois encore remarquable de finesse, de subtilité et de goût que Jean-Paul Brighelli nous a donné dans Causeur il y a deux jours. (18.02.2023). Il s’agit, avec Molière, d’une défense amoureuse de notre langue et de notre civilisation, jadis partagées par presque tous, toutes catégories sociales confondues, même si c’était de différentes manières, aujourd’hui en train de s’effondrer, y compris et sans-doute surtout, du côté des « élites » si mal nommées. Rente cette communauté singulière et hors d’âge établie depuis quatre siècles sur les bords de Seine, Quai de Conti. Il n’y siège sans-doute plus, à cette heure, les grandes gloires d’autrefois mais on y parle notre langue et on y cultive l’esprit français avec une admirable vitalité. Les grandes gloires pourront sans peine y faire leur retour quand elles se seront reconstituées. Peut-être sont-elles déjà en train de s’y employer pour faire face aux reniements sans égal d’aujourd’hui. Ce qu’il nous reste de latinistes doit savoir que dans le Multa renascentur d’Horace le mot sous-entendu est vocabula. Qui est justement l’affaire de l’Académie.
C’est un article une fois encore remarquable de finesse, de subtilité et de goût que Jean-Paul Brighelli nous a donné dans Causeur il y a deux jours. (18.02.2023). Il s’agit, avec Molière, d’une défense amoureuse de notre langue et de notre civilisation, jadis partagées par presque tous, toutes catégories sociales confondues, même si c’était de différentes manières, aujourd’hui en train de s’effondrer, y compris et sans-doute surtout, du côté des « élites » si mal nommées. Rente cette communauté singulière et hors d’âge établie depuis quatre siècles sur les bords de Seine, Quai de Conti. Il n’y siège sans-doute plus, à cette heure, les grandes gloires d’autrefois mais on y parle notre langue et on y cultive l’esprit français avec une admirable vitalité. Les grandes gloires pourront sans peine y faire leur retour quand elles se seront reconstituées. Peut-être sont-elles déjà en train de s’y employer pour faire face aux reniements sans égal d’aujourd’hui. Ce qu’il nous reste de latinistes doit savoir que dans le Multa renascentur d’Horace le mot sous-entendu est vocabula. Qui est justement l’affaire de l’Académie. ![]()
Nous commémorions hier le 350ème anniversaire de la mort de Molière, qui commença sur la scène où il jouait pour la troisième fois Le Malade imaginaire. L’événement, qui n’a pas suscité un grand intérêt dans les médias, a retenu l’attention désespérée (et désespérante, il faut bien l’avouer) de Jean-Paul Brighelli, farouche défenseur de la « langue de Molière »…
Chaque fois que la Comédie française, née en 1680 de la réunion de la troupe de Molière — dite « de l’Hôtel Guénégaud » — à celle de l’Hôtel de Bourgogne (rappelez-vous, c’est là que commence Cyrano de Bergerac) joue Le Malade imaginaire, le spectacle s’arrête brutalement dans la scène finale, où l’on intronise Argan — le Malade — comme médecin : au troisième « Juro ! » articulé par le héros, au moment où Molière a commencé à s’étouffer dans son sang, les lumières s’éteignent et le silence se fait.
Il y a donc encore au moins un endroit, dans ce pays dévasté, où l’on célèbre celui qui a donné son nom au français. Nous parlons « la langue de Molière », comme les Anglais articulent celle de Shakespeare, les Allemands celle de Goethe, les Espagnols celle de Cervantès, et les Italiens celle de Dante.
Mais c’était trop pour les pédagogues mis au pouvoir par René Haby et ses successeurs depuis les années 1970. Trop pour cette confrérie de minables, qui depuis quarante ans se reconnaissent et se cooptent les uns les autres — les cloportes vont par bandes. S’appuyant sur les conclusions du rapport de la Commission Rouchette mise en place en 1966 par ce même René Haby, alors patron de la DGESCO, une majorité d’enseignants, soit par conviction, soit par suivisme, soit par calcul, a choisi d’enseigner désormais la langue de la rue. Et comme l’a dit il y a deux ans Rémy Rebeyrotte, un député En Marche (arrière, probablement), Aya Nakamura est l’ambassadrice, désormais, de ce que le français a de plus créatif. Exeunt Molière et La Fontaine !
Je voudrais, tout en saluant la mémoire de Jean-Baptiste Poquelin, génie de la littérature, rappeler brièvement ce que nous avons perdu en quelques décennies. Les parents saluent les premiers mots de leurs bébés. Nous devrions saluer, bien bas, les derniers mots qui nous restent. Après nous les borborygmes et le silence.
Il y a quelques jours, l’Académie française a reçu Mario Vargas Llosa dans ses rangs. Un écrivain péruvien naturalisé espagnol parmi les Immortels ? Ils ont bien fait. Le nouvel Immortel a commencé ainsi son discours de réception — que je vous suggère fortement de lire :
« Au temps de mon enfance, la culture française était souveraine dans toute l’Amérique latine ainsi qu’au Pérou. « Souveraine », cela veut dire que les artistes et les intellectuels la tenaient pour la plus originale et consistante, et les gens frivoles aussi l’adoraient en y voyant la consécration de leurs rêves, ce voyage à Paris qui, d’un point de vue artistique, littéraire et sensuel, était la capitale du monde. Et aucune autre ville n’aurait pu lui disputer sa couronne. C’est avec ces idées que j’ai grandi et me suis formé, en lisant des auteurs français parmi lesquels se détachaient deux futurs adversaires potentiels: Jean-Paul Sartre et Albert Camus. »
Il doit bien y en avoir ici qui récuseront Sartre ou Camus. Mais imaginez ce que pense de la France aujourd’hui un jeune Péruvien (ou Bolivien, ou Argentin, ou ce que vous voulez). Quels géants des Lettres nous représentent ? Aya Nakamura, Ladj Ly, et Annie Ernaux…
Nous sommes morts aux yeux du monde. Nous avons scié la branche sur laquelle nous étions assis — notre langue. En cessant de l’enseigner, en conseillant (Philippe Meirieu) d’apprendre à lire aux enfants en leur faisant déchiffrer les modes d’emploi des machines à laver, nous avons tué un pays tout entier. En vilipendant (haut et court) les Classiques, en préférant faire étudier des articles de journaux bien-pensants, nous avons rompu avec douze siècles de tradition française. Écoutez Vargas Llosa, si heureux « d’avoir découvert en France Gustave Flaubert, qui a été et sera toujours mon maître, depuis que j’ai acheté un exemplaire de Madame Bovary, le soir même de mon arrivée, dans une librairie aujourd’hui disparue, du Quartier latin, qui s’appelait « La Joie de Lire ». Sans Flaubert, je n’aurais jamais été l’écrivain que je suis, ni n’aurais écrit ce que j’ai écrit et de quelle manière. »
Transposez. Mettez à la place de Flaubert (sur lequel Vargas Llosa a écrit une étude remarquable, L’Orgie perpétuelle) n’importe lequel des petits maîtres de Saint-Germain-des-Prés — Edouard Louis par exemple. Et mesurez l’étendue du désastre.
Parlez et écrivez français, mes amis. Giflez toute personne qui fera devant vous l’apologie des crétins qui se croient des gens de Lettres. Interdisez à vos enfants d’écouter le dégueulis dont les ondes nous inondent. Amenez-les voir les pièces de Molière, faites-leur apprendre par cœur des fables de La Fontaine, et quand ils auront l’âge, offrez-leur Flaubert ou tel autre parmi les très grands dont nous ne manquons pas, en amont des années 1970, début de l’apocalypse lente où nous nous engloutissons aujourd’hui. ■