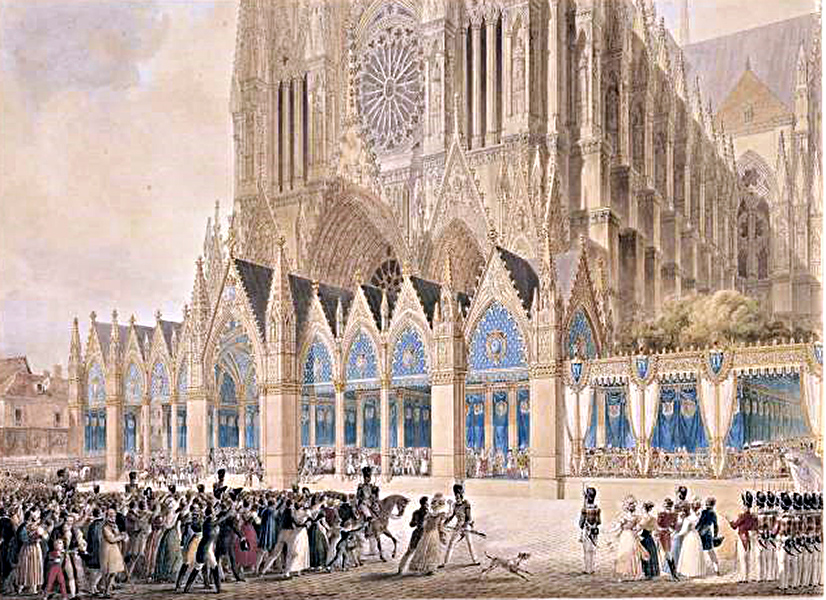
PAR MATHIEU BOCK-CÔTÉ.
![]() Commentaire – Cette « chronique » est parue dans Le Figaro du 11 mars. Et c’est un bel article qui a le mérite d’élever le débat, si souvent au ras du sol, de « susciter » une ample ouverture à la réflexion, grâce, en définitive, au livre que Sonia Mabrouk a eu le courage intellectuel d’écrire et de publier. Qu’aucune société ne puisse réellement vivre sans recours au sacré, acceptation du « mystère », reconnaissance d’une transcendance à la « fourmilière » des humains réduits à leur addition, la physique politique au sens de Comte et de Maurras, ne peut l’ignorer et la modernité se charge de le rappeler. En un sens, cet article nous paraît se résumer assez bien dans cette mise en garde de Frédéric II à Voltaire, que Gustave Thibon aimait à citer : « Nous avons connu le fanatisme de la foi. Peut-être connaîtrons-nous, mon cher Voltaire, le fanatisme de la raison, et ce sera bien pire. » Phrase qui, en un sens, clôt, avec deux ou trois siècles d’avance, le cycle, qui aura été, en réalité, assez sombre, des Lumières.
Commentaire – Cette « chronique » est parue dans Le Figaro du 11 mars. Et c’est un bel article qui a le mérite d’élever le débat, si souvent au ras du sol, de « susciter » une ample ouverture à la réflexion, grâce, en définitive, au livre que Sonia Mabrouk a eu le courage intellectuel d’écrire et de publier. Qu’aucune société ne puisse réellement vivre sans recours au sacré, acceptation du « mystère », reconnaissance d’une transcendance à la « fourmilière » des humains réduits à leur addition, la physique politique au sens de Comte et de Maurras, ne peut l’ignorer et la modernité se charge de le rappeler. En un sens, cet article nous paraît se résumer assez bien dans cette mise en garde de Frédéric II à Voltaire, que Gustave Thibon aimait à citer : « Nous avons connu le fanatisme de la foi. Peut-être connaîtrons-nous, mon cher Voltaire, le fanatisme de la raison, et ce sera bien pire. » Phrase qui, en un sens, clôt, avec deux ou trois siècles d’avance, le cycle, qui aura été, en réalité, assez sombre, des Lumières. ![]()
CHRONIQUE – Dans son dernier livre, Sonia Mabrouk s’est lancée à la reconquête de ce qu’elle nomme le sacré.
Il existe des pathologies propres au rationalisme. (…) Il existe aussi des pathologies propres à « l’émancipation ». Elles dominent notre temps.
On dit l’homme moderne errant, désenchanté, étranger à lui-même, et les dernières années pourraient aisément nous convaincre qu’il est au seuil de l’effondrement psychique. Que lui manque-t-il? D’où lui vient ce sentiment d’être jeté dans le vide? Tel est l’objet du dernier livre de Sonia Mabrouk, qui s’est lancée à la reconquête de ce qu’elle nomme le sacré, qu’elle cherche à explorer, inquiète des effets d’une carence métaphysique sur nos sociétés qui se croient spirituellement autosuffisantes.
Alors, revenons-y: la modernité, en quelque sorte, s’est voulue étrangère au sacré. Habitée par une anthropologie de la transparence et de la plasticité intégrale de l’être humain, elle croit abolir ou du moins dépasser le mystère propre à l’homme par les promesses de la science et de la technique. Promesse qu’elle ne peut évidemment tenir. Car l’homme naît, mais meurt, et ne parvient pas à s’y résoudre. Il ne parvient pas à accepter de n’être qu’un fait divers biologique plutôt insignifiant à l’échelle de l’histoire du cosmos. Il est habité par un besoin de sacré.
 Mais de quelle manière le définir? Sonia Mabrouk, au fil de son ouvrage, tangue entre deux définitions, celle des modernes et celle des anciens. Les modernes voient dans le sacré le fruit d’un processus de sacralisation. Ils y voient une «invention des hommes». C’est la société qui sacralise, et elle peut sacraliser n’importe quoi. Les anciens lui prêtaient plutôt une densité objective. Il ne s’agit pas seulement d’un processus intellectuel, mais d’un substrat, d’un flux métaphysique, que les grandes religions ont chacune cherché à identifier, capter, canaliser, institutionnaliser, ritualiser. Sonia Mabrouk incline vers le sacré des anciens, même si elle donne ses droits au sacré des modernes.
Mais de quelle manière le définir? Sonia Mabrouk, au fil de son ouvrage, tangue entre deux définitions, celle des modernes et celle des anciens. Les modernes voient dans le sacré le fruit d’un processus de sacralisation. Ils y voient une «invention des hommes». C’est la société qui sacralise, et elle peut sacraliser n’importe quoi. Les anciens lui prêtaient plutôt une densité objective. Il ne s’agit pas seulement d’un processus intellectuel, mais d’un substrat, d’un flux métaphysique, que les grandes religions ont chacune cherché à identifier, capter, canaliser, institutionnaliser, ritualiser. Sonia Mabrouk incline vers le sacré des anciens, même si elle donne ses droits au sacré des modernes.
Quand les grandes religions s’effondrent, les idéologies les remplacent et falsifient le sacré, en ramenant les fins dernières qui les habitaient dans notre monde. Elles sacralisent alors le profane, et condamnent l’homme à adorer de faux dieux, ce qu’on appelait autrefois l’idolâtrie. N’est-ce pas à cette lumière qu’on peut comprendre le XXe siècle et son cortège d’utopies destructrices, qui sont probablement en train de renaître sous un nouveau visage. Quant aux peuples qui désacralisent intégralement leur existence, ils se dégradent en pures «sociétés socialement construites», et se condamnent à l’enfer froid de l’ingénierie sociale et de la consommation névrotique.
Peut-être est-ce ce qui amène Sonia Mabrouk à confesser sa tendresse pour la liturgie traditionnelle et la messe en latin: dès lors que le sacré devient manipulable à souhait, selon les exigences des temps présents, il se désacralise, pourrait-on dire. Un rite qui ne donne plus l’impression de venir de temps immémoriaux se désagrégera sous nos yeux. C’est justement parce qu’une prière se transmet au fil des siècles qu’elle touche l’âme des mortels que nous sommes. La liturgie bien comprise est un langage seul capable de rejoindre certaines régions de l’âme.
Nous revenons alors à la question anthropologique. Par la sociologie, la modernité, elle a cru identifier les mécanismes assurant la production de la société, qui produit elle-même l’homme: en les maîtrisant, elle accoucherait d’une société parfaite, accouchant d’un homme parfait. C’est la même conviction qui l’amène aujourd’hui à vouloir le produire en laboratoire. Mais l’homme qui ne croit plus qu’en l’homme se perd, et la raison se perd lorsqu’elle veut abolir jusqu’à la possibilité du mystère. Il existe des pathologies propres au rationalisme, qui pousse au triomphe de ceux que Sonia Mabrouk appelle les «démolisseurs». Il existe aussi des pathologies propres à «l’émancipation». Elles dominent notre temps.
Ce très beau livre conjugue l’enquête intellectuelle et la quête existentielle. En d’autres temps, il aurait pu être publié dans la collection «Ce que je crois». Plus on s’y avance, plus Sonia Mabrouk s’y dévoile, comme si la sociologie la conduisait vers la philosophie, puis vers un consentement à la métaphysique. Elle évoque alors le «goût de la transcendance, l’énergie de la verticalité, la conscience des images philosophiques, la marque du mystère, la beauté de la contemplation, la grâce d’une vie intérieure, la permanence des rites, la recherche de la vérité ».
Les dernières pages sont magnifiques et tragiques, et Sonia Mabrouk ose appeler Dieu ce qu’elle nomme autrement sacré. Non pas sur le mode de la conversion ou du prosélytisme, mais plutôt, comme si ce mot lui échappait, comme s’il était plus fort que tout, et qu’elle devait au moins une fois le dire, le confesser. Il arrive à l’homme, devant le tourment de l’existence, de vouloir s’agenouiller devant la croix, comme s’il pouvait ainsi pleinement la contempler, et, pour regarder le ciel, de trouver enfin le moyen de lever enfin la tête. ■
Mathieu Bock-Côté
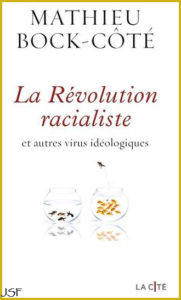 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.













Beau texte qui m’évoque deux propos du même sens :
Quand on cesse de croire en Dieu, ce n’est pas pour croire en rien, c’est pour croire en n’importe quoi.
Chesterton
Quand la place de Dieu est vacante dans les âmes, toute une armée de sorciers apparaît qui essaie d’occuper cette place.
Nikita Mikhalkov (dans son film « Anna »)