
Ces extraits du livre de Patrick Buisson qui vient de publier sont parus dans Le Figaro du 7 avril choisis par ![]()
EXCLUSIF – Après La Fin d’un monde, l’intellectuel réactionnaire poursuit son exploration critique de la modernité occidentale. Dans Décadanse, il s’attaque à la libération des mœurs des années 1970. Celle-ci, par la remise en cause de siècles de morale chrétienne a abouti, selon lui, au triomphe d’une société individualiste et marchande.
Le Figaro Magazine publie ici en exclusivité de larges extraits de cette œuvre aussi puissante que dérangeante.
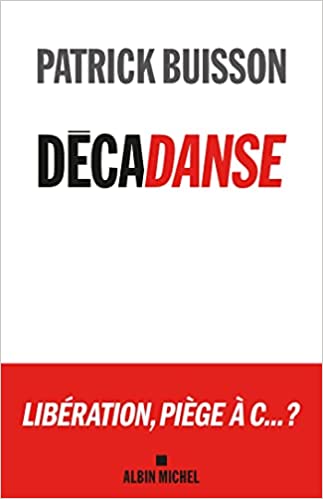
« Ce serait une grosse faute de la part d’un pays de compter indéfiniment sur les enfants des pays pauvres pour combler les lacunes »
Alfred Sauvy, titulaire de la chaire de démographie sociale au Collège de France
L’effort théorique du féminisme radical pour faire apparaître toutes les femmes comme partie prenante d’une seule et même classe universellement exploitée dans le cadre de la famille patriarcale se heurte, néanmoins, à l’infinie diversité des situations et à la difficulté de discerner entre exploitation et domination. De façon presque unanime, la tradition socialiste, à l’image d’un Paul Lafargue, s’était toujours attachée à réfuter l’idée d’une exploitation des bourgeoises par leur mari.
Oisive et « parasite », selon le qualificatif d’Engels, la femme bourgeoise était considérée comme une sorte de « prostituée » d’un genre spécial dont la particularité était de partager une vie de couple où l’exploité n’était plus la femme mais son conjoint. Se démarquant de l’analyse marxiste, les premières militantes féministes, toutes issues de la bourgeoisie et même parfois de la grande bourgeoisie, ne pouvaient épouser un tel point de vue. Renvoyer les femmes à leur classe revenait à nier leur oppression en tant que sexe. De n’être pas une « femme bonniche » ne devait pas priver pour autant la « femme potiche », toute privilégiée qu’elle fût sur le plan financier, du statut de victime auquel la condamnait un oppresseur commun. Pour n’être pas soumise à une exploitation d’ordre économique, elle n’en subissait pas moins cette autre forme d’aliénation qu’était la domination du pouvoir mâle.
Le regard que portent les féministes sur la femme du peuple est encore plus ambigu. Forteresse de la mère au foyer, la famille ouvrière est un isolat réfractaire. Difficile de mettre en cause l’impérialisme masculin quand une tradition solidement établie, depuis la fin du XIXe, veut que l’homme remette intégralement sa paie à la femme, instituant par là même une sorte de « matriarcat budgétaire » qui perdure bien au-delà des années 1960. Nul n’est plus opposé au travail salarié de la femme que les ouvriers qui ont vu leur mère trimer comme un forçat et le plus souvent mourir à la tâche. Un tel point de vue constitue l’angle mort d’une pensée féministe fortement marquée par ses origines sociales.
Le choc de ces deux mondes donne parfois lieu à des scènes cocasses comme celle que rapporte l’actrice Bernadette Lafont après avoir assisté avec Marie-Jeanne, une amie taxi, à une réunion du MLF dans un appartement grand standing de La Muette : « Marie-Sophie pérorait depuis un bon quart d’heure en revendiquant le droit au travail pour toutes les femmes. Marie-Jeanne qui, jusque-là, se contentait de lutter contre le sommeil se leva d’un bond : “Qu’est-ce que tu connais à tout ça, toi qui es née le cul dans la dentelle ? Crois-tu que ma mère, ma grand-mère, mes tantes se sont battues pour bosser en usine ? À la place d’un boulot aussi con, elles auraient sûrement préféré rester à la maison si elles avaient eu les moyens. »
Aux origines du basculement démographique
Bien que le mot n’ait pas encore été inventé, l’un des faits les plus marquants du débat parlementaire sur la loi Veil est incontestablement l’apparition, à la faveur de l’intervention de nombreux députés du groupe gaulliste, d’un discours préfigurant la thèse de Renaud Camus sur « le grand remplacement ». Fil rouge de ces orateurs qui évoquent les uns après les autres les retombées à moyen terme de la loi, la question d’un transfert de la fécondité de la population autochtone vers les populations immigrées résonne comme l’écho à peine assourdi de la sombre fiction de l’écrivain Jean Raspail qui, dans Le Camp des saints – l’un des best-sellers de l’année 1973 –, décrit comme d’une imminente actualité la submersion non pacifique de la France par une flotte de bateaux chargés de migrants originaires du tiers-monde.
Le premier lanceur d’alerte n’est cependant ni un romancier ni un politique mais l’économiste, sociologue et démographe Alfred Sauvy. Ancien conseiller du gouvernement de Pierre Mendès France, collaborateur régulier de L’Express, titulaire de la chaire de démographie sociale au Collège de France, il jouit d’une autorité dont le périmètre inclut, chose rare, aussi bien les milieux intellectuels que le premier cercle du pouvoir.
Ce n’est donc ni un boutefeu ni un extrémiste qui, auditionné en qualité d’ancien directeur de l’Ined, adresse au groupe parlementaire chargé de travailler sur le projet Taittinger (projet de loi à l’Assemblée tendant à libéraliser l’avortement dans certains cas ; projet qui n’aboutira pas, NDLR) à l’automne 1973 une solennelle mise en garde : « Ce serait une grosse faute de la part d’un pays, que ce soit l’Allemagne, la France ou un autre, de compter indéfiniment sur les enfants des pays pauvres pour combler les lacunes parce qu’il aurait préféré ne pas élever d’enfants lui-même. Le pays qui recourrait systématiquement à ce moyen risquerait non seulement une révolte possible de ces mercenaires en situation inférieure mais probablement une sorte de décomposition par perte du sens de la vie. »
Aussi abrupt, aussi incisif est l’avertissement de Michel Debré lors du débat sur la loi Veil, le 27 novembre 1974. À cela près que l’ancien premier ministre a choisi le terrain de la géopolitique pour remuer les consciences : « Examinez la démographie du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord : la croissance en est considérable, pour des raisons de mœurs sans doute, mais aussi par la volonté gouvernementale de plusieurs États arabes. Quand le déséquilibre sera trop grand, la paix sera menacée. Ce n’est donc pas le mouvement de l’Histoire qui emporte depuis quelques années les nations d’Europe occidentale, mais une monumentale erreur historique. Nous acceptons le risque de diminuer, nous acceptons le risque de vieillir alors que d’autres, à nos portes, croissent et rajeunissent. »
Consubstantielle à l’histoire du nationalisme français, cette crainte d’une déferlante étrangère recouvrant la nation, sa culture et ses mœurs, c’était déjà celle qu’exprimait de Gaulle en mars 1959 face aux tenants de l’Algérie française : « Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises mais Colombey-les-Deux-Mosquées ! »
Libéralisation du divorce et féminisation de la pauvreté
Avec la loi du 11 juillet 1975, un choix délibéré a été fait en faveur de la liberté individuelle contre la stabilité de la cellule familiale sans que personne ou presque ne se soit risqué à s’interroger sur l’impact que pourrait avoir la nouvelle loi comme facteur d’aggravation des inégalités sociales ni sur les mécanismes qui, en diffusant la procédure du divorce dans les catégories populaires, en y répandant un divorce de masse jusque-là inconnu, seraient susceptibles de faire basculer un grand nombre de mères et d’enfants dans la pauvreté et la marginalisation sociale.
L’horizon du législateur semble s’être limité à l’univers culturel des classes favorisées et des classes moyennes ascendantes dont le cinéma de la « nouvelle vague » et de François Truffaut exprimait les préoccupations existentielles. Pour ce monde du « je » autonome de la nouvelle bourgeoisie, aux mœurs si opposées au « nous » fusionnel des ménages ouvriers, le changement, dans le respect d’autrui et la responsabilité partagée, est toujours, a priori, bénéfique. Comme le souligne la sociologue Irène Théry, « le thème de la “seconde chance”, de la “session de rattrapage”, de la vie qui commence à 30, 40, 50 ans n’a jamais été aussi présent dans les œuvres de fiction ». Jamais non plus la parabole enchantée des éternels recommencements n’aura semé autant de bon grain dans la tête des lectrices de la presse féminine.
Tout se passe, comme si les politiques publiques avaient voulu ignorer que le processus d’individualisation, dont le divorce de masse constituait, en quelque sorte, le fleuron, ne s’effectuerait pas aux mêmes coûts selon que l’on appartiendrait aux classes supérieures ou aux catégories populaires. Et il faudra quelques années avant qu’on ne s’aperçoive que les bienfaits et les contrecoups délétères de cette nouvelle « avancée sociétale » auront été très inégalement répartis en fonction des milieux d’origine. Aux femmes diplômées et issues des classes favorisées, les gains en termes de liberté, de carrière et de position sociale. Aux femmes du peuple, le poids de nouvelles contraintes, la précarité économique et, dans la plupart des cas, un inexorable mécanisme d’appauvrissement aux effets cumulatifs.
Car, le divorce, en bas de l’échelle sociale, joue le rôle d’une bombe à fragmentation et n’épargne aucun des aspects de la vie familiale, qu’il s’agisse du logement, de l’alimentation, des loisirs ou de l’accès aux soins. Une dynamique dévastatrice se met d’autant plus vite en action que, depuis 1973, la forte progression du chômage affecte en priorité les emplois les moins qualifiés et fragilise un peu plus les familles éclatées. Hier avait achoppé sur des exigences de bonheur. Demain ne sera plus réglé que sur des impératifs de survie. En France comme dans d’autres pays d’Europe, la libéralisation du divorce est à l’origine de la féminisation de la pauvreté.
Partout ce sont les femmes des catégories populaires qui paient le prix fort de la séparation et de la remise en cause de la fonction protectrice de l’institution matrimoniale. Même si la plupart d’entre elles préfèrent vivre avec moins et mieux sans leur mari, peu ont imaginé, lors de la rupture, les conséquences en chaîne de la dégradation de leur situation matérielle et la profonde altération de leur mode de vie qui allait s’ensuivre. Beaucoup apprennent à leurs dépens que le divorce est un luxe de nantis dont on leur avait soigneusement caché les effets en chaîne.
Le prophète Serge Gainsbourg
Au terme de ce voyage au cœur des Trente Glorieuses, il m’a semblé, finalement, que c’était Serge Gainsbourg qui, en forgeant le mot de « décadanse », avait eu l’intuition géniale de ce que les Français étaient en train de vivre et dont il était lui-même le symbole mal rasé, provocant et tapageur. Lancée au cours d’une démonstration au club Saint-Hilaire en janvier 1972, la décadanse inventée par « Gainsbarre », l’alter ego maléfique du chanteur, était une nouvelle façon de danser le slow, un « slow inversé » où la femme tournait le dos à son partenaire étroitement plaqué contre son corps ; une sorte de pantomime sodomite et exhibitionniste : « Dieu / Pardonnez nos offenses / La décadanse / A bercé / Nos corps blasés / Et nos âmes égarées. »
En dernière analyse, il n’y a pas trouvaille plus percutante pour décrire ce qui est advenu collectivement à la génération des « boomers ». La décadanse, c’est la décadence entendue non comme un événement déplorable mais, au contraire, comme la jouissance ultime que l’on célèbre ; quelque chose d’absurde et de suicidaire à l’image de ce que la médecine légale appelle « asphyxiophilie », cette pratique qui consiste à étrangler son partenaire ou soi-même pour provoquer l’orgasme. La décadanse, c’est se réjouir de la catastrophe qui entraîne le troupeau à l’abattoir en lui faisant croire qu’il s’agit d’une fête, c’est aller à la mort en dansant dans ce climat de nihilisme festif et exubérant qui est la marque de notre époque. La décadanse ce n’est, somme toute, que la parodie de la décadence, l’ultime signal du passage d’un monde du sacré habité par les symboles à un monde profane livré à la contrefaçon ou plus encore à la singerie si l’on veut y voir une intention maligne.
Un monde s’achève, un autre s’apprête à naître. Quels en seront les contours ? Quels en seront les protagonistes ? L’homme connecté, numérisé, surveillé, « augmenté » par la technique, l’homme du transhumanisme ? Un néomatriarcat gouverné par les grandes prêtresses exorcistes de l’androcène ? L’indistinction généralisée des adeptes de la transidentité ? La dictature des petits Khmers verts et des furieux hallucinés de l’antispécisme ? La chambre froide de l’empire utilitaro-sanitaire où l’on pourra « mourir dans la dignité » quand on ne sera plus jugé digne de vivre ou que l’on aura l’indécence de ne pas mourir assez vite pour épargner les fonds publics ?
Tout ce que l’on sait, c’est qu’on ne sait rien si ce n’est que l’improbable est certain. Tout ce que l’on peut avancer, c’est que rien de ce qu’on nous promet ou qu’on nous annonce et dont on voit les prémices n’a de l’avenir. Les sacrés de substitution, les sacrés de contrefaçon passeront comme sont passées bien des impostures au cours de l’Histoire tant il est vrai, comme l’écrivait George Bernard Shaw, qu’« il est plus facile de bâtir un temple que d’y faire descendre un dieu ».
Le grand récit du progressisme, qui prétendait réenchanter le monde, s’est révélé incapable de répondre à ces besoins universels et intemporels que sont les demandes de sacré, de grandeur et de symbolique. « Une société, une civilisation, nous a avertis l’historien René Grousset, ne se détruisent de leurs propres mains que quand elles ont cessé de comprendre leurs raisons d’être, quand l’idée dominante autour de laquelle elles étaient naguère organisées leur est devenue comme étrangère. » Nous y sommes. ■














Patrick Buisson… toujours aussi tranchant