
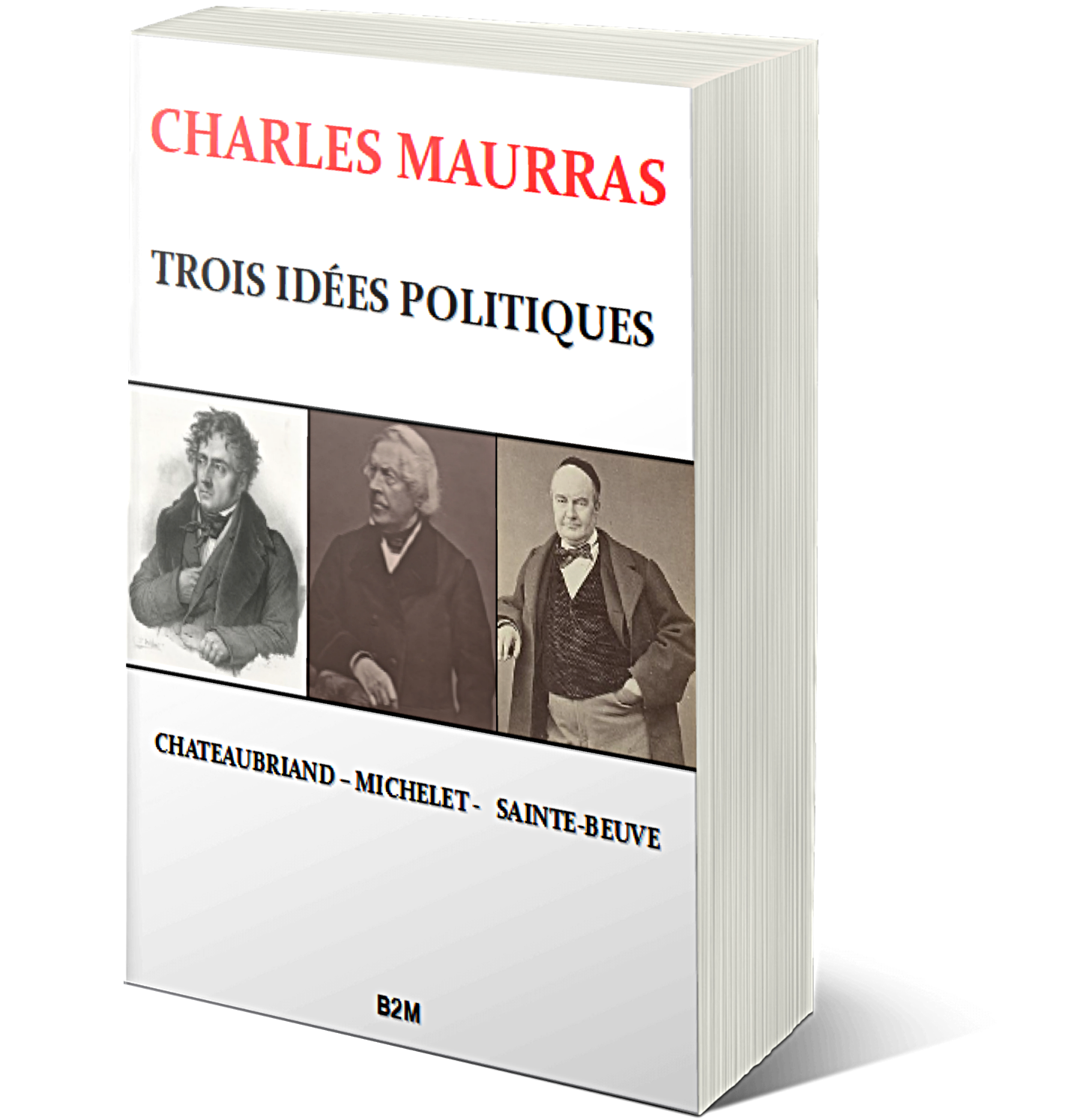 Ces réflexions de Charles Maurras constituent le premier chapitre d’un livre célèbre, « Trois idées politiques, Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve ». Cet ouvrage fut publié en 1898. « Cette année-là, nous dit l’avant-propos de l’édition de 1912, traversée d’agitations profondes, ne pouvait manquer d’introduire la politique et la religion dans ses trois grandes commémorations littéraires : le centenaire de la naissance de Michelet, le cinquantenaire de la mort de Chateaubriand, l’érection du buste de Sainte-Beuve »2. Est repris ici le chapitre consacré à Chateaubriand. Le grand homme jouissait alors d’une sorte de gloire universelle du côté des conservateurs. Or « La vieille France, dit Maurras, croit tirer un grand honneur de Chateaubriand, elle se trompe. » C’est la thèse qu’il défend ici. Dans l’effondrement culturel d’aujourd’hui, notamment du côté des élites dominantes, il y a longtemps que, faute d’admirateurs à son niveau, Chateaubriand a cessé d’être un phare, au sens baudelairien. Il n’incarne plus guère que le moderne conservateur, si peu qu’il reste à ce dernier des anciennes traditions dont Chateaubriand était pétri. « Loin de rien conserver, dit Mauuras, il fit au besoin des dégâts. Cet idole des modernes conservateurs nous incarne surtout le génie des Révolutions « . Les modernes conservateurs du XXIe siècle sont d’une espèce dégradée mais non disparue qui tient un peu de cette filiation de l’auteur des Martyrs. Et qui fait, elle aussi, des dégâts.
Ces réflexions de Charles Maurras constituent le premier chapitre d’un livre célèbre, « Trois idées politiques, Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve ». Cet ouvrage fut publié en 1898. « Cette année-là, nous dit l’avant-propos de l’édition de 1912, traversée d’agitations profondes, ne pouvait manquer d’introduire la politique et la religion dans ses trois grandes commémorations littéraires : le centenaire de la naissance de Michelet, le cinquantenaire de la mort de Chateaubriand, l’érection du buste de Sainte-Beuve »2. Est repris ici le chapitre consacré à Chateaubriand. Le grand homme jouissait alors d’une sorte de gloire universelle du côté des conservateurs. Or « La vieille France, dit Maurras, croit tirer un grand honneur de Chateaubriand, elle se trompe. » C’est la thèse qu’il défend ici. Dans l’effondrement culturel d’aujourd’hui, notamment du côté des élites dominantes, il y a longtemps que, faute d’admirateurs à son niveau, Chateaubriand a cessé d’être un phare, au sens baudelairien. Il n’incarne plus guère que le moderne conservateur, si peu qu’il reste à ce dernier des anciennes traditions dont Chateaubriand était pétri. « Loin de rien conserver, dit Mauuras, il fit au besoin des dégâts. Cet idole des modernes conservateurs nous incarne surtout le génie des Révolutions « . Les modernes conservateurs du XXIe siècle sont d’une espèce dégradée mais non disparue qui tient un peu de cette filiation de l’auteur des Martyrs. Et qui fait, elle aussi, des dégâts. ![]()

La soumission est la base du perfectionnement.
Auguste Comte 3.
 J’admire surtout l’égarement de la vieille France. Ce Régime ancien dont elle garde la religion, l’État français d’avant dix-sept cent quatre-vingt-neuf, était monarchique, hiérarchique, syndicaliste et communautaire ; tout individu y vivait soutenu et discipliné ; Chateaubriand fut des premiers après Jean-Jacques qui firent admettre et aimer un personnage isolé et comme perclus dans l’orgueil et l’ennui de sa liberté.
J’admire surtout l’égarement de la vieille France. Ce Régime ancien dont elle garde la religion, l’État français d’avant dix-sept cent quatre-vingt-neuf, était monarchique, hiérarchique, syndicaliste et communautaire ; tout individu y vivait soutenu et discipliné ; Chateaubriand fut des premiers après Jean-Jacques qui firent admettre et aimer un personnage isolé et comme perclus dans l’orgueil et l’ennui de sa liberté.
La vieille France avait ses constitutions propres, nées des races et des sols qui la composaient. Les voyages de Chateaubriand aux pays anglais marquent, avec ceux de Voltaire et de Montesquieu, les dates mémorables de l’anglomanie constitutionnelle ; il ne guérit jamais de son premier goût pour les plagiats du système britannique, libéralisme, gouvernement parlementaire et régime de cabinet.
La vieille France avait l’esprit classique, juridique, philosophique, plus sensible aux rapports des choses qu’aux choses mêmes, et, jusque dans les récits les plus libertins, ses écrivains se rangeaient à la présidence de la raison ; comme les Athéniens du Ve siècle, cette race arrivée à la perfection du génie humain avait, selon une élégante expression de M. Boutmy 4, réussi à substituer « le procédé logique » au « procédé intuitif » qu’elle laissait aux animaux et aux barbares ; Chateaubriand désorganisa ce génie abstrait en y faisant prévaloir l’imagination, en communiquant au langage, aux mots, une couleur de sensualité, un goût de chair, une complaisance dans le physique, où personne ne s’était risqué avant lui. En même temps, il révélait l’art romantique des peuples du nord de l’Europe. Quoiqu’il ait plus tard déploré l’influence contre nature que ces peuples sans maturité acquirent chez nous, il en est le premier auteur.
La vieille France professait ce catholicisme traditionnel qui, composant les visions juives, le sentiment chrétien et la discipline reçue du monde hellénique et romain, porte avec soi l’ordre naturel de l’humanité ; Chateaubriand a négligé cette forte substance de la doctrine. De la prétendue Renaissance qu’on le loue d’avoir provoqué datent ces « pantalonnades théologiques », ce manque de sérieux dans l’apologétique, qui faisaient rire les maîtres d’Ernest Renan. Examinée de près, elle diffère seulement par le lustre du pittoresque et les appels au sens du déisme sentimental propagé par les Allemands et les Suisses du salon Necker. On a nommé Chateaubriand un « épicurien catholique », mais il n’est point cela du tout. Je le dirais plus volontiers un protestant honteux vêtu de la pourpre de Rome. Il a contribué presque autant que Lammenais, son compatriote, à notre anarchie religieuse.
Si enfin le Génie du Christianisme lui donne l’attitude d’un farouche adversaire de la Révolution, de fait, il en a été le grand obligé.
Lorsque, ayant pris congé des sauvages de l’Amérique, François-René de Chateaubriand retrouva sa patrie, elle était couverte de ruines qui l’émurent profondément. Ses premières ébullitions furent, il est vrai, pour maudire dans un Essai 5 fameux ce qui venait d’ainsi périr. Peu à peu toutefois, l’imagination historique reprenant le dessus, il aima, mortes et gisantes, des institutions qu’il avait fuies jusqu’au désert, quand elles florissaient. Il leur donna, non point des pleurs, mais des pages si grandement et si pathétiquement éplorées que leur son éveilla, par la suite, ses propres larmes.
Il les versa de bonne foi. Cette sincérité allait même jusqu’à l’atroce. Cet artiste mit au concert de ses flûtes funèbres une condition secrète, mais invariable : il exigeait que sa plainte fût soutenue, sa tristesse nourrie de solides calamités, de malheurs consommés et définitifs, et de chutes sans espoir de relèvement. Sa sympathie, son éloquence, se détournait des infortunes incomplètes. Il fallait que son sujet fût frappé au cœur. Mais qu’une des victimes, roulée, cousue, chantée par lui dans le « linceul de pourpre », fit quelque mouvement, ce n’était plus de jeu ; ressuscitant, elles le désobligeaient pour toujours.
Quand donc la monarchie française eut le mauvais goût de renaître, elle fut bien reçue ! Après les premiers compliments, faits en haine de Bonaparte et qu’un bon gentilhomme ne refusait pas à son prince, Chateaubriand punit, du mieux qu’il le put faire, ce démenti impertinent que la Restauration infligeait à ses Requiem. Louis XVIII n’eut pas de plus incommode sujet, ni ses meilleurs ministres de collègue plus dangereux.
 Enfin 1830 éclate, le délivre. Voilà notre homme sur une ruine nouvelle. Tous les devoirs de loyalisme deviennent aussitôt faciles et même agréables. Il intrigue, voyage, publie des déclarations. « Madame, votre fils est mon roi ! » La mort de Napoléon II lui donne un grand coup d’espérance ; si le duc de Bordeaux, lui aussi… ? Mais le duc de Bordeaux grandit. Cette douceur est refusée à M. de Chateaubriand de chanter le grand air au service du dernier roi ; il se console en regardant le dernier trône mis en morceaux.
Enfin 1830 éclate, le délivre. Voilà notre homme sur une ruine nouvelle. Tous les devoirs de loyalisme deviennent aussitôt faciles et même agréables. Il intrigue, voyage, publie des déclarations. « Madame, votre fils est mon roi ! » La mort de Napoléon II lui donne un grand coup d’espérance ; si le duc de Bordeaux, lui aussi… ? Mais le duc de Bordeaux grandit. Cette douceur est refusée à M. de Chateaubriand de chanter le grand air au service du dernier roi ; il se console en regardant le dernier trône mis en morceaux.
La monarchie légitime a cessé de vivre, tel est le sujet ordinaire de ses méditations ; l’évidence de cette vérité provisoire lui rend la sécurité ; mais toutefois, de temps à autre, il se transporte à la sépulture royale, lève le drap et palpe les beaux membres inanimés. Pour les mieux préserver de reviviscences possibles, cet ancien soldat de Condé les accable de bénédictions acérées et d’éloges perfides, pareils à des coups de stylet.
Ceci est littéral. À ses façons de craindre la démagogie, le socialisme, la République européenne, on se rend compte qu’il les appelle de tous ses vœux. Prévoir certains fléaux, les prévoir en public, de ce ton sarcastique, amer et dégagé, équivaut à les préparer.
Assurément, ce noble esprit, si supérieur à l’intelligence des Hugo, des Michelet et des autres romantiques, ne se figurait pas de nouveau régime sans quelque horreur. Mais il aimait l’horreur ; je voudrais oser dire qu’il y goûtait, à la manière de Néron et de Sade, la joie de se faire un peu mal, associée à des plaisirs plus pénétrants.
Son goût des malheurs historiques fut bien servi jusqu’à la fin. Il mourut dans les délices du désespoir ; le canon des journées de juin s’éteignait à peine. Il avait entendu la fusillade de février. Le nécrologue des théocraties et des monarchies, qui tenait un registre des empereurs, des papes, des rois et des grands personnages saisis devant lui par la disgrâce ou la mort, n’entonna point le cantique de Siméon sans avoir mis sur ses tablettes l’exil des Orléans et la chute de Lamartine.
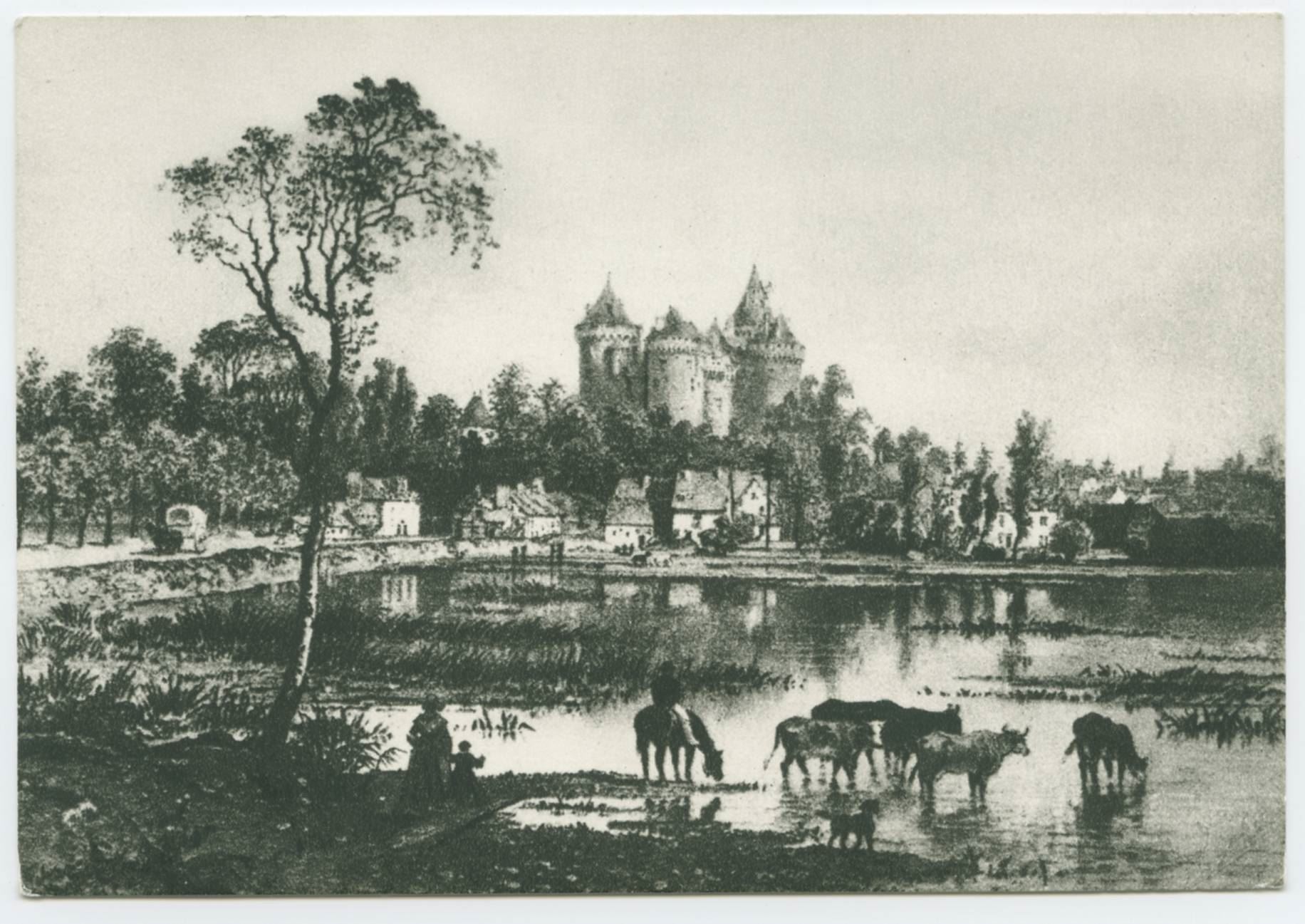 Race de naufrageurs et de faiseurs d’épaves, oiseau rapace et solitaire, Chateaubriand n’a jamais cherché, dans la mort et dans le passé, le transmissible, le fécond, le traditionnel, l’éternel ; mais le passé, comme passé, et la mort, comme mort, furent ses uniques plaisirs. Loin de rien conserver, il fit au besoin des dégâts, afin de se donner de plus sûrs motifs de regrets. En toutes choses, il ne vit que leur force de l’émouvoir, c’est-à-dire lui-même. À la cour, dans les camps, dans les charges publiques comme dans ses livres, il est lui, et il n’est que lui, ermite de Combourg, solitaire de la Floride. Il se soumettait l’univers. Cet idole des modernes conservateurs nous incarne surtout le génie des Révolutions. Il l’incarne bien plus que Michelet peut-être. On le fêterait en sabots, affublé de la carmagnole et cocarde rouge au bonnet. ■
Race de naufrageurs et de faiseurs d’épaves, oiseau rapace et solitaire, Chateaubriand n’a jamais cherché, dans la mort et dans le passé, le transmissible, le fécond, le traditionnel, l’éternel ; mais le passé, comme passé, et la mort, comme mort, furent ses uniques plaisirs. Loin de rien conserver, il fit au besoin des dégâts, afin de se donner de plus sûrs motifs de regrets. En toutes choses, il ne vit que leur force de l’émouvoir, c’est-à-dire lui-même. À la cour, dans les camps, dans les charges publiques comme dans ses livres, il est lui, et il n’est que lui, ermite de Combourg, solitaire de la Floride. Il se soumettait l’univers. Cet idole des modernes conservateurs nous incarne surtout le génie des Révolutions. Il l’incarne bien plus que Michelet peut-être. On le fêterait en sabots, affublé de la carmagnole et cocarde rouge au bonnet. ■












Merci, je n’avais pas vue Chateaubriand sous cet angle, mais il y a du vrai. Il a vécu dans une société qui s’apparente sous certains angles à la nôtre.
Que dirait il de notre actuel monde , avec des dirigeants qui ne dirigent plus . Que dirait il de ces médiats à solde qui imposent leur manière de vivre ensemble, par des mensonges. Comme des enfants, ils jouent a assembler les opposés et ils ont ouvert la boite de pandore. Que penserait il d’un peuple de France qui reste silencieuse par peur de perdre ses acquis matériels.
La France était et reste un ensemble d’individus constituée par les Rois, cet écrivain ne pouvait pas connaître l’ensemble des esprits. La révolution c’est Paris, l’atrocité c’est la Vendée, que dire des autres régions.
La religion chrétienne n’a pas su les réunir, elle s’est même divisée avec l’esprit venu du Nord. Il regrette l’ordre organisé de l’ancien régime. Mais c’est bien l’homme, le croyant, le pasteur, le crédule et l’incrédule, qui ont crée des divisions et des oppositions dans la philosophie chrétienne .Prenons là comme une philosophie nécessaire pour vivre ensemble , une civilisation, notre civilisation et réunissons nous face à un désastre cruel qui s’annonce, nous en avons les prémices.