
Les Deux Patries – réponse de Charles Maurras à la critique d’André Gide des Déracinés de Maurice Barrès, a été publié en 1903 – il y a donc 120 ans – dans la Gazette de France. Ce texte a ensuite été repris et remanié, dans L’Étang de Berre, puis, selon le choix de Maurras, dans ses Œuvres capitales (Flammarion, 1954).
Ce n’est pas par hasard si nous reprenons ces réflexions anciennes. Elles ont toute leur place particulière en cette année 2023 où l’on commémore les 100 ans de la mort de Maurice Barrès. Outre le fait qu’elle sont écrites dans une belle langue d’un style parfait, et que Maurras y déploie tous les talents et toutes les nuances de sa pensée, le thème de l’enracinement, et même celui qui nous reconnaît héritiers de patries plurielles, enfin la question posée aujourd’hui dans l’actualité, de cet acte particulier que Maurras nomme l’élection de sépulture, tout cela s’y trouve traité avec nuance et clarté. Sans relativisme aucun, cependant, car, pour Maurras, la pluralité naturelle de nos diverses appartenances se trouve surmontée, précisément, par le lieu d’élection de notre sépulture. Une élection, donc, mais qui s’impose à chacun comme marque ultime et comme reconnaissance de notre appartenance à une terre et à un héritage déterminés. Le lecteur opèrera le rapprochement qui convient ici avec les débats et les polémiques d’aujourd’hui. ![]()
 M. André Gide [Illustration] a publié le mois dernier, dans L’Occident, quelques notes d’un intérêt très général, sur les conditions de ses origines personnelles. Né en Normandie d’un père languedocien et d’une mère neustrienne, il a essayé de donner à ses lecteurs une idée approximative de ce qu’il éprouvait de la double influence. En quoi le ciel natal et la terre natale l’avaient-ils prédéterminé ? Mais ayant passé son enfance et quelque temps de sa jeunesse en Languedoc, en quoi ce séjour avait-il accentué les dépôts de son ascendance languedocienne ? Le problème indiqué pour le talent particulier de M. André Gide n’est pas indifférent ; j’aurai peut-être occasion de revenir, ces temps prochains, au jeune auteur du Roi Candaule et de L’Immoraliste. Mais il faut prendre garde que le cas n’est pas unique ; étant, il est vrai, très fréquent, les effets en sont aussi divers qu’il comporte lui-même de solutions et d’appréciations distinctes.
M. André Gide [Illustration] a publié le mois dernier, dans L’Occident, quelques notes d’un intérêt très général, sur les conditions de ses origines personnelles. Né en Normandie d’un père languedocien et d’une mère neustrienne, il a essayé de donner à ses lecteurs une idée approximative de ce qu’il éprouvait de la double influence. En quoi le ciel natal et la terre natale l’avaient-ils prédéterminé ? Mais ayant passé son enfance et quelque temps de sa jeunesse en Languedoc, en quoi ce séjour avait-il accentué les dépôts de son ascendance languedocienne ? Le problème indiqué pour le talent particulier de M. André Gide n’est pas indifférent ; j’aurai peut-être occasion de revenir, ces temps prochains, au jeune auteur du Roi Candaule et de L’Immoraliste. Mais il faut prendre garde que le cas n’est pas unique ; étant, il est vrai, très fréquent, les effets en sont aussi divers qu’il comporte lui-même de solutions et d’appréciations distinctes.
Le père de Chénier était languedocien, de la noble ville de Carcassonne. Sa mère était de race grecque. Lui-même divisa ses jeunes années entre les campagnes du Languedoc et les rues de Paris. Que lui est-il resté du triple élément ? Renan expliquait son penchant à la rêverie par ses origines et par sa naissance bretonnes ; quant à son ironie, elle lui paraissait l’héritage gascon qu’il tenait du sang maternel.
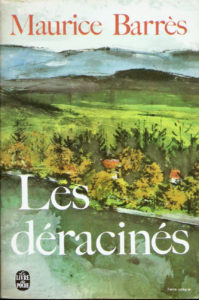 Maurice Barrès est né en Lorraine, de mère Lorraine : voilà pour le goût précis des réalités et le don de caricatures. Mais les Barrès viennent de Haute-Loire, des pentes du massif central, le pays des Pascal, forte race passionnée et spéculative. Anatole France, né à Paris d’un Parisien, tire, je crois, son extraction grand’maternelle des campagnes du Maine et de l’Anjou ; son œuvre délicate offre aux nymphes de Seine je ne sais quoi de gai, de luxuriant, d’opulent, comme un ressouvenir des paysages de la Loire ; elle est seizième siècle, en même temps que dix-septième ; elle paraît Valois presque autant que Bourbon. Je dirai quelque jour ce qu’il y a de provençal et ce qu’il y a de celtique dans l’œuvre, si curieuse, de M. Frédéric Plessis 1, ce latin de Bretagne et ce breton classique. Qu’il écrive en vers ou en prose, qu’il mesure les fines cadences de Vesper ou compose les fermes moralités du Chemin moulant, ses livres restent marqués de la double griffe, pensée et rêverie, romantisme natif et classicisme héréditaire. Réussirai-je à l’expliquer à ce latiniste éminent ? dans l’idée même qu’il se fait de la force romaine, il y a du génie breton.
Maurice Barrès est né en Lorraine, de mère Lorraine : voilà pour le goût précis des réalités et le don de caricatures. Mais les Barrès viennent de Haute-Loire, des pentes du massif central, le pays des Pascal, forte race passionnée et spéculative. Anatole France, né à Paris d’un Parisien, tire, je crois, son extraction grand’maternelle des campagnes du Maine et de l’Anjou ; son œuvre délicate offre aux nymphes de Seine je ne sais quoi de gai, de luxuriant, d’opulent, comme un ressouvenir des paysages de la Loire ; elle est seizième siècle, en même temps que dix-septième ; elle paraît Valois presque autant que Bourbon. Je dirai quelque jour ce qu’il y a de provençal et ce qu’il y a de celtique dans l’œuvre, si curieuse, de M. Frédéric Plessis 1, ce latin de Bretagne et ce breton classique. Qu’il écrive en vers ou en prose, qu’il mesure les fines cadences de Vesper ou compose les fermes moralités du Chemin moulant, ses livres restent marqués de la double griffe, pensée et rêverie, romantisme natif et classicisme héréditaire. Réussirai-je à l’expliquer à ce latiniste éminent ? dans l’idée même qu’il se fait de la force romaine, il y a du génie breton.
Il est inutile de dire que l’on ne prétend pas tout expliquer, tout dévider de ce fait de double origine, chez des esprits si différents les uns des autres et eux-mêmes si variés. Aux explications monistiques du monde, aux plus ingénieuses réductions unitaires qui se doivent jamais tenter, l’on peut toujours répondre, comme dans Hamlet, qu’il y a beaucoup plus de choses dans l’univers que n’en soupçonnera notre humaine sagesse. Mais cette sagesse elle-même est un élément du mystère universel et elle contribue à la merveille immense. Notre monde serait-il monde, s’il se diminuait de la réflexion des humains ? Elle laisse sans doute beaucoup de faits puissants dans l’ombre. Mais ceux qu’elle enveloppe dans les réseaux de sa lumière, pour les présenter en bon ordre, aident à deviner le reste et le font paraître meilleur.
… C’est en remuant ces pensées ou ces songeries, pour mieux dire, que je relisais de mémoire l’article de M. Gide. Une admirable journée d’hiver venait de s’éteindre. Le foyer de sarments et de ceps s’allumait à peine ; il n’avait fait ni vent, ni froid, ni humidité : non pas même légère. Sous le ciel ondoyé de douces vapeurs, l’air était resté sec comme aux plus beaux jours de l’été, l’allumage du feu au tomber de la nuit n’avait que la valeur d’un rite de famille, peut-être destiné à activer le cours de la méditation et à fixer les yeux, depuis que, dans les vitrages de la croisée, le ciel occidental avait laissé mourir ses dernières bandes rougeâtres. Le jeu du bois incandescent, des charbons dévorés, de la cendre, de la flamme et de la fumée avive plus qu’on ne peut dire nos secrètes activités.
Les premières minutes que je passai ainsi furent surtout données à jouir de la surprise extrême que me cause, depuis dix beaux jours, mon pays. Ce coin de la Provence palustre et maritime, il y a peut-être quinze ans, et davantage, que je ne l’avais vu (ou si bien vu) à cette époque des calendes d’hiver où toute lumière renaît. À mes plaisirs d’admiration, il s’est mêlé une joie de saisissement. L’année dernière, sur les pentes toujours fleuries de Tamaris 2 le nouveau regard entr’ouvert de mimosas fut d’un grand charme. Mais je n’y trouvais rien que d’ordinaire, de prévu et de naturel. Les vastes abris de rocher qui dominent la région toulonnaise et la suite de la Rivière forment les vallons et les plaines en véritables serres et en jardins d’hiver. Mais quoi de plus démuni que l’étang de Berre et de plus exposé aux rafales du nord-ouest ? Nos plateaux, nos collines sont trop peu élevés et percés de trop de couloirs pour déterminer aucun abri important. Une terrasse, un mur, une niche de quelques pieds de hauteur, ce sont bien nos seules ressources aussitôt que descend des Cévennes un flot d’air glacé. Cette année, il n’en descend point. Une [fine] atmosphère dont on n’ose exactement dire qu’elle est tiède, enveloppe les sens qui se tiennent à l’ombre. S’ils vont au soleil, l’astre oblique les contraint à se dépouiller. Il fait véritablement chaud et cette chaleur pénétrante forme un contraste singulier avec la discrétion, la pâleur, les nuances de la lumière au ciel, qui semble traverser une phase de maladie.
Quelle est jolie, ainsi ! Quelle grâce elle ajoute au sévère dessin du pays ! Ce que j’en éprouve ne peut être senti que par comparaison. Imaginez le plus beau visage, mais de lignes un peu trop sèches, trop fines, trop aiguisées et dont c’est le défaut peut-être, défaut divin, d’exprimer trop vivement les saillies de l’esprit, les traits de l’ironie et les divinations de l’intelligence. [Il faut donc qu’une peine, presque une larme,] un rapide nuage de mélancolie le traverse et, pour un instant, brouille ces beaux feux toujours pétillants : la langueur, la mollesse de la lumière ainsi voilée donne à un tel visage sa perfection, celle-là même qu’on n’osait désirer pour lui, car il en semblait incapable et paraissait même devoir s’en passer à jamais. Tel, dans nos clairs parages, ce ciel d’hiver, tout tempéré, tout attendri par l’écharpe de brume qui s’envole des eaux et qui vient y flotter. Plus de verts, ni de roses, plus de lilas : le glauque, l’améthyste, l’aurore se diluent à l’infini dans un air diaphane, qu’il faut dire couleur de fleur, je ne trouve point d’autres mots.
Détachez là-dedans d’élégantes masses d’arbustes, des rivages courbés avec une grâce hardie et ces tendres collines en forme de mamelle, pleines de cyprès et de pins. Les vapeurs montent en colonnettes légères ou rampent longuement sur le flanc des petites hauteurs prochaines ; mais l’horizon, montagnes ou rivage, montagnes teintes de safran et qui feraient hennir les cavales de Darius, rivages éloignés du désert de Camargue où roule un soleil pourpre sombre, l’horizon trace un cadre d’une pureté magnifique à ces beautés que l’incertitude ennoblit. Tous les bords de la vasque sont dorés et définis par un jour d’été ; au creux approfondi, les vapeurs, les tristesses, les cendres automnales d’un Élysée. Mais ce n’est point [le pas des sages que j’écoute venir. La voix de la sirène aura frissonné doucement et peut-être ai-je déjà vu émerger sa tête brumeuse.]
… Avons-nous deux patries, ou trois, ou quatre en une seule ? Car la mienne, qui tient en quelques lieues carrées est bien profondément variée, changeante et complexe ! À la moindre pente gravie, tout l’aspect est renouvelé. Je pense que M. André Gide est un bien honnête homme de se contenter, comme il fait, d’une double patrie. La mienne vient de me montrer, dans son temps de Noël, une de ces têtes divines que les Germains océaniques voyaient au couchant de leur mer, comme le raconte Tacite 3 !
 Je tiens de Barrès qu’il y a des rapports entre nos plus pauvres quartiers et ce que l’on rencontre à Murano et à Ghioggia, faubourgs de Venise ; mais pourquoi cette lumière d’aquarium, ces étangs, ces quais et ces canaux morts ne me mèneraient-ils à quelque bourgade des Flandres ? Quelque chose me parle aussi, à des égards tout autres et tout aussi réels, des beaux lacs du nord-italien. Quand l’évêque Augustin rencontra, sur le sable, le petit enfant qui voulait, avec sa coquille, épuiser l’abîme des mers : — Quelle folie, gémit le saint. L’Océan dans ta pauvre conque ! — La folie de tout homme, hélas ! lui répondit, je crois, le petit enfant. N’est-ce pas notre univers entier qu’aspire le misérable souffle d’une âme ?
Je tiens de Barrès qu’il y a des rapports entre nos plus pauvres quartiers et ce que l’on rencontre à Murano et à Ghioggia, faubourgs de Venise ; mais pourquoi cette lumière d’aquarium, ces étangs, ces quais et ces canaux morts ne me mèneraient-ils à quelque bourgade des Flandres ? Quelque chose me parle aussi, à des égards tout autres et tout aussi réels, des beaux lacs du nord-italien. Quand l’évêque Augustin rencontra, sur le sable, le petit enfant qui voulait, avec sa coquille, épuiser l’abîme des mers : — Quelle folie, gémit le saint. L’Océan dans ta pauvre conque ! — La folie de tout homme, hélas ! lui répondit, je crois, le petit enfant. N’est-ce pas notre univers entier qu’aspire le misérable souffle d’une âme ?
Si j’ai un peu modifié l’histoire augustinienne 4, on voudra bien me le pardonner. Je ne suis d’ailleurs pas très sûr de la justesse de mon interprétation. Si médiocre, si commune que soit notre âme, elle se découvre parfois et tout d’un coup des étendues ou des profondeurs sur lesquelles l’habitude avait fait la nuit. En continuant de songer au coin de notre feu aux deux patries de M. Gide, il m’est souvenu en effet que, par delà la complexité de la terre natale, une autre patrie, celle des origines paternelles me ferait pénétrer dans un nouveau monde. Elle n’est pas très loin d’ici. Dix lieues au plus, et c’est toutefois un pays aussi différent que possible de celui-ci. M. André Gide parlait de Normandie ? C’en est une, en pleine Provence. Elle est composée de prairies, de chaque côté du petit fleuve d’Huveaune, qui descend de la Sainte-Baume, vert rouleau de pelouse étoilé de marguerites et de boutons d’or, planté de gros pommiers, arrosé d’une eau toujours fraîche, que de hautes futaies accompagnent jusqu’à la mer. De grands ifs, des peupliers robustes, des houx, des noisetiers, des sureaux, des osiers, des tilleuls odoriférants, tous les arbres du Nord et de l’Ouest, ceux que l’on voit se dépouiller aux mois d’hiver, mais fleurir et prendre leurs feuilles à la belle saison, sortent d’une terre abondante, dénuée de légèreté ; sans doute le cyprès, l’olivier et le pin dressent, non loin, sur les coteaux, leur ferme stature éternelle, entre les bouquets de câpriers qu’on couvre de terre au temps froid. Mais le fond de cette vallée veut ignorer tout l’ordinaire des végétations provençales ; la race ingénieuse, active, mais d’un réalisme effrayant, montre des goûts et des besoins, qui passent le niveau de la commune frugalité.
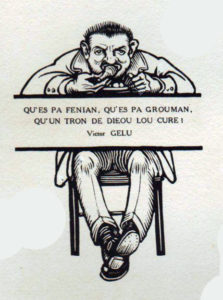 Je ne peux m’empêcher de me représenter ces âpres terriens comme le vivant repoussoir de nos matelots : je les vois étendus sur leur pré d’émeraude, en train d’éventrer la pastèque ou de boire d’un incomparable muscat, figues, jujubes et azeroles, pommes, pêches et poires ventrues jonchant la nappe et le tapis que l’on étend sur l’herbe pêle-mêle avec les sucreries et les salaisons. Simples goûters, au reste; mais dans leur repas de moisson, tous les animaux concevables sont mis à toute sauce et largement arrosés de tous les alcools. Pauvre paysan, pauvre pêcheur de mon Martigue, rassasié de ta demi-douzaine d’olives et d’un peu de pain frotté d’ail ou de quelques anchois marinés de saumure, comme l’idée de tels festins me rapproche de toi ! Mais ce Gargantua ne m’est pourtant pas étranger, et le sourire qu’il me donne ne saurait mépriser le bord où les pères des pères de mes pères ont vécu. Je ne puis oublier ni ce lit de verdure ni cet arceau de fleurs, de ma petite enfance, et je m’en sens embarrassé à peu près comme M. Gide de celle de ses deux patries qui lui est la moins chère. [Illustration de Louis Jou, pour le Grourmandugi du restaurateur Maurice Brun, à Marseille).
Je ne peux m’empêcher de me représenter ces âpres terriens comme le vivant repoussoir de nos matelots : je les vois étendus sur leur pré d’émeraude, en train d’éventrer la pastèque ou de boire d’un incomparable muscat, figues, jujubes et azeroles, pommes, pêches et poires ventrues jonchant la nappe et le tapis que l’on étend sur l’herbe pêle-mêle avec les sucreries et les salaisons. Simples goûters, au reste; mais dans leur repas de moisson, tous les animaux concevables sont mis à toute sauce et largement arrosés de tous les alcools. Pauvre paysan, pauvre pêcheur de mon Martigue, rassasié de ta demi-douzaine d’olives et d’un peu de pain frotté d’ail ou de quelques anchois marinés de saumure, comme l’idée de tels festins me rapproche de toi ! Mais ce Gargantua ne m’est pourtant pas étranger, et le sourire qu’il me donne ne saurait mépriser le bord où les pères des pères de mes pères ont vécu. Je ne puis oublier ni ce lit de verdure ni cet arceau de fleurs, de ma petite enfance, et je m’en sens embarrassé à peu près comme M. Gide de celle de ses deux patries qui lui est la moins chère. [Illustration de Louis Jou, pour le Grourmandugi du restaurateur Maurice Brun, à Marseille).
 Je revois une côte de ma Normandie provençale qui porte le caveau où gisent les morts de mon nom. Elle est si clairement exposée au soleil que tout y paraît blanc et or, on n’y respire que l’odeur de la menthe sauvage ou celle du thym, et les touffes de lauriers-rose y sont presque toujours en fleurs. Je connais peu de lieux au monde plus avenants, plus propres, mieux faits pour nous donner à sentir tout le prix du sommeil éternel. Pourtant jamais l’idée ne m’est venue de venir reposer sous ces pierres blanches. Mais un vaste plateau bien nu, bien tourmenté par le fléau de chaque vent qui passe, complanté de ces longues tiges amères que le vent salin corrode, que la brume pourrit avant que le soleil les tue, ce cimetière populeux et décoré pourtant d’édicules doriques dont la pierre fauve joue mal les marbres athéniens, le pas des pêcheurs graves, celui des rustiques timides, l’illumination annuelle la nuit qui précéda le jour des Morts, un certain plain-chant que je connais bien aux cérémonies mortuaires, des rites, tels et tels, dont le manque m’affligerait, tous ces signes, d’autres encore, qu’il est importun de noter, me déclarent où il convient que je fixe mon lit funèbre : non, il est vrai, par élection délibérée, mais par une nécessité dérivant de l’ensemble de tout ce que j’aime et je suis. #
Je revois une côte de ma Normandie provençale qui porte le caveau où gisent les morts de mon nom. Elle est si clairement exposée au soleil que tout y paraît blanc et or, on n’y respire que l’odeur de la menthe sauvage ou celle du thym, et les touffes de lauriers-rose y sont presque toujours en fleurs. Je connais peu de lieux au monde plus avenants, plus propres, mieux faits pour nous donner à sentir tout le prix du sommeil éternel. Pourtant jamais l’idée ne m’est venue de venir reposer sous ces pierres blanches. Mais un vaste plateau bien nu, bien tourmenté par le fléau de chaque vent qui passe, complanté de ces longues tiges amères que le vent salin corrode, que la brume pourrit avant que le soleil les tue, ce cimetière populeux et décoré pourtant d’édicules doriques dont la pierre fauve joue mal les marbres athéniens, le pas des pêcheurs graves, celui des rustiques timides, l’illumination annuelle la nuit qui précéda le jour des Morts, un certain plain-chant que je connais bien aux cérémonies mortuaires, des rites, tels et tels, dont le manque m’affligerait, tous ces signes, d’autres encore, qu’il est importun de noter, me déclarent où il convient que je fixe mon lit funèbre : non, il est vrai, par élection délibérée, mais par une nécessité dérivant de l’ensemble de tout ce que j’aime et je suis. #
M. André Gide a-t-il fait ce choix de la place où il dormira ? Cette option de sépulture pourra le renseigner sur sa véritable patrie. ■
Texte repris du site
Maurras.net
JSF le 10 novembre 2021 – Actualisé le 28 février 2023, en l’année des 100 ans de la mort de Maurice Barrès











