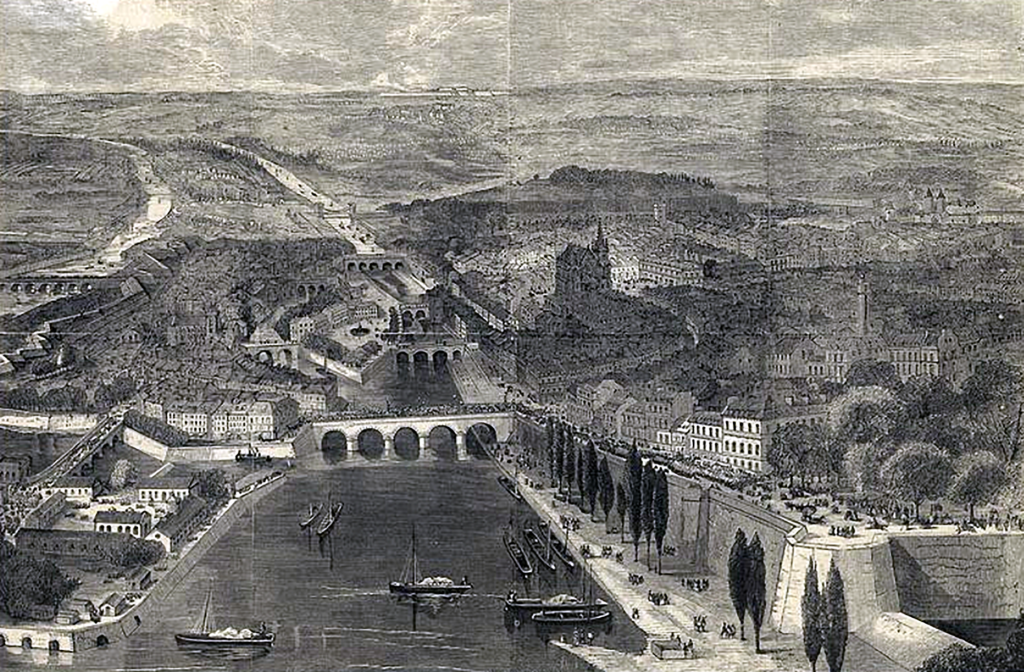
Nous poursuivons ici notre survol barrésien des dimanches de cette année 2023, avec, pour le mois d’octobre, l’annonce de la réédition de son roman Colette Baudoche, deuxième tome de la trilogie « Les bastions de l’est ».
Pierre Lasserre fit une recension de ce roman pour « La chronique des lettres » de l’Action française. Ce texte, d’une qualité remarquable, fut publié le 23 février 1909.
Le voici en intégralité :
« Colette Baudoche, jeune fille de Metz, l’héroïne du beau livre que Maurice Barrès vient de publier chez Juven, est, nous dit-il, la sœur de l’Alsacien Ehrmann, du Service de l’Allemagne. Sœur bien modeste, dans sa finesse, sa vivacité et sa malice, et de qui le discret héroïsme inspiré, comme celui d’Ehrmann, par le devoir de maintenir aux pays annexés, l’intégrité d’une France morale, est mieux fait encore pour toucher les cœurs. Ehrmann est de haute bourgeoisie, et il possède une culture supérieure. Les responsabilités d’une situation sociale, le sentiment aristocratique de sa participation personnelle à l’héritage du passé alsacien-français peuvent le soutenir jusqu’à l’enthousiasme dans le parti courageux qu’il prend vis-à-vis du maître prussien, en vue de sauver les intérêts de l’avenir. Colette est presque du peuple, presque perdue dans la foule des anonymes. Imaginez, quelque chose comme la fille d’un petit officier d’administration mort trop jeune pour faire de sa fille une dame. Colette, orpheline, et sa grand’ mère, vivent d’une rente de, douze cents francs et de quelques travaux de couture. Elles ne sont pas savantes. Des volumes dépareillés d’une ancienne revue provinciale, l’Austrasie, forment leur bibliothèque. Mais elles savent très bien qu’elles ne veulent pas, qu’elles ne peuvent pas être allemandes. Incapables de rétorquer les discours d’un Jaurès sur la bonne mine à faire au vainqueur, en attendant les « réparations de la justice immanente », elles n’en seraient pas désarçonnées le moins du monde. Elles se regarderaient en haussant les épaules, une fois le discoureur sorti. Colette demanderait comment on peut sympathiser avec des gens qui mangent avec leur couteau, par bouchées énormes et si bruyamment ! La vieille Mme Baudoche parlerait des grands fonctionnaires allemands de Metz, de ce « conseiller » qui a un fumoir, une bibliothèque, un cabinet de travail et deux salons, mais fait coucher ses trois bonnes dans la même chambre, et les paye « vingt marks par mois sans la clef, ou quinze avec la clef » — la clef de la petite porte —- et chez qui on se nourrit de charcuterie, les jours où il n’y a pas réception et grand, dîner. « Quelle différence, conclurait Mme Baudoche, avec nos familles, messines ! »

Hé quoi ! M. Maurice Barrès, qui continue dans ce livre la comparaison de deux peuples, au point de vue de la civilisation, et qui en tient passionnément pour l’avis des dames Baudoche, est-il assez frivole pour juger lzs Allemands sur leur manière d’agir à table ? J’entends d’ici un pédant anthropologue s’exclamer avec ironie que M. Barrès a découvert la civilisation de la fourchette (comme on dit : civilisation du silex, du bronze, de la houille).
Pour moi, je suis loin de trouver dans l’importance que M. Barrès donne à ce couteau de table la moindre frivolité. Serait-ce que, pendant de bien longs séjours en Allemagne, j’ai eu constamment les yeux et les oreilles offensés par les mangeurs ? Cette raison pourrait passer pour insuffisante. Mais j’en ai une autre. Je dirais, si ceci n’avait un air de pose, que l’observation de Colette porte fort loin et qu’elle fait d’excellente critique philosophique, sans le savoir. Après être jadis parti pour l’Allemagne avec un vague enthousiasme, reçu de Renan et de Taine, pour Hegel, Fichte et Schelling, je ne tardai pas à me rendre compte que ces fameuses philosophies s’expliquaient par une extrême voracité. Ces métaphysiciens insatiables, méprisant tout point de vue partiel sur l’univers, s’installent au. centre du monde, sur le siège du Dieu immanent et infini. Vus de ce trou profond, tous les êtres, toutes les choses, tous les faits de la nature et de l’histoire ne font qu’un ; ils s’aperçoivent, ou, pour mieux dire, ils s’éprouvent tous ensemble, et consubstantiellement dans une intuition que peut seule porter une tête allemande et dont les Français, disait Fichte, n’étant pas « un peuple primitif », demeureront éternellement incapables ! L’excellent Prussien en concluait la nécessité de nous démembrer. Mais il s’agit ici de sa philosophie, laquelle consiste, on le voit, à absorber dans un unique repas intellectuel tout le contenu des bibliothèques. On mange beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qu’on mange.
Si les dames Baudoche sont à Metz d’intraitables patriotes lorraines et françaises, elles sont d’ailleurs pleines d’honnêteté et de délicatesse, disposées à la justice envers les braves gens, de par tout. Et puis elles ont besoin d’un locataire pour les deux chambres joliment garnies et bien exposées, qui forment la partie agréable de leur appartement. C’est pourquoi douze cents francs n’étant que douze cents francs, elles reçoivent avec une bienveillance relevée d’une moquerie qu’il ne perçoit pas, M. le docteur Frédéric Asnius. Asmus est un assez beau Prussien de vingt-cinq ans, qui arrive à Metz comme professeur au, lycée, « vêtu ou plutôt matelassé d’une redingote universitaire » et bardé de pédantisme. Pédant non seulement dans l’application à tout propos de ses connaissances livresques, mais dans la précision avec laquelle il fait une fois constater à Mme Baudoche qu’elle lui porte son café au lait quatre minutes trop tard. Ce sont, les dames Baudoche qui taxent cette observation — venant. d’Asmus — de simple pédantisme. Et on voit assez, à ce trait, ce qu’elles ont de finesse et de mesure.
Ce n’est pas que le pédantisme d’Asmus ne pût, s’il ne rencontrait à côté de lui que la docilité un peu prostrée qui se voit chez beaucoup de femmes allemandes, devenir quelque chose de fort têtu et de fort brutal, Mais Asmus est à un âge où les ankyloses morales n’ont pas encore eu le temps de se former. Et cet éléphant vient de tomber dans un cercle magique, le cercle de Colette. Cette petite Lorraine, peu instruite, à qui il propose de prêter des auteurs français, ne va plus cesser de lui apprendre un monde de choses surprenantes et de l’ébahir doucement.
Le thème général du livre de Barrès, c’est tout d’abord de faire vivre et de nous faire sentir dans les pensées et les mobiles des dames Baudoche le plus pur, le plus intime et le plus précieux du génie et des traditions d’une race ; c’est, en même temps, de nous montrer un jeune Allemand, avide de s’accroître, qui découvre avec une application consciencieuse et fructueuse, une sagacité appesantie, la civilisation française.
Je ne suivrai point ce digne barbare dans le travail intérieur par lequel il se déprend peu à peu des grossiers prestiges de la quantité et de la masse, pour concevoir, et, même pour sentir, bien qu’avec une sûreté insuffisante, le prix de la qualité, du choix, du goût en toutes choses ; dans l’organisation du bien-être matériel et des commodités de la vie, dans le décor (tant humble que riche) de la maison et de la cité, dans la parure de la femme, dans la manière de manifester les sentiments et dans les jouissances de la littérature et de l’art. Voici, prise entre cent, une page où nous comprenons comment M. Asmus sera amené à soupçonner ce qu’il y a de monotone, de fastidieux, de stérile dans cette disposition panthéistique allemande qu’il a dû tenir jusqu’ici pour une richesse de l’esprit. Il entreverra du même coup que les idées « superficielles, sèches, positives », inspirées aux deux Lorraines par le paysage local, regardent des horizons autrement étendus, non seulement de pensée, mais de belle émotion tout humaine et pure d’animalité.
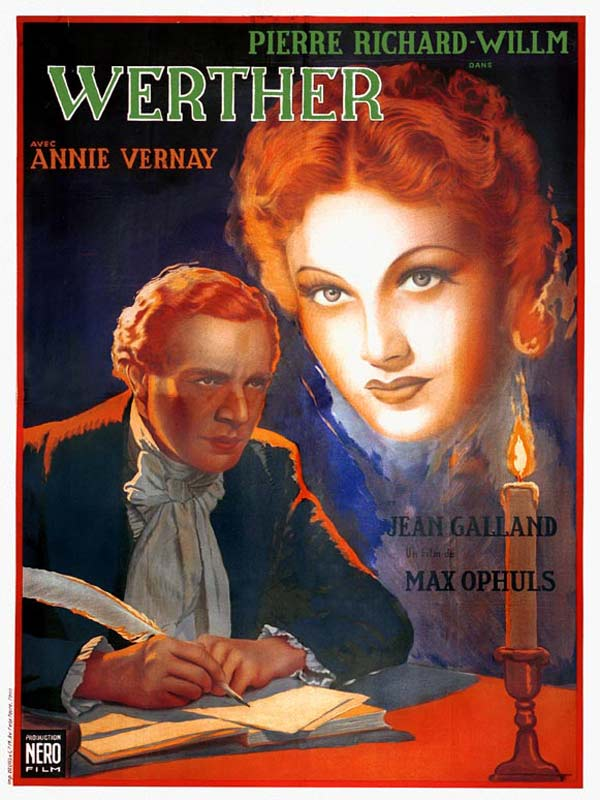
M. Asmus, qui sent la nature à la mode d’un Werther, s’y disperserait, et le cadastre le gêne. Bien souvent, avee ses camarades d’université, il a gravi des montagnes et fait de longues marches en forêts ; il s’emplissait alors d’un plaisir confus dont il n’a gardé aucun bénéfice. Mais, chaque soir, les dames Baudoche, à la manière de nos religions occidentales qui placent les déesses, les saints et les anges, partout, comme un écran entre nous et la nature, lui nomment les châteaux, les autorités sociales, les souvenirs des cantons qu’il a traversés. Elles humanisent sa promenade du jour et l’envoient, la semaine suivante, aux meilleurs points d’où il verra les vertus de la terre lorraine. Ces belles précisions sauvent M. Asmus du vague. À la place d’une rêverie stérile, qu’il aurait subie, s’il avait été seul, le jeune Germain reçoit un excitant à la vie et voit naître dans son esprit une parenté avec les gens qui façonnèrent cette campagne.
Les sympathies lorraines de M. Asmus, manifestées en quelques occasions décisives, lui attirent le blâme de ses collègues. Il se prononce fortement contre le projet d’interdire le français dans les écoles. Il ne veut pas des mesures qui ont pour objet la germanisation intellectuelle et morale du pays, estimant que la domination politique et militaire suffit.
« Vous êtes, Asmus, lui dit un pangermaniste, devenu un tenant de la culture française. Quelle mystification ! Que voyez-vous que nous puissions envier à ces voisins. Leur langue est claire, parce qu’ils ne vont jamais au fond des choses ; leur cuisine excite les sens ; la politesse de leurs salons n’est que le manteau de la débauche… » Un Allemand a-t-il besoin d’être pangermaniste pour parler ainsi ? Je reconnais plutôt là la théorie orthodoxe et officielle sur la France, que l’enseignement public recommande depuis plus d’un demi-siècle aux jeunes générations germaniques, empressées d’y croire. J’ai entendu de mes oreilles un général prussien, brave homme, renseigner un adolescent sur les mœurs de Paris, dans les termes suivants : « Vous savez ! il y a à Paris quelques vraies familles ! » comme il lui eût dit : « Quoi qu’on prétende, il y a quelques blancs à Tombouctou ».

Asmus réplique par un discours excellent qui est une des maîtresses pages du livre, et qui donne la quintessence de ce que Gœthe, Schopenhauer, Nietzsche ont, dit sur la supériorité de la culture française, ou plutôt sur le défaut profond de culture véritable dans cette Allemagne « civilisée trop rapidement et surchargée [surchargée de notions, de science livresque] au point que sa sensibilité n’a jamais pu se développer… Nous n’avons fait qu’absorber, dit-il. Où est notre nature ? Nous devons être très contents que ce pays mette un peu de France à notre disposition. » Et il faut y respecter l’intégralité de cette France spirituelle, comme la force macédonienne protégea le génie de l’Attique désarmée et envahie. Mais M. Asmus ne convainc pas ses collègues. Et, à vrai dire, je le tiens lui-même pour le symbole d’une possibilité plutôt que d’une réalité. Je ne l’ai jamais rencontré en Allemagne. Mais c’est peut-être que je ne l’ai pas assez cherché. Je suis porté à penser que cette manière de considérer la France se répandrait assez vite en Allemagne, où elle a régné jadis, du jour où le canon français aurait tonné victorieusement au-delà du Rhin. Nous-mêmes, notre manie de culture allemande, de critique allemande, de science allemande, n’a-t-elle pas suivi la victoire prussienne de 1815, celle de 1870 ? C’est une forte chose que le fait. Et les Cousin, les Quinet, les Renan, avec leurs naïves et sincères piétés de jeunesse pour le génie de l’« idéalisme » germanique; que firent-ils autre chose que platoniser sur l’invasion ?
Et l’héroïsme de Colette en tout ceci ? Vous le devinez. M. Asmus ne vit pas chez elle, ne prend pas pension chez elle, pendant un an, n’a pas eu la tête retournée par ses enchantements, sans la désirer pour femme.
Il a mérité, le brave garçon, que Colette devînt fort son amie. Et, certes, si l’enveloppe mortelle de M. Asmus n’était pas celle d’un Prussien !… Combattue pendant un mois, entre l’instinct de la nature la plus saine et l’honneur à la française, Colette refuse. Songez que M. Asmus, c’était l’avenir assuré, que Colette court tous risques de manquer son destin de femme, et qu’enfin elle a vingt ans ! Les pages où est raconté ce débat sont parmi les plus belles de l’ouvrage, d’une force et d’une grâce d’émotion, qu’un Grec eût enviées.
Mais il aura été sensible à tout lecteur que, pour donner une idée d’ensemble, je prenais le parti de ne pas inventorier les richesses littéraires de l’ouvrage.
Nous, cependant, conclut Barrès, acceptons-nous qu’une vive image de Metz subisse les constantes atteintes qui doivent à la longue l’effacer ? Et suffira-t-il à notre immobile sympathie d’admirer de loin un geste qui nous appelle ? »

Hélas ! Il est paradoxal, il est douloureux, mais il est trop justifié de dire que la pointe la plus avancée de la défensive ou de l’offensive française contre l’ennemi étranger n’est pas aujourd’hui à Metz, chez Colette, mais à Paris. Vous n’ignorez pas, je l’espère, Colette, mais vous serez en tout cas très heureuse d’entendre que les avant-postes sont engagés et de telle manière qu’il y aura de quoi se pendre… comme le brave Grillon, si l’on n’y a pas été. Au Rhin, certes ! Mais la route du Rhin, la route de l’indépendance nationale, est obstruée à l’entrée par le parti de Dreyfus. »
Pierre LASSERRE.
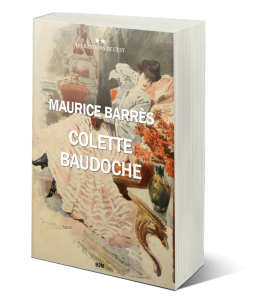
Nombre de pages : 96.
Prix (frais de port inclus) : 19 €.
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : B2M – Belle-de-Mai Éditions : commande.b2m_edition@laposte.net ■











