
Nous poursuivons ici notre survol barrésien des dimanches de cette année 2023, avec, pour le mois de décembre, l’annonce de la réédition du Jardin sur l’Oronte (1922), initialement publié par Plon, aujourd’hui réédité par Belle-de-Mai Éditions.
Le journal royaliste L’Action Française ne manqua pas, sous la plume d’Eugène Marsan d’en rédiger une recension, qui parut le 6 juillet 1922, que voici :
Ils étaient sept à table. Sept jeunes écrivains. Savoir, trois romanciers, quatre ou cinq critiques, au moins cinq poètes. Le tout en sept personnes, à cause du cumul. Pléiade rassemblée pour un jour.
Ils regardaient par la fenêtre ouverte un bel arbre verdi par un jeune été menteur. Ils admiraient les grandes palmes à peine remuées avec ce sentiment d’allégresse que les beautés inanimées communiquent un instant au cœur humain, jusqu’à ce que l’on s’avise, comme si c’était malin ; qu’elles passent, que les feuilles tombent. Je ne sais si l’on partit de là, ou de quelque autre association d’idées, pour parler de Barrès, qui aime les arbres, assurément, mais tant d’autres choses sous le ciel, que des écrivains de ma génération, si vous les réunissez, tous les chemins les ramènent à l’auteur des Déracinés.
Au fait, pourquoi taire le nom des sept, plus heureux encore de se retrouver que de goûter ensemble un bon vin ? C’était Pierre Benoît, jovial et tranquille, ô M. Souday ; Francis Carco, qui parle doucement, Tristan Derème, escogriffe disert, Roland Dorgelès, qui fait penser à Courteline, le seigneur Lucien Dubech et le grand vizir Henri Martineau. Septième, le soussigné.
Nous parlions donc de Barrès. De sept que nous étions, venus chacun d’un quartier différent de la Cité de l’art, mais à très peu près du même âge, six s’offrirent à réciter par cœur au moins un passage du Lorrain.
« Avec tous mes pères romantiques, commença Pierre Benoît, je ne demande qu’à descendre des forêts barbares et qu’à rallier la route royale, mais il faut que les classiques à qui nous faisons soumission nous accordent les honneurs de la guerre, et qu’en nous enrôlant sous leur discipline parfaite ils nous laissent nos riches bagages et nos bannières assez glorieuses.
— « Reste, scanda Lucien Dubech, en enchaînant, et trouvant dans sa surprenante mémoire la conclusion même de la page citée par Benoît, reste, m’a dit la Grèce, où te veulent tes fatalités. Tu n’as pas à masquer, dénaturer ni forcer ce qu’il y a dans ton cœur, mais simplement à le produire. Demeure à l’Orient de la France, avec ta petite nation, à combattre pour ma beauté que tu n’es pas prédestiné à vivre. »
— « La beauté des jeunes femmes, prononça Martineau, est distribuée sur les diverses parties de leur corps ; aussi, pour la goûter, faut-il beaucoup de soins et leur grande complaisance, mais cette beauté, quand elles vieillissent, se fixe toute sur leur visage. C’est ainsi que, dans ma jeunesse, j’ai cru la beauté dispersée à travers le monde et principalement sur les régions les plus mystérieuses, mais aujourd’hui j’en trouve l’essentiel sur le visage sans éclat de ma terre natale. »
Et Carco, qui parle doucement, qu’on entend bien : « Petit garçon, tu n’avais pas tort de mépriser les cuistres, dispensateurs d’éloges et ordonnateurs de la vie, de qui tu dépendais ; tu montrais du goût de te plaire, de fois à autre, par les temps humides, à pleurer dans un coin plutôt que de jouer avec ceux que tu n’a vais pas choisis. »
Derème nous demanda de ne pas oublier l’ironiste, celui qui faisait si bien parler Renan. Comme, par exemple, de cette manière, à la tête de Turc qui s’appelait Chincholle :
« La curiosité, c’est la source du monde. Par elle, naissent la science et l’amour. J’ai vu avec chagrin un petit livre pour des enfants, où la curiosité était blâmée… Le plus dangereux des libelles, véritable pamphlet, contre l’humanité supérieure. Mais telle est la force d’une idée vraie que l’auteur de ce coupable écrit nous fait voir à la dernière page Touchatout qui goûte du levain et s’envole par la fenêtre paternelle ! Il plane par-dessus le monde… C’est Gœthe, c’est Léonard de Vinci… »
— Cette idée n’a jamais cessé de m’amuser, poursuivit l’auteur de la Verdure dorée. Les poètes ont ainsi des songes qui les font rire tout seuls, dans la rue, et l’on se moque d’eux, mais ils sont vengés par avance.
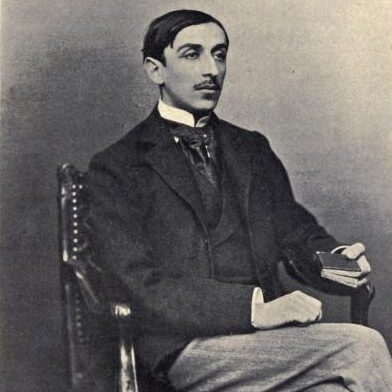
Nous étions lancés. Les citations, les unes après les autres, partaient comme des fusées. Dubech rappelait cet hippodrome suburbain dont Barrès fit un symbole des expédients auxquels est réduit l’esprit que la vie oblige de composer. Carco loua le canard de Bérénice et son âne « aux longs yeux résignés ». Mais quel qu’un ramena la gravité en murmurant les premières inflexions de l’inoubliable récit : « Je t’ai dit que ma famille est Arménienne, du nom d’Aravian… » Pour moi, j’avais rappelé, sans broncher, comme je la sais depuis le jour qu’elle me bouleversa, écolier, en m’ouvrant des mondes, la phrase qui scandalisait l’excellent M. Gidel : « Aujourd’hui, j’habite un rêve fait d’élégance morale et de clairvoyance : la vulgarité même ne m’atteint pas, car assis au fond de mon palais lucide je couvre le scandaleux murmure qui monte des autres vers moi par des airs variés que mon âme me fournît à volonté. »
C’est Dorgelès, vous l’avez remarqué, qui ne disait rien. Mais en partant, il me prit par le bras :
— « S’il y a dans le roman contemporain une page à laquelle il faille s’arrêter, n’est-ce pas, dans les Déracinés, celle qui est intitulée la mystérieuse soirée de Billancourt ? Vous rappelez-vous ? Astiné est entre les deux misérables qui vont la tuer, seule avec eux sur la berge.
— « Elle se taisait… Comme toute l’eau du fleuve était ridée par le même souffle, ainsi leurs trois cœurs étaient contractés par le même sentiment. »
— Vous rappelez-vous la poursuite, les yeux de Racadot « dans un visage que la peur faisait implacable », le marteau levé, et ce petit cou que Mouchefrin avait enfin le bonheur de toucher ? J’admire là et dans tout le livre la même force descriptive que chez les naturalistes, et quelque chose de plus, qui peut-être est tout…
Un jeune barrésien va me reprocher, et à mes amis, d’avoir oublié dans nos citations, tous les derniers livres de Barrès. Ces Chroniques de la grande guerre où la postérité prendra quelques-uns de ses chefs-d’œuvre lyriques ; ces merveilleux récits de la Revue hebdomadaire, où il a voulu fixer « non les rêveries, mais les demi-solidités (selon ses termes) de cinquante ans de poésie » ; enfin ce Jardin sur l’Oronte, où la plus voluptueuse des fables, le plus musical et le plus vaporeux des chants, porte une leçon de sagesse, la même leçon que Barrès a toujours donnée.
C’est, pour dire vite, la soumission de l’homme aux lois de la réalité, et quand il les méconnaît, l’homme a droit encore, s’il est trop tard, aux chants de 1a pitié, aux gémissements de la symphonie : s’il est encore temps, si l’homme peut encore être sauvé, il a droit aux conseils, même durs…

Eh ! bien, que le jeune barrésien se rassure, je ne suis pas de ceux qui établissent dans l’œuvre de Barrès on ne sait quelle fantastique démarcation. Après comme pendant la guerre, je n’ai pas cessé de sentir ce prestige d’un grand style dont l’harmonie, si fort qu’elle puisse faire penser à Chateaubriand, résulte moins du mécanisme de la phrase, de son balancement, que d’éléments poétiques ayant leur source dans l’esprit. La seule différence que l’on puisse sen tir est un apport : une puissante sérénité, par quoi son pathétique est plus souvent, ou avec plus d’aisance, mêlé de familier. Le passage de l’un à l’autre ton est empreint aujourd’hui de cette indulgence philosophique, disons de ce sourire de la bonté qui convient à la maturité comme l’impertinence à la jeunesse. On voit bien que je fais allusion aux divines pages de la Sibylle d’Auxerre, du Signe de l’Esprit, du Testament d’Eugène Delacroix, des Turquoises gravées…
Et je n’ai rapporté les phases de ce fameux déjeuner, je n’ai multiplié les citations que pour montrer au nouveau lecteur du Jardin sur l’Oronte, la continuité du charme barrésien, le même, il y à quinze ou vingt ans qu’aujourd’hui et si fort chez ceux qui l’ont éprouvé qu’ils traiteraient en étranger quiconque, y demeurerait monstrueusement insensible.
Nous lui savons gré, en même temps qu’il nous montrait les duretés du monde, de nous avoir plaints et choyés… Il ne nous morigénait pas en censeur, il se faisait notre ami, notre complice. Quand il commença d’écrire, tous les adolescents de France étaient jetés en pâture à d’artificieuses lois. Tout leur mentait. Ils n’avaient de recours que dans une stérile rébellion. Barrès est celui qui a rendu féconde cette révolte même. On dressait vainement l’individu contre la société, et dans ses chaires officielles, cette dernière enseignait avec une infatigable « stupidité » la même insubordination qu’elle ne manquait pas de châtier lorsqu’elle passait des paroles à l’acte. Cette dupe, cet « individu,» tour à tour excité et réprimé, il est constant qu’il n’a reçu d’aucun romantique plus de marques d’attention, de sympathique et même de complaisance que de Barrès. Et, dans cette action individualiste, pleine de toutes les grâces, l’insolence comprise, il trouva déjà, grâce à la magie de son art, des admirateurs, il faut dire des amis, qui ne l’ont pas tous suivi plus loin, mais qui n’ont pas oublié ni le secours qu’ils reçurent de lui, ni les plaisirs qu’il leur donna. Un Francis Carco à seize ans, quand il se crut seul au monde, comme il arrive aux adolescents (et surtout après le romantisme), il avait le sentiment que Maurice Barrès, son aîné à peine, le venait prendre par la main.

Mais cet « individu » que Barrès exaltait en lui-même, il l’examinait en psychologue. Il se connut Lorrain, il se connut Français, il se vit ou relié à une famille, à un foyer, à un clocher, à une terre, à une patrie, à une société, ou condamné à périr désarmé, et d’ailleurs absurde, inexplicable. Trouvant chez Comte la magnifique relation des vivants aux morts, il nous mena jusqu’à ce point où Maurras nous prit, heureux de le rencontrer.
Barrès m’apparaît donc comme un conciliateur. De l’individu et de la société, ayant ôté au premier son humeur ombrageuse, la folie du soupçon. De la petite patrie, qu’il a caressée, nettoyée de la poussière des archives, et de la grande, dont il est le serviteur exemplaire, l’une des vivantes gloires. De la France et de tout ce qu’il peut y avoir d’humain dans le monde. Des forces sourdes répandues dans les fibres des hommes, dans les veines de la terre, dans les espaces du ciel, et des puissances qui acceptent le regard de la conscience. Même, lorsqu’il use d’un vocabulaire différent de celui qui est couramment employé à cette place, il a la volonté de réduire les antinomies. On sent que je pense à cette sempiternelle (mais légitime) querelle du classicisme et du romantisme, de la raison et de la sensibilité, où certains des textes qu’il a produits ont été utilisés trop souvent sans pénétration ou sans bonne foi. Car il a dit : « l’intelligence, quelle petite chose à la surface de nous-mêmes. » C’est vrai, et même ce fut un cri du cœur. Mais il reste à le comprendre, et il écrivait, il n’y a pas un an : « Rien ne remplacera le travail intellectuel du poète ».
Nul ne trouvera, je pense que je force la pensée de Barrès en disant qu’il confirme ainsi 1’essentiel de l’art poétique qui est ici défendu…
Garçon de vingt ans, mon camarade qui, demain, enfermé dans ta chambre, vas découvrir Barrès, que j’envierais ton plaisir, si je ne l’éprouvais encore à chacun de ses nouveaux ouvrages, avec celui qu’apporte la mémoire des années !
Eugène Marsan
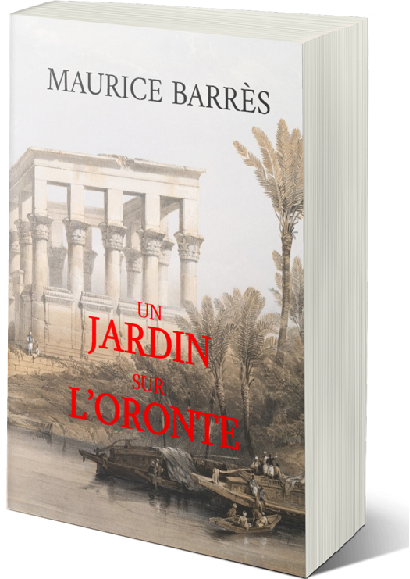
Nombre de pages : 108.
Prix (frais de port inclus) : 20 €.
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : B2M – Belle-de-Mai Éditions : commande.b2m_edition@laposte.net ■











