
1771 : Renvoi des Parlements

Un Lit de Justice tenu par Louis XV au parlement de Paris
« Y a-t-il un seul souverain ? Ou la France est-elle soumise à douze aristocraties ? » (Maupeou).
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1771, Louis XV et Maupeou (ci dessous) cassent les Parlements, et leurs membres sont exilés. Chaque parlementaire reçoit par huissier copie de l’arrêté du Conseil du roi confisquant les charges et interdisant aux magistrats de rendre des arrêts, sous peine de faux.
Maupeou forme un nouveau Parlement avec les magistrats qui approuvent sa politique, supprime la vénalité des offices et introduit l’égalité de tous les sujets devant la justice.
Les parlementaires avaient contre eux une bonne partie des « philosophes », Voltaire en tête, qui écrivait à d’Alembert : « Quoi les boeufs-tigres pleurent ? On ne rend plus la justice ? Les plaideurs sont réduits à s’accommoder sans frais…»
La « destruction » des Parlements, qui bloquaient toute réforme, par égoïsme corporatiste et en fonction de la préservation de leurs seuls intérêts et privilèges, était le début, et la condition sine qua non, de la Révolution royale ; celle qui aurait apporté au pays les réformes nécessaires, et donc empêché la funeste Révolution idéologique.
Celle-ci se produira malheureusement moins de vingt ans plus tard : le jeune Louis XVI (20 ans) commettra l’erreur – et la folie… – , à son avènement, en mai 1774, de restaurer les magistrats dans l’intégralité de leurs charges !…
Fatale décision : « On peut sans exagération dire que la Révolution date de 1774 », écrit l’historien Jean Tulard.
 Amer, et surtout lucide, Maupeou déclara : « … Le roi ne peut avoir d’autre reproche à me faire que mon trop de zèle pour le maintien de son autorité. Je lui avais fait gagner un procès qui durait depuis trois cents ans. Il veut le reprendre; il en est le maître.»
Amer, et surtout lucide, Maupeou déclara : « … Le roi ne peut avoir d’autre reproche à me faire que mon trop de zèle pour le maintien de son autorité. Je lui avais fait gagner un procès qui durait depuis trois cents ans. Il veut le reprendre; il en est le maître.»
Certains contemporains affirment l’avoir entendu dire, en aparté, « …il est perdu.» (éphéméride du 12 novembre)
De Jacques Bainville, Histoire de France, chapitre XIV, La Régence et Louis XV :
« …Choiseul avait essayé de gouverner avec les Parlements en leur donnant les jésuites en pâture, en flattant leurs sentiments jansénistes, en tirant même de leur sein des ministres et des contrôleurs généraux. L’effet de cette politique était déjà usé. Il ne restait plus qu’à recourir aux grands moyens. En 1771, Maupeou, chargé de l’opération, supprima les Parlements et la cour des aides.
À leur place furent institués des « conseils supérieurs ». La vénalité des charges était abolie, la justice devenait gratuite. C’était une des réformes les plus désirées par le pays. La suppression des Parlements, acte d’une politique hardie, permettait de continuer cette organisation rationnelle de la France qui, depuis des siècles, avait été entreprise par la monarchie. La voie était libre.
 Ce que Bonaparte, devenu Premier Consul, accomplira trente ans plus tard, pouvait être exécuté sans les ruines d’une révolution. De 1771 à 1774, l’administration de Terray (image), injustement décriée par l’histoire, mieux jugée de nos jours, commença de corriger les abus. Elle adoucit d’abord, avec l’intention de les abolir ensuite, les impositions les plus vexatoires; elle organisa ces fameux vingtièmes qui avaient soulevé tant de résistances; elle s’occupa enfin de créer des taxes équitables, telle que la contribution mobilière, reprise plus tard par l’Assemblée constituante, en un mot tout ce qui était rendu impossible par les Parlements.
Ce que Bonaparte, devenu Premier Consul, accomplira trente ans plus tard, pouvait être exécuté sans les ruines d’une révolution. De 1771 à 1774, l’administration de Terray (image), injustement décriée par l’histoire, mieux jugée de nos jours, commença de corriger les abus. Elle adoucit d’abord, avec l’intention de les abolir ensuite, les impositions les plus vexatoires; elle organisa ces fameux vingtièmes qui avaient soulevé tant de résistances; elle s’occupa enfin de créer des taxes équitables, telle que la contribution mobilière, reprise plus tard par l’Assemblée constituante, en un mot tout ce qui était rendu impossible par les Parlements.
Si nous pouvions faire l’économie d’une révolution, ce n’était pas en 1789, c’était en 1774, à la mort de Louis XV. La grande réforme administrative qui s’annonçait alors, sans secousses, sans violence, par l’autorité royale, c’était celle que les assemblées révolutionnaires ébaucheraient mais qui périrait dans l’anarchie, celle que Napoléon reprendrait et qui réussirait par la dictature : un de ses collaborateurs, le consul Lebrun, sera un ancien secrétaire de Maupeou. Il y a là dans notre histoire une autre sorte de continuité qui a été mal aperçue.
Nous allons voir comment ces promesses furent anéanties dès le début du règne de Louis XVI par le rappel des Parlements. Alors seulement la révolution deviendra inévitable… »
1839 : Naissance de Paul Cézanne

http://www.impressionniste.net/cezanne.htm
1840 : Découverte de la Terre-Adélie

Parti le 1er janvier d’Hobart en Tasmanie à la tête d’une expédition composée de deux corvettes, L’Astrolabe et La Zélée, Jules Dumont d’Urville découvre une grande étendue terrestre au milieu des icebergs de l’Antarctique. Il la baptise Terre Adélie, du nom de son épouse.
Le 21, il prend possession de cette nouvelle terre au no
m du roi de France, Louis-Philippe. Il y débarque le 26 :
D’une superficie de 432.000 kilomètres carrés, la Terre Adélie constitue avec les îles sub-antarctiques Kerguelen, Crozet et Amsterdam, les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
Contrairement aux îles, situées dans la partie sud de l’Océan Indien, la Terre Adélie, elle, se trouve sur le continent Antarctique, dont elle représente environ 3% de la superficie.
Dans notre album L’aventure France racontée par les cartes, voir la photo « Dumont dUrville découvre la Terre Adélie »
1865 : Mort de Proudhon
Pierre-Joseph Proudhon ne cesse d’intéresser la réflexion contemporaine. Le mouvement socialiste français et européen eût sans-doute été très différent si les idées de ce penseur considérable y avaient prévalu sur celles de Marx. L’histoire du XXème siècle, probablement sauvée des totalitarismes, et la réalité du nôtre auraient été aussi tout autres. On sait qu’il y eut, autour des années 1910 et suivantes, un cercle Proudhon à l’Action française; et l’on va voir que Maurras ne niait pas qu’on pût le ranger, « au sens large », parmi « les maîtres de la contre-révolution ». Le texte qu’on va lire ici est certes daté, motivé, comme souvent, par les circonstances. Maurras y exprime néanmoins, à grands traits, le fond de sa pensée sur Proudhon et y manifeste, après réserves et nuances, la considération tout à fait particulière qu’il a toujours eue pour ce grand penseur et patriote français…
De Charles Maurras (Paru dans les Cahiers du Cercle Proudhon, n° 1 de janvier 1912 – le texte date de 1910) :
 « …Au lendemain du jour où l’Italie fête le centenaire de Cavour, nous verrons une chose horrible : le monument Proudhon, à Besançon, sera inauguré par M. Fallières (ci dessous)*. Le fonctionnaire qui représente l’Étranger de l’intérieur, la créature des Reinach, Dreyfus et Rothschild officiera devant l’image du puissant écrivain révolutionnaire, mais français, à qui nous devons ce cri de douleur, qu’il jette à propos de Rousseau : « Notre patrie qui ne souffrit jamais que de l’influence des étrangers… »
« …Au lendemain du jour où l’Italie fête le centenaire de Cavour, nous verrons une chose horrible : le monument Proudhon, à Besançon, sera inauguré par M. Fallières (ci dessous)*. Le fonctionnaire qui représente l’Étranger de l’intérieur, la créature des Reinach, Dreyfus et Rothschild officiera devant l’image du puissant écrivain révolutionnaire, mais français, à qui nous devons ce cri de douleur, qu’il jette à propos de Rousseau : « Notre patrie qui ne souffrit jamais que de l’influence des étrangers… »
 Les idées de Proudhon ne sont pas nos idées, elles n’ont même pas toujours été les siennes propres. Elles se sont battues en lui et se sont si souvent entre-détruites que son esprit en est défini comme le rendez-vous des contradictoires. Ayant beaucoup compris, ce grand discuteur n’a pas tout su remettre en ordre. Il est difficile d’accorder avec cet esprit religieux, qu’il eut vif et profond, sa formule « Dieu, c’est le mal », et, dans une intéressante étude du Correspondant, M. Eugène Tavernier nous le montre fort en peine d’expliquer son fameux « La propriété, c’est le vol ». Nous remercions Proudhon des lumières qu’il nous donna sur la démocratie et sur les démocrates, sur le libéralisme et sur les libéraux, mais c’est au sens large que notre ami Louis Dimier, dans un très beau livre, l’a pu nommer « Maître de la contre-révolution ».
Les idées de Proudhon ne sont pas nos idées, elles n’ont même pas toujours été les siennes propres. Elles se sont battues en lui et se sont si souvent entre-détruites que son esprit en est défini comme le rendez-vous des contradictoires. Ayant beaucoup compris, ce grand discuteur n’a pas tout su remettre en ordre. Il est difficile d’accorder avec cet esprit religieux, qu’il eut vif et profond, sa formule « Dieu, c’est le mal », et, dans une intéressante étude du Correspondant, M. Eugène Tavernier nous le montre fort en peine d’expliquer son fameux « La propriété, c’est le vol ». Nous remercions Proudhon des lumières qu’il nous donna sur la démocratie et sur les démocrates, sur le libéralisme et sur les libéraux, mais c’est au sens large que notre ami Louis Dimier, dans un très beau livre, l’a pu nommer « Maître de la contre-révolution ».
Proudhon ne se rallie pas à la « réaction » avec la vigueur d’un Balzac ou d’un Veuillot. Il n’a point les goûts d’ordre qui dominent à son insu un Sainte-Beuve. Ses raisons ne se présentent pas dans le magnifique appareil militaire, sacerdotal ou doctoral qui distingue les exposés de Maistre, Bonald, Comte et Fustel de Coulanges. La netteté oblige à sacrifier. Or, il veut tout dire, tout garder, sans pouvoir tout distribuer; cette âpre volonté devait être vaincue, mais sa défaite inévitable est disputée d’un bras nerveux. On lit Proudhon comme on suit une tragédie; à chaque ligne, on se demande si ce rustre héroïque ne soumettra pas le dieu Pan.
Son chaos ne saurait faire loi parmi nous, et nous nous bornerions à l’utiliser par lambeaux si ce vaillant Français des Marches de Bourgogne ne nous revenait tout entier dès que, au lieu de nous en tenir à ce qu’il enseigne, nous considérons ce qu’il est. De cœur, de chair, de sang, de goût, Proudhon est débordant de naturel français, et la qualité nationale de son être entier s’est parfaitement exprimée dans ce sentiment, qu’il a eu si fort, de notre intérêt national. Patriote, au sens où l’entendirent les hommes de 1840, 1850, 1860, je ne sais si Proudhon le fut. Mais il était nationaliste comme un Français de 1910. Abstraction faite de ses idées, Proudhon eut l’instinct de la politique française; l’information encyclopédique de cet autodidacte l’avait abondamment pourvu des moyens de défendre tout ce qu’il sentait là-dessus.
 Et, là-dessus, Proudhon est si près de nous que, en tête de son écrasant réquisitoire contre les hommes de la Révolution et de l’Empire, à la première page de Bismarck et la France **, Jacques Bainville (ci contre) a pu inscrire cette dédicace : « À la mémoire de P.-J. Proudhon qui, dans sa pleine liberté d’esprit, retrouva la politique des rois de France et combattit le principe des nationalités; à la glorieuse mémoire des zouaves pontificaux qui sont tombés sur les champs de bataille en défendant la cause française contre l’unité italienne à Rome, contre l’Allemagne à Patay. »
Et, là-dessus, Proudhon est si près de nous que, en tête de son écrasant réquisitoire contre les hommes de la Révolution et de l’Empire, à la première page de Bismarck et la France **, Jacques Bainville (ci contre) a pu inscrire cette dédicace : « À la mémoire de P.-J. Proudhon qui, dans sa pleine liberté d’esprit, retrouva la politique des rois de France et combattit le principe des nationalités; à la glorieuse mémoire des zouaves pontificaux qui sont tombés sur les champs de bataille en défendant la cause française contre l’unité italienne à Rome, contre l’Allemagne à Patay. »
— Quoi ? Proudhon avec les zouaves pontificaux ?
— Oui, et rien ne va mieux ensemble ! Oui, Proudhon défendit le Pape; oui, il combattit le Piémont. Au nez des « quatre ou cinq cent mille badauds » qui lisaient les journaux libéraux, il s’écriait, le 7 septembre 1862 : « Si la France, la première puissance militaire de l’Europe, la plus favorisée par sa position, inquiète ses voisins par le progrès de ses armes et l’influence de sa politique, pourquoi leur ferais-je un crime de chercher à l’amoindrir et à l’entourer d’un cercle de fer ? Ce que je ne comprends pas, c’est l’attitude de la presse française dominée par ses sympathies italiennes. Il est manifeste que la constitution de l’Italie en puissance militaire, avec une armée de 300 000 hommes, amoindrit l’Empire de toutes façons. » L’Empire, c’est ici l’Empire français, dont je vois le timbre quatre fois répété sur mon édition princeps de La Fédération et l’Unité en Italie.
« L’Italie », poursuivait Proudhon, votre Italie unie, « va nous tirer aux jambes et nous pousser la baïonnette dans le ventre, le seul côté par lequel nous soyons à l’abri. La coalition contre la France a désormais un membre de plus… » Notre influence en sera diminuée d’autant ; elle diminuera encore « de tout l’avantage que nous assurait le titre de première puissance catholique, protectrice du Saint Siège ».
« Protestants et anglicans le comprennent et s’en réjouissent; ce n’est pas pour la gloire d’une thèse de théologie qu’ils combattent le pouvoir temporel et demandent l’évacuation de Rome par la France ! » Conclusion : « Le résultat de l’unité italienne est clair pour nous, c’est que la France ayant perdu la prépondérance que lui assurait sa force militaire, sacrifiant encore l’autorité de sa foi sans la remplacer par celle des idées, la France est une nation qui abdique, elle est finie. »
 Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n’a pas encore cessé de l’être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l’Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon (ci contre), et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu’à celui du Grand Maître des Francs-Maçons », et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l’unité allemande, ni de l’unité italienne; je ne veux d’aucun pontificat. »
Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n’a pas encore cessé de l’être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l’Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon (ci contre), et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu’à celui du Grand Maître des Francs-Maçons », et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l’unité allemande, ni de l’unité italienne; je ne veux d’aucun pontificat. »
Deux ans après avoir écrit ces lignes, Proudhon expirait; assez tôt pour ne pas assister à des vérifications qui devaient faire couler à flots notre sang, mutiler notre territoire, inaugurer le demi-siècle de l’abaissement national ! Cet « immense échec » qu’il avait prévu sans parvenir à comprendre, comme il le disait encore, « l’adhésion donnée par la presse libérale française à cette irréparable dégradation », confirma point par point ce regard d’une sublime lucidité. L’unité italienne et l’unité allemande nous ont fait perdre tout à tour la prépondérance qu’assurait notre force militaire et l’autorité qu’imposait notre foi. Le cléricalisme a été vaincu, le pape dépouillé, et l’on nous a imposé ce gouvernement dont la seule idée stable est l’abaissement du Saint-Siège, le règne de la franc-maçonnerie et de ses grands maîtres divers. Si l’Empereur a disparu, sa politique dure ; la parti républicain en a été quarante ans légitime et fidèle héritier.
Certes, et nous l’avons dit, avec Dumont, avec Georges Malet, avec le Junius de L’Écho de Paris, aux avocats de l’empereur : rien n’efface cette responsabilité napoléonienne que Napoléon III lui-même rattache à la tradition de Napoléon 1er; mais la vérité fondamentale établie, il faut en établir une autre et rappeler aux hommes de gauche, que leurs aînés, leurs pères, leurs maîtres et, pour les plus âgés, eux-mêmes, en 1860, ils étaient tout aussi Italiens et Prussiens que Napoléon III ! Sauf Thiers, en qui s’était réveillé l’ancien ministre de la monarchie, l’élève de Talleyrand, qui fut l’élève de Choiseul, tous les républicains et tous les libéraux du dix-neuvième siècle ont été contre le Pape et contre la France avec l’Empereur des Français. Il faut relire dans Bismarck et la France ces textes décisifs auxquels nous ramène Bainville; le ministre Ollivier développant à la tribune la thèse idéaliste des nationalités et M. Thiers, traditionnel pour la circonstance, s’écriant : « Nous sommes ici tantôt Italiens, tantôt Allemands, nous ne sommes jamais Français », toute la gauche applaudissait qui ? Émile Ollivier ! Guéroult défendait l’unité allemande, Jules Favre, un des futurs fondateurs de la République, déclarait le 4 juillet 1868 que nous n’avions « aucun intérêt à ce que les rivalités se continuent entre les deux parties de l’Allemagne » !
 Telle était la tradition révolutionnaire impériale ou républicaine et Proudhon s’y étant opposé presque seul, la présence de M. Fallières au monument de Proudhon est plus qu’un scandale, c’est un contresens. Je partage sur la personne de M. Fallières le sentiment de Léon Daudet (ci contre) l’appelant le plus lâche et le plus méprisable des ruminants; et l’appréciation de Jacques Delebecque, telle qu’on la lira plus loin sur l’harmonie de cet animal et de la fonction constitutionnelle, me semble l’expression de la vérité pure. Mais le nom de Proudhon met en cause plus que la personne ou la magistrature de M. Fallières; le nom de Proudhon met en accusation le régime avec son revêtement de blagologie nuageuse, avec son fond de sale envie et de bas appétits. Ce grand nom de Proudhon frappe d’indignité et Fallières, et sa présidence et la démocratie parce qu’il évoque le grand nom de la France et l’étoile obscurcie de notre destin national. Ce régime ne signifie que le pontificat de la maçonnerie que Proudhon avait en horreur. Il ne figure rien que les hommes et les idées que Proudhon combattait en France, en Europe, partout. Proudhon était fédéraliste; que lui veut cette république centralisatrice ? Il était syndicaliste; que lui veut cette république étatiste ? Il était nationaliste et papalin ; que lui veut cette république anticatholique, antifrançaise ?
Telle était la tradition révolutionnaire impériale ou républicaine et Proudhon s’y étant opposé presque seul, la présence de M. Fallières au monument de Proudhon est plus qu’un scandale, c’est un contresens. Je partage sur la personne de M. Fallières le sentiment de Léon Daudet (ci contre) l’appelant le plus lâche et le plus méprisable des ruminants; et l’appréciation de Jacques Delebecque, telle qu’on la lira plus loin sur l’harmonie de cet animal et de la fonction constitutionnelle, me semble l’expression de la vérité pure. Mais le nom de Proudhon met en cause plus que la personne ou la magistrature de M. Fallières; le nom de Proudhon met en accusation le régime avec son revêtement de blagologie nuageuse, avec son fond de sale envie et de bas appétits. Ce grand nom de Proudhon frappe d’indignité et Fallières, et sa présidence et la démocratie parce qu’il évoque le grand nom de la France et l’étoile obscurcie de notre destin national. Ce régime ne signifie que le pontificat de la maçonnerie que Proudhon avait en horreur. Il ne figure rien que les hommes et les idées que Proudhon combattait en France, en Europe, partout. Proudhon était fédéraliste; que lui veut cette république centralisatrice ? Il était syndicaliste; que lui veut cette république étatiste ? Il était nationaliste et papalin ; que lui veut cette république anticatholique, antifrançaise ?
Je ne sais quelles bouffonneries l’on débitera à la louange de ce grand écrivain sorti, comme Veuillot et tant d’autres, des entrailles du peuple ; mais les lettrés devront répondre à la venue de M. Fallières par la dérision et le peuple par les huées. »
 * Les 13, 14 et 15 août 1910, à Besançon, est inaugurée une statue en bronze de Pierre-Joseph Proudhon, réalisée par le sculpteur bisontin Georges Laethier.
* Les 13, 14 et 15 août 1910, à Besançon, est inaugurée une statue en bronze de Pierre-Joseph Proudhon, réalisée par le sculpteur bisontin Georges Laethier.
La décision d’ériger cette statue dans sa ville natale a été prise un an auparavant à l’occasion du centenaire de sa naissance et a donné lieu à une souscription et a un concours de sculpteurs. La statue n’existe plus, fondue (comme de nombreuses autres) par les nazis durant l’Occupation. Elle a été remplacée par la suite.
**1907
Thibault Isabel a consacré un excellent ouvrage à Proudhon, L’anarchie sans le désordre
1915 : Le Néon traverse l’Atlantique
Georges Claude dépose un brevet aux Etats-Unis pour son invention du tube à néon, qu’il avait présenté à Paris lors l’exposition universelle de 1910.
Il avait réalisé la première enseigne lumineuse publicitaire, en 1912, pour un barbier.
Sur ce très grand savant que fut Georges Claude, grand ami de l’Action française, voir les éphémérides des 23 mai (jour de sa mort), 24 septembre (jour de sa naissance); et 3 décembre (présentation de son invention du Néon).
2001 : Mort de Gustave Thibon
Retrouvez deux des Discours de Gustave Thibon aux Rassemblements Royalistes des Baux, qui constituent deux de nos Grands Textes :
• Le suprême risque et la suprême chance.
• La paille des mots remplace le grain des choses.
• Et, surtout, ce pur joyau que constitue l’exceptionnel échange du Dîner-débat de Benoist/Thibon organisé par l’Union Royaliste Provençale le 15 avril 1982 à Marseille.
A nous, qui sommes les héritiers de Charles Maurras, et qui voulons continuer le combat dont il fut l’initiateur , Gustave Thibon a laissé ce sage conseil, cette ligne de conduite à tenir, toujours :
« Vous êtes, vous et vos amis, les héritiers spirituels de Charles Maurras.
Mais vous savez bien qu’un héritage n’est pas un talisman ni une baguette magique : c’est un outil. Et un outil qu’il faut savoir manier et adapter en fonction du mouvement de la vie qui ramène toujours le semblable, jamais l’identique.
Épouser la pensée d’un maître, cela veut dire s’unir à elle pour lui faire des enfants et non pas la stériliser sous prétexte de lui conserver je ne sais quelle intégrité virginale.
Il n’y a pire trahison qu’une certaine fidélité matérielle et littérale qui, en durcissant les principes en système, n’aboutit qu’à congeler ce qui était le jaillissement d’une source vive. Les exercices de patinage qu’on peut faire sur cette glace ne m’intéressent pas. La vraie fidélité est celle qui prolonge, qui corrige et qui dépasse. Et le meilleur héritier n’est pas celui qui fait de son héritage un musée ou une exposition rétrospective.
« Le bien gagné reste à défendre » : le capital de la sagesse que Maurras vous a légué, vous ne le conserverez qu’en le fécondant, en le récréant sans cesse ».
http://www.gilles-jobin.org/citations/?au=290
• « Il est malaisé de composer avec le monde sans se laisser décomposer par le monde. » (L’Ignorance étoilée)
• « La société devient enfer dès qu’on veut en faire un paradis. »

Cette éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

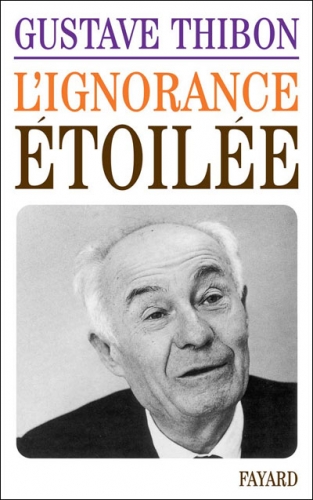
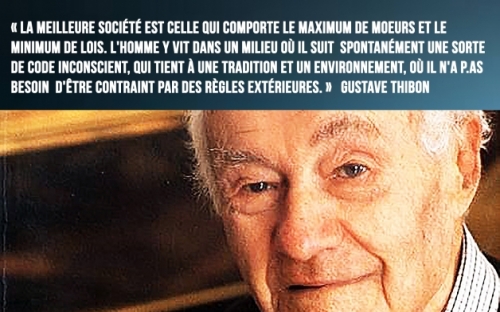











Merci de ce rappel du décès de Gustave THIBON .
Je l’avez vu deux fois aux Baux, à des conférences,et une fois croisé près de sa ferme, à St Marcel d’Ardèche.
Sa tombe au cimetière du village est d’une
simplicité émouvante !
Homme exemplaire,qui mériterait un hommage national de la France.
Un grand spirituel,qui était proche d’une célèbre abbaye provençale.
Admirateur aussi de Frédéric MISTRAL ,il
parlait la langue de ses ancêtres,et faisait comme ce dernier ,des Baux ,la capitale idéale
de la Provence ! ( « Di Bau fariéu ma capitale »).
Une phrase que j’ai noté hier de sa part,toute simple de sagesse , nous dit:
« La société devient un enfer dès qu’on veut en faire un paradis ».
Gustave THIBON est un penseur de portée
universelle.
19 janvier une date à retenir !
. En juin 1941, le père Perrin écrit à Gustave Thibon pour lui demander d’accueillir Simone Weil dans sa ferme en Ardèche : « Elle est exclue de l’université par les nouvelles lois et désirerait travailler quelque temps à la campagne comme fille de ferme ». Après un premier mouvement de refus, Gustave Thibon accepte finalement ; elle est embauchée comme ouvrière agricole et mène une vie volontairement privée de tout confort durant plusieurs semaines, jeûnant et renonçant à la moitié de ses tickets d’alimentation au profit des résistants42. Durant ce séjour à la ferme et jusqu’en 1942, elle fait une lecture intégrale du Nouveau Testament, s’attachant tout particulièrement à l’Hymne sur l’Abaissement du Christ dans l’Épître aux Philippiens43 de Paul de Tarse44 ; la découverte de la prière du Notre Père l’amène à en rédiger un commentaire spirituel et métaphysique45, où s’exprime aussi sa conception des relations de l’homme au temps. wikipedia