
Des « Grands Textes » pour toujours rester en lien avec nos fondamentaux
![]() Pierre Boutang reprend ici – pour la France de 1952, mais tout autant pour la nôtre – le dilemme mis en lumière dans L’Avenir de l’Intelligence publié par Maurras en 1905. « Cet immense petit livre », comme le nomme le grand philosophe Pierre Boutang.
Pierre Boutang reprend ici – pour la France de 1952, mais tout autant pour la nôtre – le dilemme mis en lumière dans L’Avenir de l’Intelligence publié par Maurras en 1905. « Cet immense petit livre », comme le nomme le grand philosophe Pierre Boutang.
Maurras y oppose – à la manière des mythes et des tragédies de la Grèce antique – deux puissances ou personnages allégoriques, et néanmoins réels, perpétuellement en lutte dans l’Histoire, pour le Pouvoir : l’Or, c’est-à-dire les puissances d’Argent ; et le Sang, c’est-à-dire l’ensemble des forces de la Tradition. On verra, en lisant Boutang – et L’avenir de l’intelligence – comment elles s’identifient.
La Révolution, résume Maurras, « nous a fait passer de l’autorité des Princes de notre sang » sous celle « des marchands d’or ». Ces derniers règnent maintenant presque sans partage. Ce sont eux les Princes du monde et nous vivons aujourd’hui cet âge de fer dont Maurras avait prévu l’avènement.
Cela durera-t-il toujours ? La victoire de l’Or sur le Sang est-elle définitive ? C’est, évidemment, une possibilité, et les apparences, aujourd’hui, semblent plaider en faveur de cette hypothèse.
« À moins que… », dit Maurras, dans la conclusion de son livre. À moins d’un retournement de l’Intelligence et d’une renaissance du patriotisme français. C’est à quoi appelle Maurras dont la démarche est hautement stratégique. Tout simplement, il invite l’Intelligence à rejoindre le camp de la Contre-Révolution.
Disciple et continuateur de Maurras, Boutang poursuit ici cette réflexion : les Soviets ont disparu, l’utopie messianique marxiste a échoué ; certains événements, certains personnages dont il est fait mention dans ce texte appartiennent au passé. L’essentiel, la question centrale, demeure : Qui sera le Prince de ce temps ? Elle est au cœur de notre présent. ![]()
 Paru dans Aspects de la France les 21, 28 novembre, et 12 décembre 1952 [Extrait]
Paru dans Aspects de la France les 21, 28 novembre, et 12 décembre 1952 [Extrait]
Qui sera le Prince ? Telle est l’unique question du vingtième siècle méritant l’examen, capable de mobiliser les volontés. La fraude démocratique consiste à lui substituer celle de la société, la meilleure possible, et le débat sur son contenu spirituel et moral. Quelle est l’organisation la plus juste, la plus humaine, et d’abord quelle est la meilleure organisation du débat sur cette organisation ? Voilà le chant des sirènes des démocrates.
Fiez-vous y ! Le vent et les voleurs viendront.
Les voleurs et le vent sont à l’œuvre. La diversion est plus que bonne : très sûre. Pendant ces beaux débats, toutes fenêtres ouvertes, le vent apporte sa pestilence. Et sous le masque de l’opinion reine, de la liberté de jugement des Lazurick ou des Lazareff, l’or triomphe ; il détient tout le réel pouvoir dont la presse a mission et fonction cher payée, de cacher la nature et de divertir dans le peuple la nostalgie croissante et le désir évident.
Qui sera le Prince ? Il s’agit de l’avenir : il n’est pas de principat clandestin, de royauté honteuse de soi-même et qui puisse durer. Une société sans pouvoir qui dise son nom et son être, anarchique et secrètement despotique, sera détruite avant que notre génération ait passé. Pour le pire ou pour le meilleur elle disparaîtra. A la lumière très brutale et très franche de la question du Principat, de la primauté politique, les sales toiles des araignées démocratiques, les systèmes réformistes, les blagues juridiques, les ouvrages patients des technocrates européens ; seront nettoyés sans recours. Par quelles mains ? C’est le problème… Qui tiendra le balai purificateur ? Non pas quel individu, pauvre ou riche, de petite ou très noble extrace, mais quel type d’homme ? Incarnant quelle idée ? Réalisant quel type de la Force immortelle, mais combien diverse et étrangère par soi-même au bien et au mal ?
L’heure nouvelle est au moins très sévère, a dit le poète. Cette sévérité, aujourd’hui, tient à ce fait : nul ne croit plus à la meilleure structure sociale possible, la plus humaine et la plus juste. Tous voient qu’elle ne profite, cette question toujours remise sur le métier de l’examen, sans personne pour la tisser, qu’aux coquins et aux domestiques de l’argent. Les fédéralistes eux-mêmes, armateurs de débats sur les pactes volontaires, reconnaissent que la question du fédérateur est primordiale ; mais les uns tiennent que ce fédérateur doit être un sentiment, la peur panique inspirée par les soviets, les autres avec M. Duverger dont les articles du Monde viennent d’avouer la honteuse vérité, que l’or américain, l’aide en dollars, est le seul authentique fédérateur de l’Europe….
Positivement, les malheurs du temps ont fait gagner au moins ceci à l’intelligence mondiale, et la vague conscience des peuples : à l’ancienne utopie succède l’inquiétude, la question chargée de curiosité et d’angoisse – qui, quelle force, quelle espèce de volonté humaine, va garantir ou réaliser un ordre politique et social, juste ou injuste, mais qui sera d’abord le sien ? Nos contemporains savent ou sentent qu’il n’y a pas de justice sociale sans société ni de société sans une primauté reconnue, établie en droit et en fait. La réelle nature de la force publique, du Prince qui garde la cité et y exerce le pouvoir, importe plus aux hommes qui ont été dupes si longtemps, que le jeu de patience et d’impatience des réformes sociales ; ces réformes sont innombrables dans le possible, imprévisibles dans leurs conséquences ; ce qui compte, ce qui est digne de retenir l’attention ou d’appeler l’espérance, réside dans la loi vivante de leur choix, dans la réalité organique, dans la volonté responsable qui les ordonne et les préfère.
 Reconnaître l’importance capitale de la question du Prince, considérer les autres problèmes politiques comme des fadaises ou des diversions vilainement intéressées, tel est le premier acte d’une intelligence honnête de notre temps. Car cette question du prince est toujours essentielle, et toujours oubliée : mais elle était jadis oubliée parce qu’elle était résolue, et les utopies elles-mêmes s’appuyaient sur la réalité incontestée d’un pouvoir légitime. Depuis le dix-huitième siècle la puissance de l’or, clandestine, masquée par les fausses souverainetés du nombre et de l’opinion n’a pas comblé dans les esprits, les cœurs, les besoins, le vide laissé par la démission des Princes. Les balançoires, les escarpolettes constitutionnelles, dont les brevets continuent en 1952 d’être pris à Londres (ou dans les « démocraties royales » rétrogrades) ne satisfont pas, avec leurs recherches d’équilibre, le goût profond que gardent les peuples pour la stabilité et la connaissance des vraies forces qui soutiennent un gouvernement. L’homme du vingtième siècle n’a pas envie de se balancer à l’escarpolette démocratique et parlementaire : les expériences faites en Europe centrale lui montrent quel est l’usage probable des cordes libérales dont se soutenaient ces jolis objets et jouets des jardins d’Occident. Elles portent bonheur aux pendus…
Reconnaître l’importance capitale de la question du Prince, considérer les autres problèmes politiques comme des fadaises ou des diversions vilainement intéressées, tel est le premier acte d’une intelligence honnête de notre temps. Car cette question du prince est toujours essentielle, et toujours oubliée : mais elle était jadis oubliée parce qu’elle était résolue, et les utopies elles-mêmes s’appuyaient sur la réalité incontestée d’un pouvoir légitime. Depuis le dix-huitième siècle la puissance de l’or, clandestine, masquée par les fausses souverainetés du nombre et de l’opinion n’a pas comblé dans les esprits, les cœurs, les besoins, le vide laissé par la démission des Princes. Les balançoires, les escarpolettes constitutionnelles, dont les brevets continuent en 1952 d’être pris à Londres (ou dans les « démocraties royales » rétrogrades) ne satisfont pas, avec leurs recherches d’équilibre, le goût profond que gardent les peuples pour la stabilité et la connaissance des vraies forces qui soutiennent un gouvernement. L’homme du vingtième siècle n’a pas envie de se balancer à l’escarpolette démocratique et parlementaire : les expériences faites en Europe centrale lui montrent quel est l’usage probable des cordes libérales dont se soutenaient ces jolis objets et jouets des jardins d’Occident. Elles portent bonheur aux pendus…
Quand on voit, quand on sait l’enjeu de cette guerre engagée sous nos yeux pour le Principat, l’inventaire des forces, des réalités naturelles et historiques, capables de répondre à la commune angoisse, s’impose rapidement. L’intellectuel, l’écrivain, disposent de l’outil du langage, dont la fonction est de distinguer des provinces de l’être. Ils font donc leur métier, lorsqu’ils dénombrent les prétendants au Principat. Ils peuvent faire leur salut temporel, en choisissant, en aidant, la force naturelle qui leur apparaît salutaire et légitime.
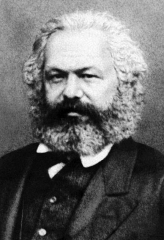 La recherche de l’intelligence, dans ce domaine, est libre entre toutes. Elle ne doit de comptes qu’à la vérité, et lorsqu’elle se soumet à ses lois supérieures, à la patrie. Sa liberté propre se moque du libéralisme doctrinaire. Que ses lois propres, et sa soumission la conduisent à vouloir le Principat du Prolétaire, ou celui du Sang dans l’ordre dynastique, son choix ne dépendra pas, par exemple, du retard que tel prolétaire ou tel groupe prolétarien peuvent avoir, dans leur opinion subjective, sur la réalité et la force que le Prolétaire incarne pour un monde nouveau. Les difficultés qui naissent de ces retards, de ces rétrogradations, ne sont pas inconnues des marxistes. Il eût été bien étrange qu’elles fussent épargnées au nationalisme. Leur caractère de phénomène aberrant et transitoire laisse intacte la vraie question : quelle force réelle, capable d’extension, douée d’un sens universel, assumera le Pouvoir que l’on occupe clandestinement, mais n’incarne ni n’accomplit ? Est-ce que ce sera le Prolétaire selon Marx, ou le Sang, le principe dynastique, selon Maurras ? Le reste est futilité, opportunisme naïf que l’histoire balaiera sans égards.
La recherche de l’intelligence, dans ce domaine, est libre entre toutes. Elle ne doit de comptes qu’à la vérité, et lorsqu’elle se soumet à ses lois supérieures, à la patrie. Sa liberté propre se moque du libéralisme doctrinaire. Que ses lois propres, et sa soumission la conduisent à vouloir le Principat du Prolétaire, ou celui du Sang dans l’ordre dynastique, son choix ne dépendra pas, par exemple, du retard que tel prolétaire ou tel groupe prolétarien peuvent avoir, dans leur opinion subjective, sur la réalité et la force que le Prolétaire incarne pour un monde nouveau. Les difficultés qui naissent de ces retards, de ces rétrogradations, ne sont pas inconnues des marxistes. Il eût été bien étrange qu’elles fussent épargnées au nationalisme. Leur caractère de phénomène aberrant et transitoire laisse intacte la vraie question : quelle force réelle, capable d’extension, douée d’un sens universel, assumera le Pouvoir que l’on occupe clandestinement, mais n’incarne ni n’accomplit ? Est-ce que ce sera le Prolétaire selon Marx, ou le Sang, le principe dynastique, selon Maurras ? Le reste est futilité, opportunisme naïf que l’histoire balaiera sans égards.
Non point selon l’ordre national, mais selon l’apparence, un premier Prince apparaît, prétendant du moins au Principat : le journal, le pouvoir de l’opinion. Prétention qui n’est monstrueuse que si l’on néglige les causes et les effets : si le peuple, si le nombre ou la masse – quelles que soient les définitions matérielles que l’on donne de ce Protée – était décrété souverain, l’évidence de son incapacité, de ses faibles lumières, de son enfance, selon le dogme du progrès, imposaient la régence pratique du pédagogue. Ce pédagogue du peuple souverain devait éclairer et former la volonté générale : l’extension rapide du pouvoir de lire rendait incertaine l’action des clubs et des assemblées : la presse seule pouvait se glisser partout en renseigner l’enfant Démos aux mille têtes folles, les mettre à l’abri de la séduction des anciennes autorités, de la mainmise de l’Eglise, de la séduction des Princes ou des généraux.
Le combat du XIXème siècle pour la liberté de la presse apparaît ainsi comme le plus noble, le plus raisonnable qui pût être conduit, avec les prémisses de la démocratie. Des milliers d’hommes sont morts pour que nous ayons le droit d’accomplir, comme l’a dit Péguy, cette formalité truquée du suffrage universel. Mais la mort de millions n’eût pas été insensée pour que les conditions intellectuelles de cette formalité, la liberté de la presse, seule capable de vaincre le truquage, fût réalisée. Marx avait raison dans sa logique de démocrate radical, qui allait le conduire très loin du libéralisme formel : « La presse est la manière la plus générale dont les individus disposent pour communiquer leur existence spirituelle » (Gazette rhénane, 1842). Or, cette communication est le devoir démocratique majeur, où tout esprit doit enseigner sans cesse le peuple, innombrable héritier du Pouvoir, ayant une charge aussi certaine que celle dont Louis XIV accable un Bossuet. Il n’y a donc pas de limite démocratique à la liberté de la Presse, ce pédagogue des nations, mais dont la mission ne peut finir qu’avec la parfaite majorité de Démos.
La difficulté commence (et commença !) avec la définition de l’enseignement ainsi donné : le pédagogue se révèle innombrable, indéfini, comme l’élève. A la limite théorique, Démos qui sait ou peut écrire enseigne Démos qui sait et peut lire. Les deux données quasi matérielles et de hasard, écrire et lire, se substituent au choix humain du précepteur, et à la présence naturelle de l’élève royal.
En fait, par la simple existence d’un commerce de la librairie, une merveilleuse possibilité s’ouvrait ainsi aux forces secrètes qui disposeraient de l’or. Vainement, Marx s’écriait-il, dans la même Gazette de Francfort, à l’occasion des extraordinaires débats de la Diète rhénane qui devaient jouer un rôle décisif dans la formation de son mythe révolutionnaire « la première liberté consiste pour la presse à n’être pas une industrie ! » La presse était une industrie, ou le devenait à toute vitesse.
Si l’or ne renonçait pas, avec les organes de corruption des partis et les truquages électoraux, à gouverner directement le peuple et lui imposer des représentants, du moins les Pourrisseurs les plus scientifiques s’aperçurent très vite de l’existence d’un moyen économique et supérieur : il suffisait de tenir « le quatrième pouvoir » inconnu de Montesquieu, et d’agir sur le pédagogue de Démos. La divisibilité infinie de l’or, sa séduction aux mille formes s’adaptaient naturellement au maître divers, au pédagogue polycéphale…. On pouvait y aller. On y alla !
Le pédagogue de Démos ne pouvait prétendre, au départ, à un enseignement si bien assimilé par son élève que le choix des meilleurs en résultât, automatiquement, à l’heure des votes. Était-il écouté, suivi ? Les gouvernements considéraient qu’ils avaient, eux, atteint leur majorité en obtenant la majorité ; ils s’émancipaient ; ils agissaient à leur tour, par des lois ou par des fonds secrets, sur la presse écœurée de cette ingratitude. Mais il y avait une ressource : c’était la fameuse opposition. L’opposition au parlement pouvait être méconnue ; elle se composait en somme de vaincus. S’appuyait-elle sur une presse vivace, expression du citoyen contre le Pouvoir du moment, éducatrice de son successeur inévitable, alors les chances de la liberté étaient maintenues, on était encore en république !
Hélas ! La presse d’opposition, précisément parce qu’elle pouvait influer sur la décision prochaine de Démos, tant qu’elle acceptait le système et ses profits glorieux, tenait à l’or autant que l’autre. Du moins sauvait-elle les apparences.
Il fallut attendre une déclaration vraiment décisive de l’éditorialiste du quotidien Figaro, feuille conformiste à l’immense tirage, pour que cette dernière décence, cette ultime réserve et pudeur de la putain Démocratie fût gaillardement sacrifiée. Nous commentons dans la Politique de cette semaine ce texte monumental (auro, non aere, perennius !) dû à l’ingéniosité perverse de Mauriac. Citons-le ici pour mémoire :
« Je sais, on reproche souvent au Figaro d’être toujours du côté du gouvernement. Dans une démocratie, je prétends qu’un grand journal ne peut être un journal d’opposition. Un journal comme Figaro, en raison même de son audience ne peut fronder. Il a des responsabilités sur le plan patriotique. J’admire les gens qui peuvent trancher de tous les problèmes dont ils ignorent les difficultés. Or, le nom du président du Conseil peut changer, les difficultés restent les mêmes au gouvernement. »
L’abdication définitive et publique du quatrième pouvoir en démocratie entraîne la ruine de la démocratie elle-même. Le pédagogue de Démos abdique avec son élève devant l’idole d’un gouvernement qui a toujours raison, infaillible et sans principe, girouette prise pour gouvernail du monde, vaine paille au vent de l’histoire consacrée comme grain des choses et substance de la Société….
La voie est libre alors pour notre dénombrement des forces qui aspirent à la primauté du Prince.
Qui sera le Prince ? L’or, la puissance financière toute pure et impure ? La technique et ses terribles dévots ? Le Prolétaire dans la dictature révolutionnaire ? Ou le Sang, la force dynastique tels que les définit le merveilleux petit livre de 1905 : « La force lumineuse et la chaleur vivante, celle qui se montre et se nomme, celle qui dure et se transmet, celle qui connaît ses actes, qui les signe, qui en répond. » ■

La Famille Royale de France.
« …Ou le Sang, la force dynastique tels que les définit le merveilleux petit livre de 1905 : » La force lumineuse et la chaleur vivante, celle qui se montre et se nomme, celle qui dure et se transmet, celle qui connaît ses actes, qui les signe, qui en répond. »
Dernière parution le 09.06.2023












Je me trompe peut être mais il y a pour moi une différence fondamentale entre Maurras et Boutang.
Maurras , athée, fuit la métaphysique qui débouche immanquablement comme toute la philosophie qu’il a abandonnée, sur l’existence ou non de Dieu.
Disciple d’Auguste Comte, il est ennemi de « l’impressionisme exalté » de Pascal qu’il abhorre. Pour lui, disciple de l’harmonie grecque, toute politique repose sur « l’empirisme organisateur », la raison, l’harmonie et cela s’applique à tous les pays. Il est, pour la France, adepte du » nationalisme intégral et donc de la Monarchie, car c’esr le meilleur régime spécifique de notre pays en raison de son passé , de sa culture, de ses moeurs et donc sa perennité.
Boutang au contraire, baigne dans la métaphysique. C’est un feu d’artifices de digressions, retours, mélanges qu’on retrouve dans son cursus acrobatique pour se démarquer d’un anti sémitisme » maurrassien » qui est en réalité un anti cosmopolitisme. Finalement, Boutang c’est la confusion qui peut séduire mais dont il ne restera rien, alors que Maurras, à l’égal d’Aristote, ne passera pas. Il finit par lasser.
J’ajoute que Zemmour me parait avoir mieux compris Maurras que Boutang, en tous cas, d’après ses propos radiophoniques.
que vient faire le malheureux ZEMMOUR au milieu de ces grandes figures que BOUTANG et MAURRAS?!
cela montre la décadence de la pensée actuelle!
Maurras pose les prémisses de la discussion, Boutang reprend brillamment l’analyse, mais nous demande de prendre une décision, à ce titre il est métaphysique, il nous fait sortir du bois . « Il faut « aimer la vie, elle est belle » dit Aliocha, c’est aussi l’ amour de la vie de chez Boutang, qui prime, ici transposé à la vie politique, cet amour qui supérieur notre conception, aussi s argumentée , soit-elle Boutang fait le saut métaphysique salvateur, et nous met tous, royalistes ou non, devant nos responsabilités dans ce monde, et c’est tant mieux .