
Par Pierre Builly.
La colline des hommes perdus de Sidney Lumet (1965).
Un coup de poing dans la figure.
Introduction : Durant la Deuxième guerre mondiale, un camp disciplinaire situé en Libye et dirigé par le sergent-major Wilson accueille cinq nouveaux prisonniers. Le terrible sergent Williams est nommé par Wilson pour en faire de « vrais soldats ».
Aux Jeux Olympiques de Rome, en 1960, l’extraordinaire Australien Herbert Elliott remportait avec une large vingtaine de mètres d’avance sur notre Michel Jazy un des plus beaux 1500 mètres de l’histoire athlétique. Déjà recordman du monde, il était loin d’être un inconnu et les méthodes d’entraînement de son mentor, qui s’appelait Percy Cerutty, suscitaient surprise et admiration : Cerutty faisait en effet grimper à Elliott, chargé de sacs lourds, des dunes de sable escarpées ; lorsqu’il courrait sur la piste, l’effort lui semblait alors évidemment plus aisé.
 J’ai songé à cela en revoyant les premières images de La colline des hommes perdus. Sont-ce les méthodes de punition britanniques qui ont inspiré Cerruty, ou les méthodes d’entraînement de Cerruty qui, alors assez largement mises en valeur, ont donné l’idée à Sydney Lumet de créer l’emblématique bloc de torture qui donne son nom au film ? Je me le demande un peu.
J’ai songé à cela en revoyant les premières images de La colline des hommes perdus. Sont-ce les méthodes de punition britanniques qui ont inspiré Cerruty, ou les méthodes d’entraînement de Cerruty qui, alors assez largement mises en valeur, ont donné l’idée à Sydney Lumet de créer l’emblématique bloc de torture qui donne son nom au film ? Je me le demande un peu.
Mais le film, bien sûr, est d’une autre portée que ne l’aurait une sorte de Koh Lanta sadique et il n’est pas un de ces documentaires périodiquement exposés à la télévision sur les épreuves subies par les jeunes gens candidats à l’entrée dans les troupes d’élite, Commandos, GIGN, Raid, Légion étrangère (ou par les Marines de Full metal jacket).
 Disons d’abord l’extrême qualité de la réalisation de Sydney Lumet : noir et blanc éclatant, c’est vrai, mais aussi choix des angles et orientations du filmage : toute la grammaire cinématographique y passe : plongées et contre-plongées, gros plans et panoramiques, mais aussi, et de façon obsédante, à presque tout instant, exception faite des huis clos, les courses en oblique des prisonniers autres que les protagonistes, courses qui contribuent à donner au Camp de répression l’image d’une sorte de fourmilière obsédante, un peu conforme à l’Enfer tel qu’on peut se l’imaginer : à tout moment, courant coudes au corps, montant, descendant des escaliers, faisant des mouvements de gymnastique ou exerçant d’absurdes garde à vous ! repos !, il y a de pauvres insectes effarés dont la désorientation est encore accrue par la plate laideur du désert de Libye.
Disons d’abord l’extrême qualité de la réalisation de Sydney Lumet : noir et blanc éclatant, c’est vrai, mais aussi choix des angles et orientations du filmage : toute la grammaire cinématographique y passe : plongées et contre-plongées, gros plans et panoramiques, mais aussi, et de façon obsédante, à presque tout instant, exception faite des huis clos, les courses en oblique des prisonniers autres que les protagonistes, courses qui contribuent à donner au Camp de répression l’image d’une sorte de fourmilière obsédante, un peu conforme à l’Enfer tel qu’on peut se l’imaginer : à tout moment, courant coudes au corps, montant, descendant des escaliers, faisant des mouvements de gymnastique ou exerçant d’absurdes garde à vous ! repos !, il y a de pauvres insectes effarés dont la désorientation est encore accrue par la plate laideur du désert de Libye.
 Distribution éclatante aussi ; on sait bien que Sean Connery dès l’immense succès de Dr No a essayé de ne pas se laisser enfermer dans la peau d’un personnage dont la récurrence aurait stérilisé un talent qui n’avait pas été vraiment reconnu. La légende 007 a beaucoup perdu à cette décision, aucune des autres incarnations de Bond n’ayant jamais fait le poids, mais le cinéma a gagné un grand acteur. Et je crois que La colline des hommes perdus est son premier grand rôle.
Distribution éclatante aussi ; on sait bien que Sean Connery dès l’immense succès de Dr No a essayé de ne pas se laisser enfermer dans la peau d’un personnage dont la récurrence aurait stérilisé un talent qui n’avait pas été vraiment reconnu. La légende 007 a beaucoup perdu à cette décision, aucune des autres incarnations de Bond n’ayant jamais fait le poids, mais le cinéma a gagné un grand acteur. Et je crois que La colline des hommes perdus est son premier grand rôle.
 Mais les autres acteurs sont aussi formidables, en premier lieu les brutes galonnées, l’adjudant-chef Bert Wilson (Harry Andrews) et l’immonde salopard sadique sergent Williams (Ian Hendry), mais aussi le sergent Charlie Harris (Ian Bannen), qui essaye de faire ce qu’il peut pour sortir les prisonniers de leur carcan, les hiérarques dépassés par les événements, le Commandant (Norman Bird) et le médecin-capitaine (Michael Redgrave) et les compagnons de cellule de Joe Roberts (Sean Connery), bien typés et bien décrits.
Mais les autres acteurs sont aussi formidables, en premier lieu les brutes galonnées, l’adjudant-chef Bert Wilson (Harry Andrews) et l’immonde salopard sadique sergent Williams (Ian Hendry), mais aussi le sergent Charlie Harris (Ian Bannen), qui essaye de faire ce qu’il peut pour sortir les prisonniers de leur carcan, les hiérarques dépassés par les événements, le Commandant (Norman Bird) et le médecin-capitaine (Michael Redgrave) et les compagnons de cellule de Joe Roberts (Sean Connery), bien typés et bien décrits.
 Sidney Lumet, que je ne connais pas beaucoup, à part l’intéressant Une après-midi de chien passe pour un cinéaste de gauche et il est certain qu’il ne fait pas dans la nuance ; les raisons qui amènent les cinq prisonniers à être affectés dans un camp de prisonniers aussi dur paraissent dérisoires (bagarre, vol de bouteilles de whisky) et les plus graves inculpations (désertion pour le pauvre Stevens (Alfred Lynch), refus de conduire ses hommes au front pour Roberts/Connery) sont presque justifiées, alors que, tout de même, c’est la Guerre.
Sidney Lumet, que je ne connais pas beaucoup, à part l’intéressant Une après-midi de chien passe pour un cinéaste de gauche et il est certain qu’il ne fait pas dans la nuance ; les raisons qui amènent les cinq prisonniers à être affectés dans un camp de prisonniers aussi dur paraissent dérisoires (bagarre, vol de bouteilles de whisky) et les plus graves inculpations (désertion pour le pauvre Stevens (Alfred Lynch), refus de conduire ses hommes au front pour Roberts/Connery) sont presque justifiées, alors que, tout de même, c’est la Guerre.
Cela dit, la pensée de Lumet est tout de même exempte de l’antimilitarisme primaire qu’on pourrait craindre ; Roberts, lors d’une conversation avec ses camarades de cellule, le dit sans ambages : Sans obéissance, il n’y a plus d’Armée et il n’est pas très fier d’avouer que s’il a lui-même échappé au massacre à quoi il refusait d’envoyer ses hommes, en se battant avec un officier, ces mêmes hommes qu’il voulait protéger sont tous morts puisque, lui désormais dégradé et prisonnier, on les a tous fait monter au front dont ils ne sont pas revenus.
 Et puis une des grandes qualités du film, c’est aussi la complexité des rapports entre les salauds : l’adjudant-chef Wilson est d’une violence et d’une dureté incroyables, c’est vrai : mais il possède aussi du courage physique et une sorte de charisme d’autorité glaçant qui lui permet de briser à moindres frais la rébellion des prisonniers ; le sergent Williams, à son rebours, est un pur sadique, dont on devine la lâcheté et la veulerie : Si les vidangeurs portaient un uniforme, tu t’engagerais ! lui lance Roberts qui a complétement compris son ressort de vie et ne l’en méprise que davantage.
Et puis une des grandes qualités du film, c’est aussi la complexité des rapports entre les salauds : l’adjudant-chef Wilson est d’une violence et d’une dureté incroyables, c’est vrai : mais il possède aussi du courage physique et une sorte de charisme d’autorité glaçant qui lui permet de briser à moindres frais la rébellion des prisonniers ; le sergent Williams, à son rebours, est un pur sadique, dont on devine la lâcheté et la veulerie : Si les vidangeurs portaient un uniforme, tu t’engagerais ! lui lance Roberts qui a complétement compris son ressort de vie et ne l’en méprise que davantage.
Enfin, l’unhappy end final, la catastrophe, le désastre à quoi on assiste accablé… Vraiment un très très grand film… ■
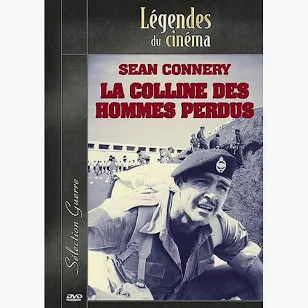
DVD autour de 25€.
Chroniques hebdomadaires en principe publiées le dimanche.













Toujours excellent Pierre Builly. Merci.