
COMMENTAIRE – Cet entretien, réalisé par Alexandre Devecchio, a été publié le 7 novembre dans Le Figaro. Nous devons y être attentifs. On le verra : sur bien des sujets, avec son vocabulaire et ses techniques d’analyse propres, Christophe Guilluy va au fond des choses. Certes, il s’agit surtout ici des causes et conséquences supposées de l’élection américaine, mais au-delà, il s’agit des sociétés occidentales, françaises en particulier. Les questions économiques — délocalisations, désindustrialisation, travail, libre-échangisme, globalisation — sont la trame dominante de cet entretien. En arrière-plan, sans que ce soit un signe de moindre importance, apparaissent tous les domaines de la « dépossession » dont nous sommes collectivement victimes, en France pour ce qui nous concerne, ailleurs pour tous les peuples issus de la vieille Europe. Délocalisés, en un sens, au profond d’eux-mêmes, comme en Amérique leur révolte monte. ![]()
GRAND ENTRETIEN – L’auteur* des Dépossédés et de La France périphérique analyse en exclusivité pour Le Figaro les résultats des élections américaines et y voit l’expression d’un phénomène qui traverse toutes les démocraties occidentales : le réveil des classes populaires et moyennes.
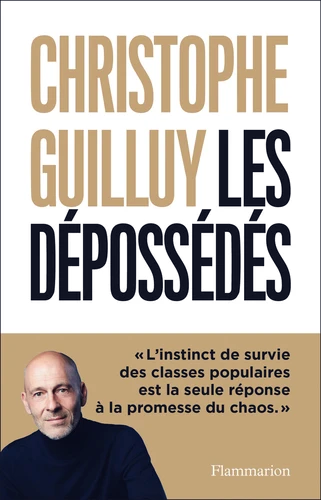 « Après un demi-siècle de désindustrialisation, les classes populaires sont définitivement sorties du clivage gauche-droite. Elles se déterminent sur des thématiques comme le travail, la sécurité, la régulation des flux migratoires ou la protection sociale. »
« Après un demi-siècle de désindustrialisation, les classes populaires sont définitivement sorties du clivage gauche-droite. Elles se déterminent sur des thématiques comme le travail, la sécurité, la régulation des flux migratoires ou la protection sociale. »
LE FIGARO. – La victoire de Donald Trump doit-elle être vue comme le résultat de l’autonomisation des classes populaires que vous décrivez de livre en livre depuis une décennie ?
Christophe GUILLUY. – L’autonomie culturelle des classes populaires et moyennes est la grande affaire de notre temps ! Elle est le facteur explicatif de toutes les dynamiques politiques contemporaines et aussi, bien sûr, de l’incompréhension qu’elles suscitent aux États-Unis comme en Europe de l’Ouest. Cette autonomie culturelle est le fruit inattendu de la sécession des élites, elle est aussi une réaction à trente ans d’invisibilisation et surtout d’ostracisation. Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire récente, l’opinion de la majorité ordinaire n’est plus façonnée ni par les médias ni par la sphère politique traditionnelle. Les gens n’écoutent plus les débats télévisés, ni les intellectuels, ni la presse.
Ils ont élaboré un diagnostic forgé dans le temps long de leur situation sociale et économique. Ce diagnostic est commun à l’ensemble des catégories moyennes et populaires qui vivent à l’écart des grandes villes et qui se sentent dépossédées de ce qu’elles ont et de ce qu’elles sont. À bas bruit, ces catégories ont initié une contestation qui ne ressemble à aucun des mouvements sociaux des siècles passés. Ses ressorts profonds, et c’est bien là sa spécificité, ne sont pas seulement matériels, mais surtout existentiels. C’est pourquoi ce mouvement est inarrêtable. Il resurgit toujours. Il ne dépend donc d’aucun parti, ni syndicat, ni même d’aucun leader : c’est la working class américaine qui fabrique Trump et non l’inverse !
C’est aussi la working class qui fait imploser l’idéologie du libre-échange dans l’establishment républicain et impose aux élites globalistes des mesures protectionnistes. Ce sont ces classes populaires et moyennes qui écrivent la feuille de route. Et aux États-Unis comme en Europe, cette feuille est identique : protéger les travailleurs, relancer l’économie, réindustrialiser, maîtriser les frontières et réguler les flux migratoires. Ainsi, contrairement à ce qu’on imagine, l’élection de Trump doit moins à son talent qu’à sa capacité à s’adapter à la demande d’une majorité ordinaire qui refuse d’être mise au bord du monde.
Encore une fois, Trump a été sous-estimé par les sondeurs et les médias. Cela révèle-t-il une cécité idéologique et intellectuelle ?
La majorité qui a porté Trump au pouvoir est cette majorité ordinaire qui, pour beaucoup de décideurs, n’existe plus ou ne doit plus exister. Surnuméraires pour les élites économiques reaganiennes des années 1980 qui avaient choisi la globalisation, la financiarisation de l’économie et donc la désindustrialisation, les classes populaires étaient aussi de trop pour les élites démocrates. Ces dernières – qui portaient la révolution sociétale qui devait accompagner le changement de modèle économique – avaient, elles aussi, besoin d’invisibiliser une working class de moins en moins fidèle électoralement, mais surtout trop attachée à ses valeurs traditionnelles (cette stratégie arrivera plus tard à gauche avec la note Terra Nova).
Ce sont ces classes populaires et moyennes qui écrivent la feuille de route. Et aux États-Unis comme en Europe, cette feuille est identique : protéger les travailleurs, relancer l’économie, réindustrialiser, maîtriser les frontières et réguler les flux migratoires
La fusion entre libéralisme économique et libéralisme culturel, qui était donc conditionnée par l’invisibilisation des classes populaires, trouva son apogée aux États-Unis comme en Europe – singulièrement en France et en Grande Bretagne – dans la métropolisation. Vitrines du libre-échange, du « no limit » économique et sociétal, les grandes métropoles produisirent ainsi très rapidement des bulles culturelles et idéologiques dans lesquelles était concentré l’essentiel des couches supérieures, de l’intelligentsia, des universitaires, bref des gens qui produiraient les représentations sur lesquelles le pouvoir allait justifier tous ses choix économiques.
Dans cette représentation, les métropoles deviennent l’horizon indépassable, les périphéries (l’Amérique du milieu, des petites villes, des villes moyennes et du rural) les marges d’une Amérique en voie de disparition. Depuis les années 1980, toutes les représentations géographiques et culturelles visent à invisibiliser ce monde finissant, celui d’une working class malade et vieillissante.
Dans la représentation globalisée, tertiairisée, métropolisée des prescripteurs d’opinions, la working class n’existe pas, pas plus que l’idée d’une majorité ordinaire. Prisonniers du bocal métropolitain, beaucoup de médias et de sondeurs ne perçoivent l’électorat de Trump qu’à travers le panel d’une working class blanche en voie de disparition. Avec leur vieux télescope, les clercs de Métropolia distinguent mal la planète Périphéria et encore moins les habitants qui y vivent. Ils n’ont donc pas pu voir la nouvelle vague trumpiste.
En imposant son modèle, celui de la globalisation, les États-Unis ont créé le poison qui les détruit : la désindustrialisation. Une désindustrialisation à l’origine du changement de standard de vie des classes populaires et moyennes jadis intégrées.
L’un des enseignements de cette campagne est-il que la diabolisation ne fonctionne plus, même au pays du politiquement correct ?
C’est moins la question du « politiquement correct » que celle de l’économie qui a joué. Et sur cette question Trump peut remercier Biden ! La diabolisation de Trump reposait sur l’idée qu’il était impossible de réguler, de relancer les investissements publics, de sortir du libre-échange et de fermer les frontières. Or, en adoptant une politique volontiers protectionniste, Biden s’est chargé de dédiaboliser son concurrent.
Le gouvernement démocrate a définitivement enterré la doxa du libre-échange : taxation des produits chinois, critique de la théorie du ruissellement des richesses à partir des métropoles et investissement public massif dans les infrastructures de l’Amérique périphérique. Prenant acte de la nécessité de relocaliser les industries, la secrétaire au Trésor Janet Yellen annonça même indirectement la mort de la mondialisation en parlant de « friend shoring », en français « amilocalisation » ; en d’autres termes, elle inventa l’oxymore d’une « mondialisation entre amis », c’est-à-dire de la fin de la globalisation.
Le gouvernement démocrate a définitivement enterré la doxa du libre-échange : taxation des produits chinois, critique de la théorie du ruissellement des richesses à partir des métropoles et investissement public massif dans les infrastructures de l’Amérique périphérique
De son côté, la vice-présidente, une certaine Kamala Harris promettait de renforcer la frontière sud ! L’ensemble du programme Trump était dédiabolisé. Les démocrates ont ainsi offert les clés de l’économie au candidat Trump, il ne leur restait en boutique qu’une offre sociétale complètement démonétisée dans laquelle le société ordinaire ne pouvait se reconnaître.
Le phénomène Trump est-il un phénomène typiquement américain ou est-ce la pointe avancée d’une recomposition plus globale ? Quels points communs et quelles différences entre la France et les États-Unis ?
En imposant leur modèle, celui de la globalisation, les États-Unis ont créé le poison qui les détruit : la désindustrialisation. Une désindustrialisation à l’origine du changement de standard de vie des classes populaires et moyennes jadis intégrées. En emboîtant le pas, les autres pays occidentaux, notamment la France, entameront leur descente aux enfers. Tous ces pays désindustrialisés et donc surendettés ont ainsi initié la fin de la spécificité de l’Occident : le standard de vie élevé de ses classes populaires et moyennes.
Seules les classes supérieures métropolitaines tirent encore leur épingle de ce jeu de massacre. C’est ce qui explique aux États-Unis comme en Europe de l’Ouest le développement d’un schisme culturel entre deux réalités socio-culturelles, deux expériences humaines, celle de Métropolia et celle de Périphéria. Aux États-Unis comme en France, les dynamiques sociales, culturelles et politiques se structurent à partir des mêmes sociologies et de la même géographie.
Si les différences entre les États-Unis et la France tendent à s’atténuer, c’est à l’intérieur que les fractures s’accroissent. Si l’habitus des métropolitains américains et français se distingue de moins en moins, la fracture entre les métropoles et les périphéries s’est transformée en schisme culturel.
L’un des faits marquants de cette élection est également le vote des minorités. La stratégie de clientélisme « racisé » et « genré » de Kamala Harris n’a pas fonctionné… A contrario, cela contredit l’idée que le vote Trump se réduirait à un vote de « petits Blancs en colère »…
Par sa critique du libre-échange Trump a fait sortir les républicains du modèle dépassé de la globalisation, porté par Reagan dans les années 1980. Parallèlement, il est frappant de constater que les démocrates, et au-delà la plupart des gauches européennes, restent enfermés dans une représentation culturelle très datée des classes populaires. La mise en avant de ce qu’on appelle pompeusement le wokisme révèle un assèchement de la pensée typique du bocal métropolitain. L’homogénéisation sociale et culturelle de ces lieux n’a abouti qu’à la production d’une rhétorique qui fleure bon les années 1980 et une représentation des classes populaires qui semble elle aussi figée au siècle passé.
Les démocrates n’ont pas compris que le bloc majoritaire, l’univers des dépossédés, est déjà multiethnique et multiconfessionnel ! Aux États-Unis comme en France, cet ensemble n’est pas un monde de « Blancs, hétéros, et homophobes ».
Les démocrates n’ont pas compris que le bloc majoritaire, l’univers des dépossédés, est déjà multiethnique et multiconfessionnel ! Aux États-Unis comme en France, cet ensemble n’est pas un monde de « Blancs, hétéros, et homophobes ». On y trouve évidemment des ultraconservateurs, mais ce monde a changé. Les classes populaires du XXIe siècle ne sont plus celles d’hier. Ce monde n’est pas clos, ni hermétique à la modernité. On peut y écouter de la country mais surtout du hip-hop.
On y trouve aussi des ménages éclatés, des femmes seules, des Noirs, des Latinos, des couples homos, etc. qui cherchent leur place dans un modèle économique et culturel qui les a relégués. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils n’ignorent rien de ce qui se passe dans leur pays et dans le monde. Les classes populaires, notamment celles qui sont issues de l’immigration, notamment les jeunes, estiment que la rhétorique « minoritaires » de la gauche est un enfermement. Les sondages sortis des urnes indiquent que près de la moitié des Latinos et une fraction importante des hommes noirs ont voté pour Trump.
Peut-on, malgré tout, parler d’un vote identitaire, mais dans le sens culturel et non ethnique du terme ?
Cette thématique « identitaire » qui renvoie au siècle dernier est un enfermement. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si elle est essentiellement portée par une partie de la gauche et une extrême droite résiduelle, des camps politiques désertés par l’électorat populaire. Le mouvement de contestation est existentiel c’est-à-dire qu’il fusionne une dimension sociale et culturelle.
Vous expliquez souvent que le clivage entre les « dépossédés » et les « élites » sera le clivage politique du XXIe siècle, le clivage droite-gauche dans son sens traditionnel est-il définitivement dépassé ?
Non, il n’y a aucune opposition de principe entre « élites et dépossédés ». Ma critique porte sur les élites contemporaines. Une société est cohérente quand elle fonctionne avec le haut qui « travaille » pour répondre aux demandes de la majorité ordinaire. Après un demi-siècle de désindustrialisation, les classes populaires sont définitivement sorties du clivage gauche-droite. Elles se déterminent sur des thématiques qui sont tout autant de « droite » que de « gauche » comme le travail, la sécurité, la régulation des flux migratoires ou la protection sociale. Surtout, elles ont fait litière des partis traditionnels qui ont contribué à leur dépossession.
Outre l’élection de Donald Trump, celle de JD Vance est-elle un symbole et un tournant ?
Parue en 2016, en pleine campagne de Donald Trump, son autobiographie Hillbilly Elegy offrait aux élites américaines une explication rassurante à la victoire du candidat républicain. Rassurante, car elle actait la fin d’une working class frappée par la désindustrialisation, amochée par le chômage et décimée par l’abus des médicaments opiacés. La fin de la working class s’inscrivait parfaitement dans le récit de la classe dominante et médiatique américaine.
Vance apportera même son soutien à Hillary Clinton en s’opposant à Donald Trump. Six ans plus tard, il opère un revirement radical et se rapproche de Trump en expliquant avoir été séduit par le programme de relocalisation industrielle. Inconsciemment, Vance par ses revirements et ce basculement politique illustre les revirements d’une working class qui cherche une issue. Portée par un instinct de survie, qui est celui de la société occidentale qui ne veut plus entendre parler d’élégie ! ■

Lire aussi dans JSF…
Christophe Guilluy : « Les Français ont le sentiment d’être embarqués dans un train dont les conducteurs ne savent pas où ils vont »












Plus généralement et sans ambages : nous assistons à, au moins, deux débâcles.
-la débâcle d’une « science » économique prétentieuse, infirme, arrogante, myope, intimidante, et culpabilisante. Sa tare originelle : l’ignorance de la nature humaine, de la vie elle-même, individuelle et collective. son mutisme coupable sur les vrais problèmes et choix vitaux (procréation, mariage, éducation, politique, morale, spiritualité, vieillesse, imperfections physiques et mentales, injustices, souffrance, divorce, suicide, guerre …) sa théorisation abstraite et étriquée des seuls commerce et industries. Vivement le retour à la modeste et humaine « économie politique » des fondateurs.
-la débâcle, parallèle, du système « médiatique ». Complice du précédent, il souffre des mêmes tares, y ajoutant abêtissement, manipulation, caporalisation, mensonge, starisation, simplification, saturation, mépris… Remettons le à sa place (le marché, le magasin, le café, la réclame (« advertisements », « commercials », en anglais)… et retrouvons, restaurons, le sens noble des idées que ce système (assez pertinemment brocardé « merdiatique ») a usurpées, dont il s’est scandaleusement paré : publicité, communication, culture, voire éducation, science et savoir. Qu’il ferme enfin sa gueule !