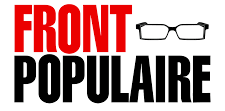« La France risque fort d’être isolée et de devenir la proie des États-Unis qui lorgnent sur ce qui lui reste d’industrie. La seule voie de sortie, mais qui exigerait un gouvernement doté d’une forte légitimité populaire, serait de simultanément relancer massivement notre industrie (mais pour cela il faudra prendre ses distances avec l’EU et l’euro) et rompre avec l’atlantisme rampant qui gangrène notre politique étrangère depuis l’élection de Nicolas Sarkozy pour chercher à occuper une position d’intermédiaire entre la puissance américaine et les BRICS, qui sont appelés à se constituer en une alliance du « Sud Global ».
ENTRETIEN. À l’évidence, l’élection de Donald Trump a secoué le jeu de quilles occidental et atlantiste. À quoi faut-il s’attendre ? Quelles peuvent être les conséquences, pour le monde et pour la France, des promesses et ambitions du nouveau président américain ? Analyse, données à l’appui, avec l’économiste Jacques Sapir.
 « Pour Donald Trump, l’Union européenne n’existe pas. »
« Pour Donald Trump, l’Union européenne n’existe pas. »
Front Populaire : Avec Donald Trump et ses premières politiques de tarification vis-à-vis du Canada ou du Mexique notamment, le concept de “guerre économique” a fait un retour en force dans le débat public. Mais est-ce vraiment une réalité nouvelle ?
Jacques Sapir : C’est le mot qui fait son retour (et encore…) dans le débat public, mais pas la notion. La guerre économique existe depuis des siècles. Que ce soit pour pénaliser un adversaire – que l’on soit en guerre contre lui ou non – ou que ce soit pour développer plus, et plus vite, son économie. Le « blocus continental » de Napoléon était de la guerre économique. Quand la Prusse, avec Bismarck, décide de hausser ses droits de douane pour protéger son industrie de la Grande-Bretagne, c’est de la guerre économique. Quand l’Union européenne tente d’imposer sa « charte de l’énergie » à la Russie au début des années 2000, qu’est-ce si ce n’est de la guerre économique ? Quand l’administration Obama décide de pénaliser des entreprises européennes parce qu’elles font du commerce avec Cuba et l’Iran, c’est encore de la guerre économique. Enfin, quand l’Allemagne soutient des groupes écologistes qui font campagne contre l’énergie nucléaire, dans l’espoir de priver la France de l’un de ses avantages compétitifs, c’est toujours de la guerre économique.
Donc arrêtons tout ce cirque autour des déclarations, et des actes, de Donald Trump. Nous vivons dans un monde où la guerre économique, entre États mais aussi entre firmes, est permanente. Il est vrai que nous avons refusé de voir cette réalité, que ce soit en France ou dans le discours de l’Union européenne. Nous avons tenu un discours sur le « doux commerce », discours qui relevait en fait de la guerre économique, mais nous y avons cru ! C’était idiot et cela le reste. Mais c’est comme si une secte se décidait de nier l’existence de la loi de la gravité. Ce serait idiot, cela ne changerait rien à la réalité, et cela n’empècherait pas les membres de cette secte de se prendre des pommes ou des pots de fleurs sur la tête !
FP : Dans quel état se trouve l’économie américaine ? Autrement dit : quel est dans les grandes lignes le bilan économique de Joe Biden ?
JS : L’économie américaine ne va pas bien, même si elle se porte un peu mieux que l’économie européenne, ou française. Mais, les problèmes de l’économie américaine ne datent pas de la présidence Biden. L’affaiblissement depuis une trentaine d’années est patent.
La part du PIB mondial calculé en parité de pouvoir d’achat des États-Unis est celle qui a le plus reculé dans le monde, comme le montre le graphique ci-dessous.
/frontpop/2025/02/image.png)
Les États-Unis, qui pesaient environ 21% du PIB mondial en 1999, sont tombés à 15%, tandis que la Chine, elle, passait de 4,4% en 1993 à 19,1% en 2024 et l’Inde dans le même temps passait de 3,3% à 8,2%. Calculés de manière plus conventionnelle, c’est-à-dire en PIB aux taux de change, les résultats seraient bien sûr différents. Mais, la parité de pouvoir d’achat est considérée comme plus efficace pour une comparaison internationale (1), même si cette méthode n’est pas dépourvue de biais potentiels. Elle est donc utilisée quand on veut comparer de manière robuste deux économies, et c’est pourquoi elle a été adoptée par diverses institutions, dont la Banque Mondiale ou le Fond Monétaire International.
Si les États-Unis ont reculé en termes relatifs dans leur part du PIB en PPA, leur économie s’est aussi transformée. La part des services dans leur économie atteignait 79,3% du PIB en moyenne de 2011 à 2019, ce qui est comparable à celle de la France (78,5%), mais avec une différence sensible quant à l’Allemagne (68,9%) et bien sûr la Chine (49%) (2). On comprend alors l’origine de deux des obsessions de Donald Trump : la question des relations avec la Chine et l’Allemagne mais aussi celle qui tourne autour de la réindustrialisation des États-Unis.
/frontpop/2025/02/image_1.png)
On constate, en effet, que si le PIB des USA s’est accru, la production industrielle manufacturière n’a pas bougé depuis 1999. Aujourd’hui, les services représentent près de 79% du PIB américaine (et 78% en France), alors qu’ils pèsent nettement moins dans l’économie allemande (69% en 2021) ou dans l’économie russe (64%). Ce que cela révèle, c’est le processus de désindustrialisation qui a frappé l’économie américaine (comme l’économie française) au cours de ces trente dernières années.
A cet égard, les différents présidents qui se sont succédés aux États-Unis depuis Bush Sr. ont peu fait pour inverser la tendance. Bill Clinton, dans son premier mandat, a peut-être été le seul à tenter quelque chose. Cette désindustrialisation, on la constate avec la crise récurrente de l’un des deux grands avionneurs américains : Boeing. Mais, quand on regarde plus précisément, on voit que la perte de compétence de la main d’œuvre touche aussi d’autres secteurs qui jouent un rôle critique dans la sécurité des États-Unis comme la construction navale (et les sous-marins atomiques), mais aussi dans l’industrie chimique.
/frontpop/2025/02/image_3.png)
Sur certaines des branches de l’industrie manufacturière, la production a décru depuis 1997 et 1999 alors qu’elle a fortement augmenté sur d’autres, comme les ordinateurs et les produits électroniques. Mais même sur cette branche, le retard pris par rapport à d’autres pays est patent. Le fait que les Chinois aient pu lancer sur le marché Deepseek, une IA grand public, pour une fraction seulement du coût des IA de Google et d’autres serveurs, est un exemple frappant de ce déclin.
Socialement, cette stagnation – voire ce déclin – de l’industrie manufacturière se traduit par des pertes d’emplois dans des secteurs qui étaient autrefois rémunérateurs. Le sentiment d’un déclassement d’une grande partie de la classe ouvrière américaine a beaucoup fait pour rendre les idées de Trump populaires. C’est cela qui, pour une large part, explique sa victoire en 2024 tout comme cela l’avait déjà expliqué en 2016.
Alors, si on compare l’état de l’économie américaine à celle de l’Union européenne, et des principaux pays en son sein, l’Allemagne, la France et l’Italie, il est incontestable qu’elle va mieux que ceux-ci, avec un taux de croissance très supérieur. Mais pour les Américains des classes moyennes et inférieures, confrontés à l’inflation et qui ne bénéficient pas de cette croissance car elle ne concerne qu’une partie de l’économie, cette comparaison n’a pas de sens. La montée du vote « Trump » dans une minorité comme celle des hispaniques où il y a beaucoup de petits entrepreneurs, et ce en dépit d’une réthorique de Donald Trump ciblant une immigration essentiellement hispanique, est un véritable révélateur de ce malaise économique.
FP : Le soutien aux cryptomonnaies est un des piliers de la politique économique de Trump. Comment interprétez-vous ce phénomène ?
JS : La position de Trump par rapport aux cryptommonaies est essentiellement idéologique. C’est le refus, ou en tout cas la réticence, d’une partie de la droite américaine à accepter l’idée d’une banque centrale fédérale (la Fed). C’est – de manière sous-jacente – la volonté de revenir à la situation du milieu du XIXème siècle avec la concurrence entre diverses monnaies (les dollars émis par différentes banques) aux Etats-Unis. Mais, comme toute idée réactionnaire (au sens d’un « retour en arrière »), elle ne peut que conduire à un échec.
FP : On a beaucoup parlé de “dédollarisation” à la faveur du sommet des BRICS de 2024. Donald Trump risque-t-il selon vous de changer la donne ?
JS : Les mesures que Donald Trump veut prendre vont, en réalité, accélérer la dédollarisation de l’économie mondiale. Le fait que l’Inde reconnaisse depuis le 26 janvier dernier les cartes de crédit du système « Mir » russe est un signe incontestable de cela.
Cette dédollarisation ne peut être inversée car les États-Unis ne sont plus le centre du monde. Si le dollar maintient un avantage, c’est essentiellement du fait des coûts de transaction qui existent dès que l’on en sort. Mais les mesures promises par Trump aux pays qui se « dédollariseraient » auront avant tout pour effet de faire monter l’incertitude concernant des règlements en dollars. Quand ces incertitudes, qui ne sont en réalité que des « coûts de transaction » cachés, deviendront aussi importantes que les coûts de transaction existants pour sortir du système dollar, le mouvement s’accélèrera de manière dramatique.
Si les pays des BRICS, que l’Indonésie vient d’ailleurs de rejoindre, arrivent à mettre sur pied un système stable et protégé contre les incertitudes et les pressions américaines, cela pourrait aussi accélérer le phénomène.
FP : Du Groenland à Panama, l’Amérique renoue avec la diplomatie de la canonnière, en tout cas sur son pré-carré géostratégique. Comment analysez-vous cette approche ?
JS : Il s’agit bien, comme vous le dites, d’un recentrage sur le « pré-carré ». Panama a été créé par les États-Unis, au détriment de la Colombie, il faut le rappeler. Les États-Unis sont militairement présents au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale, et cette présence s’était beaucoup développée avec la construction de la base de Thulé à la fin des années 1940, dans le contexte de la guerre froide.
La proposition d’intégrer le Canada suit une logique parallèle, car le Canada était intégré dans le NORAD, le système de défense de l’espace aérien de l’Amérique du Nord.
Qu’est-ce que cela révèle ? Que les États-Unis sont en train d’abandonner le monde pour se replier sur l’espace qu’ils dominent le plus directement. Ils veulent mettre la main sur les ressources minières du Groenland et du Canada parce qu’ils anticipent qu’ils pourraient être coupés des ressources du reste de la planète. Ils mettent clairement un poteau indicateur qui dit « l’Amérique du Nord » (qui va jusqu’à la frontière avec la Colombie) c’est notre espace. Mais, ce faisant, ils compromettent gravement leur capacité à peser sur le reste du monde. En fait, Donald Trump a très certainement compris l’importance géopolitique des BRICS et de leur expansion. Il a aussi compris qu’il ne pouvait, et dans le futur pourrait, pas s’y opposer. C’est mieux que ce que les dirigeants des pays européens ont été capable de faire… Mais il réagit à la manière d’une homme du XIXème siècle, et c’est là qu’il révèle le fond de son idéologie réactionnaire. En fait, il rève d’une « doctrine Monroe » 2.0.
/frontpop/2025/02/Monde%20de%20Trump.jpg)
Rappelons nous qu’avant la guerre de 1914 l’un des jeux stratégiques, et je parle ici des Kriegspiel auxquels se livre le Naval War College de Newport, dans le Rhode Island, auquel jouait la Marine américaine, c’était de savoir comment contrer l’irruption d’une marine européenne (britannique ou de manière plus réaliste allemande, avec le « plan noir ») dans les Caraïbes.
Donc Donald Trump estime donc que les États-Unis, repliés sur leur « pré-carré », agrandi au besoin (Groënland, Canada) disposeraient des ressources naturelles, et avec une relocalisation forcée, des capacités technologiques et industrielles, pour tenir face à une « alliance des suds » que constituent les BRICS. De fait, dans cette analyse, il suffit de « tenir » jusqu’à ce que cette « alliance des suds », que l’on suppose minée par des contradictions internes, explose et se déchire. Pour constituer ce « pré-carré » de manière cohérente, il faut forcer les industriels de l’électronique (et d’autres branches) à relocaliser, sinon cela n’aura aucun effet. C’est le sens des taxes qu’il veut imposer à Taïwan, grand producteur de microprocesseurs et pourtant allié très fidèle des États-Unis. À terme, il prépare un abandon de Taïwan. Un même processus pourrait toucher l’Europe, et en particulier l’Allemagne. Mais, cela va plus loin. Il veut constituer une alliance au Moyen-Orient, autour d’Israël et de l’Arabie Saoudite pour gérer cette région sans les États-Unis.
Il y a donc bien une cohérence dans la vision de Trump. Elle ne doit pas masquer ses contradictions internes, car d’autres visions de l’intérêt des États-Unis existent, y compris au sein des Républicains, et cette relocalisation qu’il veut imposer prendra du temps alors même que les manœuvres auxquelles il se livre pour constituer son « pré-carré » peuvet exacerber des oppositions et des conflits. Si l’on peut penser que cette théorie du « pré-carré » peut avoir une certaine validité dans un avenir à 20 ou 25 ans, les États-Unis prennet le risque de s’isoler à court terme, alors que leur économie n’est absolument pas prète à supporter cette isolation, ce qui provoquerait une crise interne et ouvrirait un espace aux autres visions du futur de s’imposer aux États-Unis.
Ainsi, il n’est pas sûr que cette vision très particulière du « pré-carré » qui est celle de Donald Trump soit partagée par Elon Musk, qui a des intérêts économiques importants en Chine mais aussi en Europe.
Globalement, la vision de Trump se rapproche d’une vision impériale ancienne, qui ne correspond pas nécessairement à la vision « impérialiste » des grandes entreprises. Mais, cette vision « impérialiste » est-elle encore d’actualité ou bien assistons nous à un retour d’une vision impériale plus ancienne où des objectifs politiques et idéologiques prennent l’ascendant sur une vision plus économique ? L’un des enjeux de l’élection de Trump n’est-il justement pas « Make America Great Again » ou MAGA ? Cette expression peut se comprendre comme un appel à faire des États-Unis à nouveau un pays riche et donc puissant, mais aussi comme un appel à faire des États-Unis un pays puissant qui s’enrichirait par la prédation sur les pays dominés. Cette ambiguité dans le « great » (« grande ») est consubstanciel à la construction du bloc politique qui a permis à Donald Trump de se faire élire. Mais cette ambiguité porte aussi en son sein une contradiction importante au sein de ce bloc.
FP : Au grand dam des atlantistes d’Europe, qui sont bien souvent aussi européistes, Donald Trump n’a apparemment pas l’intention d’épargner l’Union européenne. Dans ce contexte, que pourrait d’après vous faire la France pour protéger ses intérêts ?
JS : D’une manière générale, la vision des dirigeants européens (et en particulier celle des européistes) est prise à contre-pied car elle n’a pas su analyser les évolutions du monde parce que la réalité ne correspondait pas aux paradigmes de cette vision. On est dans une forme particulière du déni de réalité idéologique. Le réveil est, et sera, très dur. Pour Donald Trump, l’Union européenne n’existe pas. Elle n’est qu’un espace appelé à se vider de son industrie et la différence des coûts de l’énergie entre l’UE et les États-Unis qui résulte des sanction anti-russes y est pour beaucoup. D’ailleurs, les industriels allemands de la chimie et de la métallurgie sont en train d’envisager très sérieusement de se délocaliser aux États-Unis. Il y a là une incohérence chez Trump, car une Europe sans industrie est condamnée à la pauvreté et ne pourra plus acheter de produits américains, mais cette incohérence ne semble pas le déranger.
Compte tenu de l’hétérogénéité interne de l’Union européenne, il est probable que ceci aboutisse à un « sauve-qui-peut » généralisé. Certains pays (Pays baltes, Finlande, Pologne) demanderont, voire supplieront, pour être inclus dans la sphère américaine. Compte tenu de leur histoire, on ne peut le leur reprocher. D’autres, la Slovaquie, la Hongrie (déjà bien en contact avec la Chine), et possiblement la Roumanie et la Bulgarie, regarderont vers l’Est et retrouveront, au travers des BRICS, leur liens avec la Russie. Même l’Allemagne, et sans doute l’Italie, apparaissent comme divisées sur la question. Une partie de l’élite politique et économique regarde vers les États-Unis, mais une autre partie n’attend que la première occasion pour ouvrir des négociations fructueuses avec la Russie.
Dans cette situation, la France risque fort d’être isolée et de devenir la proie des États-Unis qui lorgnent sur ce qui lui reste d’industrie. La seule voie de sortie, mais qui exigerait un gouvernement doté d’une forte légitimité populaire, serait de simultanément relancer massivement notre industrie (mais pour cela il faudra prendre ses distances avec l’EU et l’euro) et rompre avec l’atlantisme rampant qui gangrène notre politique étrangère depuis l’élection de Nicolas Sarkozy pour chercher à occuper une position d’intermédiaire entre la puissance américaine et les BRICS, qui sont appelés à se constituer en une alliance du « Sud Global ». Cela demanderait du courage politique et une vision stratégique de long terme. Deux qualités assez rares dans le personnel politique de notre pays. ■
Propos recueillis par Quentin Rousseau
Notes
(1) Dornbush R. Purchasing Power Parity, Cambridge, (Mass.), NBER, Working Paper n°1591, 1985, and Schreyer P. et Koechlin F., Parités de pouvoir d’achat : mesure et utilisations, Paris, OCDE, Cahiers Statistiques, mars 2002, n°3. Balassa B., « The Purchasing-Power Parity Doctrine : A Reappraisal” in Journal of Political Economy, vol. 72, n°6, December 1964, pp. 584-596.
(2) Sapir J., « Assessing the Russian and Chinese Economies Geostrategically” in American Affairs, vol. VI, n°4, 2022, pp. 81-86.