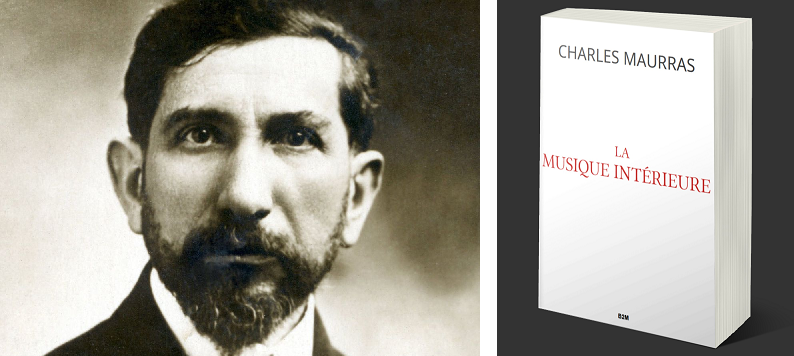
Belle-de-Mai Éditions est de retour ! à l’occasion du centième anniversaire de la parution chez Grasset du recueil de poèmes de Charles Maurras intitulé La Musique intérieure, qui eut lieu, donc, en 1925, au sein de la collection « Les Cahiers Verts » dirigée par Daniel Halévy.
C’est par une substantielle préface adressée à ce dernier que commence ce livre, et qui vient expliquer sa raison d’être, le reste étant composé de poésies en vers écrites sur une période longue de plusieurs décennies.
Indéniablement, sa sortie fut un véritable événement littéraire : à cette époque le « Maître de Martigues », devenu une figure importante du monde des lettres, est à la tête d’une organisation militante puissante dotée d’un quotidien très lu qui opère une grande séduction auprès des jeunes esprits.
Aujourd’hui nous allons voir la seconde partie de la recension que lui consacra le 9 avril 1925 Paul Souday, chargé de la rubrique pour « LES LIVRES » le journal Le Temps, qui fut à la IIIe République ce que le Monde est à la Ve.

« Sans pouvoir partager là-dessus le sentiment de M. Maurras, j’aime assez son ode historique, d’un style volontairement simple et rude, d’allure populaire, et qui ne manque ni de verve, ni de mouvement. Les exagérations et les trivialités qu’on y aperçoit s’expliquent en temps de guerre. Les héros homériques ne se ménageaient pas non plus, et les atrocités allemandes, quoique non conseillées par Kant, n’en justifiaient pas moins toutes les colères et tous les mépris. Mais ce qui suit est beaucoup plus original. De Tyrtée, comme il le dit, ou d’un Déroulède supérieur, M. Maurras s’élève, au moins d’intention, à la plus haute poésie philosophique. Si l’exécution avait pleinement réalisé ses vues, je n’hésite pas à dire que son Colloque des morts serait un chef-d’œuvre. L’idée, qu’il énonce en prose dans sa préface, est admirable. La douleur que lui causa la mort de plusieurs de ses amis, notamment de René de Saint-Pons, qui avait été notre confrère à Paris, fit réfléchir M. Maurras sur les rapports étroits qui unissent les êtres humains dans une espèce d’indivision. « Tous partaient et fuyaient comme si quelque chose du meilleur de moi s’arrachait. J’avais le sentiment de mourir avec eux et ensuite de recevoir, à travers la brûlure du mal de cette mort, un reste de leur vie qui fût comme l’échange du lambeau de mon être enfui. » Voilà le sentiment que nous connaissons, hélas! presque tous. Voici l’idée ou le mythe magnifique qu’imagine M. Maurras, pour rendre compte de ces liens et de ces déchirements.
C’est que « nous courons à l’amour parce que nous en venons et que ceux qui se sont aimés pour nous faire naître ne peuvent nous lancer vers un autre but que le leur ». Scientifiquement, on pourrait objecter que cela n’explique pas l’amour des premiers qui se sont aimés ; sans compter que l’amour véritable n’est pas si fréquent et ne détermine pas toutes les naissances à beaucoup près. Mais poétiquement, c’est très beau. M. Maurras ajoute, en psychologue d’une pénétration un peu effrayante, que « la haine même rend un secret témoignage au très haut prix du frère qu’elle poursuit. Le frapper, le blesser, le tuer sont autant de manières de lui démontrer qu’il importe au-delà de tout et qu’on est incapable de se passer de lui ». C’est peut-être vrai, mais on souhaitera de n’être pas de ces frères que M. Maurras met, à si haut prix et dont il ne peut se passer. Quoi qu’il en soit, il aboutit à la croyance en l’immortalité, qu’appellent ces âmes complémentaires, momentanément séparées, et en attendant il rêve d’une sorte de navire volant, qui, se déplaçant en sens inverse du mouvement de la terre, suspendrait le temps et n’arrêterait pas le soleil, ni les étoiles, mais permettrait de les contempler plus longuement. Imagination étrange, un peu dans le goût de Villiers de l’Isle-Adam ou d’Edgar Poe, bien propre en tout cas à inspirer un poète. Maintenant, que vaut le poème lui-même ? On en jugera : il faut le lire. Il y a de bons vers, des traits heureux :
Âmes sans nombre qui s’aimèrent,
Elles s’aiment en nous toujours…
Les « chers témoins du souvenir », cela définit bien les vieux amis, surtout ceux de notre jeunesse ; on apprécie l’aspiration vers un monde
Où l’esprit n’est pas vaincu,
puis, cette transcription d’une célèbre maxime de Léonard de Vinci :
Te connaissant tout entière,
Mon désir est plus profond…
et dans la dernière partie, celle de la machine fantastique, ces vers :
Ô toi que nous appelions Terre-Mère,
D’où vient ton vol contraire à mon amour ?
Je suis né, je suis fait pour la lumière,
Accorde-moi d’éterniser le jour.
J’ai renversé la manœuvre du monde
Et l’ai soumise à la loi de mon cœur.
Il est pourtant évident que tout cela est un peu menu, un peu maigre, pour un si grand sujet. On dirait du Sully Prudhomme ; il aurait fallu du Dante ou du Victor Hugo.
Il y a de jolies choses dans diverses petites pièces, sensuelles ou sentimentales, comme les Distances :
Ces vivantes médailles roses
Portent la fleur du sceau d’amour.
comme l’élégie assez poignante des Ténèbres, ou la charmante idylle sans titre :
L’olive est au pressoir, la grappe est dans la tonne,
Une rieuse enfant nous verse le muscat…
Il y a une pensée forte, un peu obscure, dans le Mystère d’Ulysse. Défenseur de le tradition classique, de la lumière athénienne et latine, M. Maurras n’est pas toujours clair lui-même : il est parfois aussi hermétique que ces symbolistes qu’il a tant combattus. Il est vrai que ce n’est pas leur hermétisme qu’il leur reprochait. En définitive, je crois qu’il n’est poète qu’à demi mais c’est déjà beaucoup, et bien d’autres pourraient l’envier.

Il y aurait à faire une étude de son œuvre critique. La place me manque aujourd’hui. Les recueils qu’il, vient de publier se composent principalement d’articles parus il y a vingt-cinq ou trente ans, et dont certains au moins ont été retouchés, d’après une note liminaire de l’Allée des philosophes. De même, dans la nouvelle édition du Chemin de Paradis, il a fait bien des coupures et a supprimé notamment cette phrase, jadis fameuse, de la préface dédiée à Frédéric Amouretti « Je ne quitterai pas ce cortège savant des Pères, des Conciles, des Papes et de tous les grands hommes de l’élite moderne pour me fier aux évangiles de quatre juifs obscurs. » D’ailleurs, au rebours de son ami Paul Bourget, il avertit loyalement. Mais, quelle plus-value pour les premières éditions non expurgées !
Pour la critique littéraire proprement dite, les corrections sont moins importantes, si je m’en rapporte à ma mémoire. Car je lisais avidement ces articles de M. Maurras, lorsqu’ils paraissaient dans la Revue Encyclopédique ou la Gazette de France. Déjà, je n’étais pas toujours de son opinion, mais il m’amusait toujours., Oserai-je avouer que, sans en méconnaître les mérites, ces pages anciennes m’ont amusé un peu moins ces jours-ci ? La raison en est simple. Il y a deux sortes principales de critique : la critique qui s’efforce de tout comprendre, et celle qui vise avant tout à exercer une influence. M. Charles Maurras n’a guère fait que de la critique de combat. En littérature comme ailleurs, il a toujours été essentiellement un homme d’action. Dans le vif de l’actualité et le feu de la bataille, certaines violences sont peut-être de bonne guerre. À distance, lorsqu’on relit ces articles de polémique à tête reposée, on y prend encore un certain plaisir un peu rétrospectif, mais cela manque vraiment trop de justice et d’objectivité. Que penser d’un historien des lettres pour qui le sceptre de la poésie est resté en déshérence de Chénier à Moréas, qui trouve que la France n’a jamais été aussi pauvre en lyrisme que dans cette période et qu’elle a traversé alors trois quarts de siècle de barbarie ? »
Paul Souday
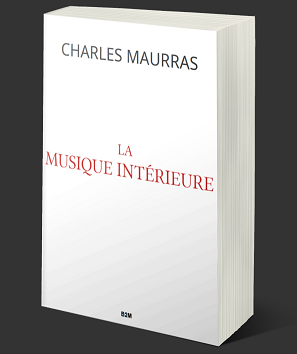
Nombre de pages : 240.
Prix (frais de port inclus, offerts par Belle-de-Mai Éditions) : 25 €.
Pour commander ou se renseigner, écrire à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net ■











