
Une série de France Télévisions restitue avec brio les jours terribles de 2021 où les Occidentaux ont évacué la capitale afghane.
Par Jean-Christophe Buisson*.
L’été afghan a peu à voir avec l’été indien. Surtout en 2021. Sous un soleil aoûtien de plomb, le pays est sur le point de sombrer à nouveau dans la nuit talibane. Les États-Unis ayant annoncé leur départ, les islamistes ont décidé de ne même pas attendre que celui-ci soit effectif pour fondre sur Kaboul. Autant dire que ni les Occidentaux ni les contractuels locaux ayant travaillé pour ces derniers n’ont intérêt à traîner dans les parages. Ils sont des milliers à se rendre dans les ambassades ou à l’aéroport, où le ballet des avions du retour ou de l’exil a commencé. Tous n’y trouveront pas une place.
Cette situation de crise a été suffisamment documentée pour que les cinéastes s’en emparent. En attendant au cinéma 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, des producteurs européens se sont associés pour créer la minisérie Kaboul (6 épisodes, France.tv). La mise en place est un peu longue en raison de la multiplicité des histoires et des protagonistes de différentes nationalités, mais on finit par s’attacher aux unes et aux autres grâce au scénario très bien ficelé de Thomas Finkielkraut et Olivier Demangel. Eux ne laissent personne sur le tarmac…
On suit donc le chef de la sécurité de l’ambassade de France, admirablement campé par le Belge Jonathan Zaccaï, appelé à négocier l’inégociable avec les barbus orphelins de Ben Laden et de mollah Omar ; un consul italien dont c’est la première mission sur le terrain et qui saura dépasser sa peur, sa naïveté et son inexpérience pour évacuer des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ; une espionne allemande qui, malgré un premier séjour traumatisant, revient se jeter dans la gueule du loup pour exfiltrer un général de l’armée régulière afghane. Et surtout une famille locale au pedigree lourd : la mère, procureur, a condamné à la prison des dizaines de talibans ; le fils espionne pour la CIA ; la fille est médecin dans un pays où, bientôt, les femmes n’auront plus que le droit de respirer (si elles le font chez elles et en burqa).
C’est brillamment interprété, il y a un peu d’action et beaucoup de psychologie, du stress et du suspense. Dans la famille des séries de guerre françaises, cela n’atteint pas le niveau de Cœurs noirs (à quand la saison 2 ?), mais ce cousin kaboulien est le bienvenu. ■ JEAN-CHRISTOPHE BUISSON
Source : Le Figaro magazine du 4 avril 2025.
* Jean Christophe Buisson est écrivain et directeur adjoint du Figaro Magazine. Il présente l’émission hebdomadaire Historiquement show4 et l’émission bimestrielle L’Histoire immédiate où il reçoit pendant plus d’une heure une grande figure intellectuelle française (Régis Debray, Pierre Manent, Jean-Pierre Le Goff, Marcel Gauchet, etc.). Il est également chroniqueur dans l’émission AcTualiTy sur France 2. Ses livres récents, 1917, l’année qui a changé le monde, et Le Siècle rouge. Les mondes communistes, 1919-1989, (2019) sont parus aux éditions Perrin.
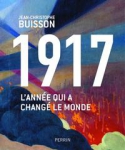
1917, l’année qui a changé le monde de Jean-Christophe Buisson, Perrin, 320 p. et une centaine d’illustrations, 24,90 €.
Le Siècle rouge. Les mondes communistes, 1919-1989, de Jean-Christophe Buisson, Perrin, 420 p. avec illustrations, 27 €.

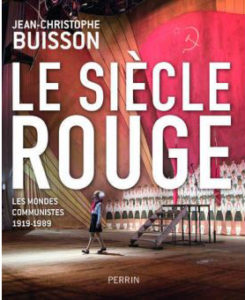












Il ne fait pas bon d’être l’allié de la coalition occidentale…