
Cette chronique d’un optimisme inhabituel chez Mathieu Bock-Côté et sans nul doute quelque peu excessif et décalé, mais malgré tout originale et intéressante, est parue dans JDNEWS le 9 avril. Les commentaires sont ouverts. JE SUIS FRANÇAIS
Par
CHRONIQUE. Mathieu Bock-Côté nous fait découvrir le nouvel essai d’Ophélie Roque, professeure de français en banlieue. Dans Antisèches d’une prof, l’enseignante braque une lumière crue sur les fléaux qui minent l’école : de l’idéologie portée par l’Éducation nationale à la violence croissante des élèves.


Il y a deux ans, en 2023, sans qu’on ne sache trop d’où elle sortait, Ophélie Roque publiait son premier roman, Black Mesa, un western inattendu, d’une beauté aride et glaciale, où elle faisait un portrait entomologique de la misère humaine et de la vanité de nos existences dans un décor improbable. Je me rappelle de cette lecture quasi hypnotique, m’être dit qu’il s’agissait d’un vrai grand livre et qu’une figure nouvelle venait d’apparaître dans le paysage littéraire et intellectuel.
Et de fait, depuis deux ans, on a pu la lire de plus en plus souvent dans les journaux, à la manière d’une chroniqueuse improbable de l’actualité, moins occupée à défendre une thèse qu’à décrire le monde tel qu’il lui apparaît. Chaque fois, ses textes sont piquants, perspicaces, mordants, et pourtant, dénués de l’agressivité mauvaise qui caractérise souvent les militants. Devant un vil personnage croisant sa route, elle misera moins sur une enfilade d’invectives que sur un portrait amusé, en tendant au margoulin un texte miroir où il ne pourra plus voir que son horrible furoncle au visage – ce qui ne l’empêchera pas de lui dire coucou !
Professeure de français en banlieue, elle s’est mis en tête de nous présenter l’école telle qu’elle est
 Tout cela pour dire que notre auteure est inclassable et vient tout juste de publier son nouveau livre, aux Presses de la Cité, qui au premier regard, prend le monde en sens inverse du premier, car ici, la vie est grouillante. Et pourtant, on la reconnaît. Car encore, elle a le souci de décrire le monde qui l’entoure, mais cette fois, avec le sourire. Professeure de français en banlieue, elle s’est mis en tête de nous présenter l’école telle qu’elle est. Le titre, Antisèches d’une prof, en donne moins l’esprit, que le sous-titre : Pour survivre à l’Éducation nationale. Et pourtant, l’ouvrage est dénué du ton apocalyptique wanabee Léon Bloy qui caractérise souvent le genre.
Tout cela pour dire que notre auteure est inclassable et vient tout juste de publier son nouveau livre, aux Presses de la Cité, qui au premier regard, prend le monde en sens inverse du premier, car ici, la vie est grouillante. Et pourtant, on la reconnaît. Car encore, elle a le souci de décrire le monde qui l’entoure, mais cette fois, avec le sourire. Professeure de français en banlieue, elle s’est mis en tête de nous présenter l’école telle qu’elle est. Le titre, Antisèches d’une prof, en donne moins l’esprit, que le sous-titre : Pour survivre à l’Éducation nationale. Et pourtant, l’ouvrage est dénué du ton apocalyptique wanabee Léon Bloy qui caractérise souvent le genre.
Ophélie Roque ne fustige pas, ne peste pas, mais nous propose plutôt une visite guidée amusée au cœur des ruines, en indiquant, je reste sur ma première image, les nombreux boutons à la figure de l’école française. La visite est exhaustive et truffée d’anecdotes improbables, tellement incroyables qu’elles ne peuvent être que vraies. On découvre tout, des classes sans fenêtres à l’école numérique, les provocatrices voilées, l’inclusion délirante ainsi que l’épidémie d’HPI, et naturellement, les élèves souvent égarés, de temps en temps violents, occasionnellement idiots, parfois lumineux, qu’elle croise sur sa route, et qu’elle ne parvient pas à ne pas aimer.
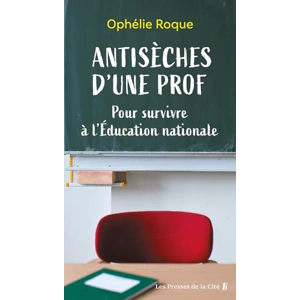 Car c’est une autre marque distinctive de ce journal de bord et ouvrage, qui n’est décidément pas un livre sur l’école comme un autre : Ophélie Roque a pour ses élèves une vraie tendresse. Je ne crois pas trahir sa position en disant que si l’école en elle-même est à peu près irréformable, chaque professeur, dans sa classe, pour peu qu’il le veuille, peut transmettre aux élèves un bout de savoir, et peut-être même, si les dieux sont bons, le goût de la culture. Cela n’arrive pas tous les jours, mais les années passent, et de temps en temps, un ancien élève croise son ancien prof et lui dit qu’il a marqué son destin – on l’a souvent dit à mon père, professeur lui-même, et je détourne un instant l’objet de cette chronique pour lui rendre hommage.
Car c’est une autre marque distinctive de ce journal de bord et ouvrage, qui n’est décidément pas un livre sur l’école comme un autre : Ophélie Roque a pour ses élèves une vraie tendresse. Je ne crois pas trahir sa position en disant que si l’école en elle-même est à peu près irréformable, chaque professeur, dans sa classe, pour peu qu’il le veuille, peut transmettre aux élèves un bout de savoir, et peut-être même, si les dieux sont bons, le goût de la culture. Cela n’arrive pas tous les jours, mais les années passent, et de temps en temps, un ancien élève croise son ancien prof et lui dit qu’il a marqué son destin – on l’a souvent dit à mon père, professeur lui-même, et je détourne un instant l’objet de cette chronique pour lui rendre hommage.
Mais revenons aux Antisèches de Madame Roque : son livre pourrait passer pour un essai, ou peut-être un récit, mais en fait, il s’agit tout à la fois d’un journal de bord et d’un roman qui ne dit pas son nom. Journal de bord, parce qu’on y décrit une institution à même l’expérience du quotidien d’une prof qui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il faut être au cœur du système pour le connaître aussi bien. Roman, parce qu’il faut avoir l’œil et la patte de l’écrivain, aussi, pour voir ce qu’elle voit, et nous le rapporter avec un tel bonheur d’écriture, nous rappelant que le sourire est une politesse faite à l’existence, à la portée de tous, et que c’est aussi grâce à lui qu’on survivra à l’Éducation nationale… ■ MATHIEU BOCK-CÖTÉ











