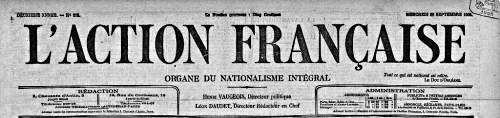
Cela est la grande préoccupation de Bossuet. Personne n’a plus souffert que lui du déchirement de la France par la Réforme. Non seulement parce qu’il croyait posséder la vérité, mais parce qu’il estimait que le plus grand bien pour un peuple est l’unanimité religieuse, qui entraîne l’unité de l’éducation et des mœurs, et par là double les forces de la communauté et même la rend plus heureuse, par la paix de l’esprit. Et c’est pourquoi, pendant, cinquante ans, il a travaillé à la réconciliation des protestants avec les catholiques. Il voyait là une grande œuvre nationale. Il a mené cette généreuse entreprise uniquement par la plume et par la parole. On ne peut imaginer, si on ne l’a pas lu, ce qu’il y a montré de bon sens et même de liberté d’esprit (dans les limites fixées par le dogme), de subtilité puissante, de persuasion et d’émotion, de zèle et même d’honnête adresse pour atténuer les difficultés et pour écarter celles qui ne sont qu’apparentes ; enfin de ménagement et de charité pour les personnes.
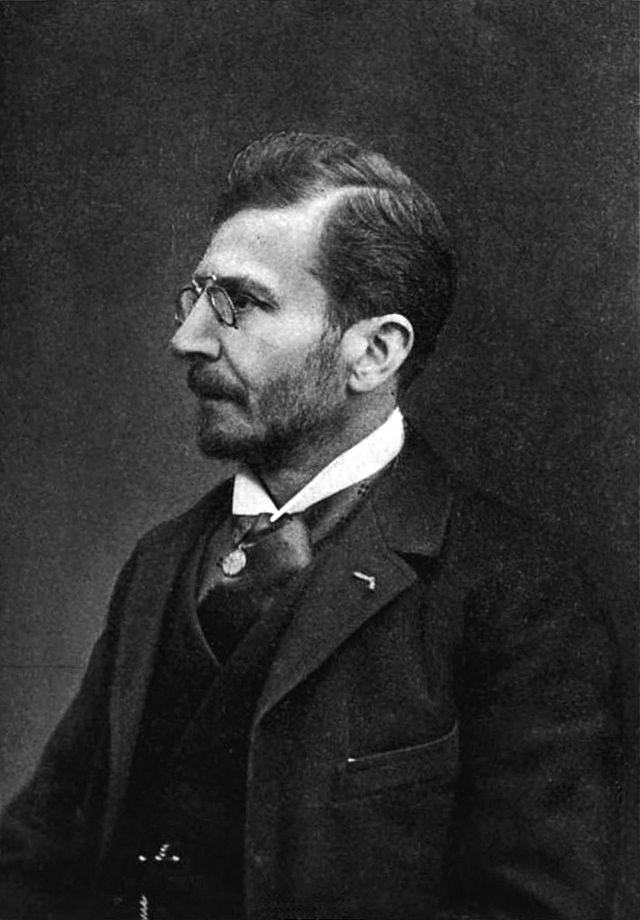
À ce grand dessein (ceci a été fort bien vu par Brunetière), Bossuet subordonne toute sa conduite. S’il est gallican en 1682, c’est sans doute parce qu’il est d’un sang de parlementaires, mais c’est aussi parce qu’il jugeait que les prétentions du Saint-Siège au gouvernement du temporel des États étaient le plus fort obstacle à la réunion des Églises. S’il combat avec acharnement la quiétisme, c’est bien par amour de la simplicité et de l’unité, et parce que Mme Guyon lui a pris Fénelon : mais il craint aussi qu’en raffinant trop sur la piété, en donnant dans les subtilités du pire mysticisme, on n’augmente encore la difficulté de s’entendre avec les protestants. Il sait combien il est doux et rassurant d’être uni de foi avec les générations passées, et il accepte toute la tradition : mais il n’accepte que la tradition. Il pense que la doctrine est complète et ne veut pas de dogmes nouveaux, toujours pour ne pas effaroucher les frères qu’il a résolu de ramener. À un moment, après une longue correspondance avec Leibnitz, il a pu se figurer qu’il était bien près de trouver le terrain d’entente avec les Églises réformées. Il est mort, je crois, sans en avoir désespéré. Si ce fut une illusion, elle fut belle et d’un grand cœur.
Il n’a travaillé que pour l’Église et pour la France, sans les séparer dans son amour. Précepteur du Dauphin, il interrompt ses prédications, il écrit des livres dont son élève ne profita guère, mais dont tout le monde put profiter. Bossuet est le théoricien et le poète de la Providence contre les incrédules qu’il sentait venir. Le Discours de l’Histoire universelle est l’histoire du gouvernement du monde par Dieu ; il ressemble à un immense drame, à une « Divine Tragédie » : mais en même temps sur la psychologie des peuples anciens que de vues profondes ! Dans le Cinquième Avertissement aux Protestants, Bossuet réfute d’avance le Contrat social et l’erreur démocratique. Dans la Politique tirée de l’Écriture sainte, il explique aux Français de son temps les avantages de leur antique gouvernement, si conforme au bon sens et à la nature, leur donne les meilleures raisons de l’aimer, et limite les droits du souverain par tant de devoirs, que ce manuel de la monarchie dite absolue respire l’humanité et la bonté.
C’est que, en effet, ce grand homme fut aussi un bon homme. Il le fut ici et à Germigny. Il fut un très bon homme d’évêque pendant vingt-deux ans. Il se crut obligé à la résidence. Il administrait avec soin et visitait son diocèse ; il prêchait dans sa cathédrale le plus souvent qu’il pouvait. Il n’était pas habile : ce Père de l’Église, qui aurait dû être archevêque de Paris et cardinal, fut simplement évêque de Meaux (de quoi je vous fais, à vous, mon compliment). Il était candide. Il était indulgent. Théologien inébranlable, il fut un oncle faible… Je rappelle ces traits pour qu’il nous paraisse plus accessible et que nous l’aimions davantage.

En somme, quelle merveille, messieurs, que cette vie et que cette œuvre ! Pendant un demi-siècle, pas un discours et pas un livre de Bossuet qui n’ait été d ’utilité publique. Personne ne fut plus exempt de tout amour-propre d’auteur que cet écrivain si grand entre les plus grands. Et justement les qualités de son style sont presque toutes de celles qui supposent l’oubli de soi, l’absence de toute affection vaniteuse : car nul style n’est plus simple à l’ordinaire, plus naturel, plus libre, plus franc. Et nul aussi n’est plus expressif, plus passion né, plus majestueux et plus vaste quand il lui plaît, plus riche d’images imprévues, de plus de couleur ni de plus de mouvement. Aucun écrivain n’a été plus poète que cet orateur souverain.
Le peuple connaît son nom et sait qu’il fut le plus éloquent des hommes. Il n’a guère eu d’ennemis, depuis sa mort ; et je crois qu’à présent il n’en a plus du tout. Il en impose aux esprits même les plus éloignés du sien, par sa sincérité, sa force, sa carrure et toute l’harmonie de son être. Il fut nettement et splendidement ce qu’il fut le monument que nous inaugurons, très heureusement inspiré, il me semble, de l’art du XVIIe siècle, évoque bien, — avec ce geste vers le ciel, avec ces personnages illustres et pathétiques qui furent ses pénitents, — le suprême représentant et interprète de la France catholique et monarchique d’autrefois, qui ne vécut que pour elle, qui ne parla et n’écrivit que pour elle, et qui ajouta plus que personne à sa vertu et à sa gloire. Nous ne saurions, messieurs, trop honorer ce magnifique Français.
Jules Lemaître. De l’Académie Française.
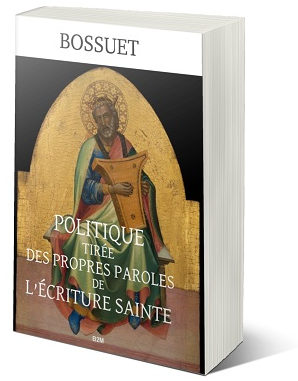
Nombre de pages : 556
Prix (frais de port inclus) : 31 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net












Dans ma jeunesse fort lointaine, j’étais enthousiasmé par Bossuet, pas seulement par ses fastueuses oraisons funèbres -« Celui qui règne dans les cieux, à qui seul appartiennent la majesté, la puissance et la gloire… » -mais encore plus par ses panégyriques, en particulier, celui de St François d’Assise: « -Savez-vous ce que c’est qu’un jeune homme de dix sept ans…? Justement, j’avais 17 ans à ce moment-là….Je n’ai jamais oublié que « la couronne de notre monarque est une couronne d’épines: l’éclat qui en rejaillit, ce sont les afflictions et les souffrances ».