
Occupons-nous de Bossuet. M. Dimier caractérise le génie de Bossuet, son activité, son enseignement. Il étudie, en Bossuet, l’orateur, l’historien, l’humaniste, le philosophe ; l’homme de cour, la théologien, le directeur de conscience et l’évêque, le défenseur de l’orthodoxie et la politique.
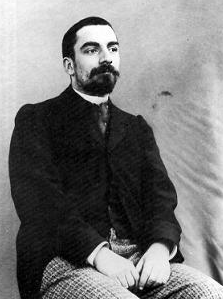
Tous ces chapitres sont extrêmement pleins ; et pleins de Bossuet : l’auteur ne cherche pas à paraître et plutôt cherche à n’être pas là. Vous le découvrez, mais seulement à cette façon qu’il a de se sacrifier, façon qui n’est certes pas commune chez les critiques. Il préfère Bossuet ; et c’est Bossuet qu’il nous livre. Même, il préfère à Bossuet les idées de Bossuet. Contrairement à l’usage qui, depuis Sainte-Beuve, s’est répandu, et s’est développé jusqu’à un excès dont Sainte-Beuve n’a peut-être pas toute la responsabilité, il a réduit à peu de chose la vie de Bossuet, la portrait de ce grand homme et les anecdotes de sa destinée. Une fois seulement, il se risque à cette enquête : et c’est à propos d’une légende ridicule, ce prétendu mariage que Bossuet, dans sa jeunesse, aurait contracté avec la très singulière Mlle de Mauléon. Cette anecdote-ci n’était pas néligeable, si les malveillants pouvaient l’utiliser contre Bossuet, partir de là pour dénigrer Bossuet, pour le déconsidérer, pour déconsidérer du même coup les idées auxquelles cet écrivain dévoua son rôle à son génie. L’anecdote, ne vaut rien : M. Dimier montre la nullité des arguments qui l’accréditeraient. Après cela, ei la calomnie supprimée, voici l’enseignement de Bossuet.
Or, un certain nombre de penseurs qui, au siècle dernier, eurent de l’influence, nous ont arrangé un Bossuet tel que, si c’était là Bossuet, nous n’aurions pas affaire à lui. Éloquent ; mais Démosthène aussi fut éloquent : et nous n’avons guère à lui emprunter, pour nos croyances, ni pour notre conduite, à présent.

Ce Bossuet, qu’on nous invitait à regarder comme un type très singulier d’ancien régime, on l’avait éloigné de nous et reconduit à son époque. Ses idées ? Les idées de son temps : un temps si étonnamment différent du nôtre, où il appartenait à l’histoire et, si l’on veut, à l’archéologie ou, peu s’en faut, à la paléontologie. Ce Bossuet, c’était un échantillon très distingué d’une faune abolie, la merveille d’un terrain désormais recouvert par d’autres couches. Un théologien ! Vous n’avez pas envie ds causer, peut-être, avec un théologien… Qu’est-ce que la théologie ? demande M. Dimier. « Le point où les notions les plus hautes auxquelles l’esprit puisse s’élever commandent la pratique de la vie : d’une part, la théologie touche à cette partie de l’antique réflexion des sages que nous appelons métaphysique ; en même temps, la règle des mœurs en sort. » Mais, répliquent les embaumeurs de Bossuet, les mœurs ont évolué, la pratique a changé depuis deux siècles que sa voix est morte et son ardeur éteinte.
Pour démontrer que ce changement de nos mœurs nous sépare de Bossuet, nous le rend à jamais étranger, l’on insiste sur son « absolutisme », et l’on oppose à une telle, manie d’affirmer, d’infliger son opinion, la nouvelle et précieuse liberté de 1a pensée. Prenez garde, répond M. Dimier : Bossuet recourt à l’autorité de l’Église et recourt à l’autorité du bon sens, mais toujours sans dommage aucun pour la raison. « Partout, nous voyons qu’il examine, discute, apporte des preuves ; il n’y a pas chez lui de sortes de conclusions qu’il n’ait soin d’expliquer à l’intelligence… » Alors, est-il absolutiste ? Il l’est, comme ceci : « Bossuet enseigne que tout n’est pas opinion dans les affirmations auxquelles les hommes s’attachent. Il y a, selon lui, des vérités, il y a des certitudes fondées, établies de façon à mises en doute que par la mauvaise foi ou par l’ignorance. Ni à l’une, ni à l’autre de ces deux causes d’erreur, Bossuet n’admet que le vrai soit sacrifié. Supposé qu’il s’agisse du vrai en des matières de grande conséquence pratique, il s’ensuivra que les pouvoirs publics auront le de voir de le défendre. » C’est, dira-t-on, la raison même ; ou bien l’on dira que c’est la théorie même du despotisme. Voyons un peu la théorie du libéralisme partait. M. Dimier la trouve chez un de plus plus vains orateurs qui, un jour, célébrait comme la plus belle conquête des temps modernes le droit de se tromper de bonne foi. L’auditoire, là-dessus, applaudit ; et la bonne foi dans l’erreur semble une espèce de sainteté digne d’éloges. Pourtant, l’erreur, commise de bonne foi, n’est pas moins une erreur ; et les idées ont des conséquences de fait : et les idées fausses, les pires conséquences. Un calculateur qui aurait î’intime conviction que deux et deux font cinq, ou trois, serait de bonne foi, s’il enseignait aux petits enfants, le long des chemins, que deux et deux font cinq ou trois ; de mauvaise foi, s’il enseignait, l’imposteur. que deux et deux font quatre : son imposture vaudrait mieux, néanmoins, que sa probité folle. Un citoyen qui serait persuadé qu’en temps de guerre il faut livrer sa patrie à l’ennemi serait de bonne foi, s’il la livrait : il vaut mieux qu’il ne la livre pas. C’est une absurdité, de recommander à l’estime et à l’amitié des multitudes l’erreur sincère. Seulement, vous aurez donc à choisir, entre les opinions, celles qui sont des vérités ? Cela ne vous effraye-t-il pas ? M. Dimier concède que 1’on peut épiloguer sur le choix des vérités qu’il faut, à une époque déterminée, garantir contre toute contestation : « quant au principe, il est certain. »
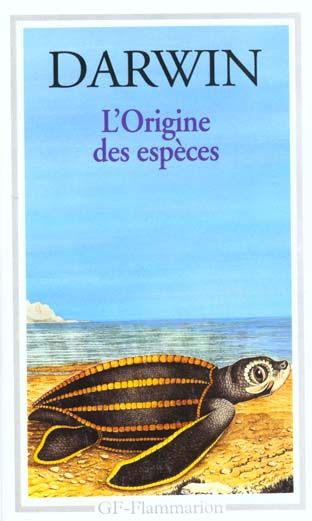
Le principe que pose M. Dimier n’est pas douteux, en effet. Chaque époque a mainteant ses idées, et non pas ses idées de hasard, mais bien ses idées indispensables, que les circonstances l’obligeaient à préserver et sans lesquelles tout se détraquait. J ’ajoute qu’on exagère aussi le changement qui, d’une époque à l’autre, modifie les conditions de l’existence. Il y a du changement : le changement n’est pas tel qu’il aboutisse à une nouveauté complète. On exagère la mobilité humaine ; et l’on oublie d’observer ce que l’humanité a de permanent. Lee évolutionnistes ont popularisé une étrange notion de perpétuel devenir qui fait que nous n’osons plus nous établir en aucun moment de la durée. Nous anticipons les lendemains et les surlendemains. Nous ne demeurons plus et nous sommes campés, un peu comme les bohémiens en voyage et qui n’ont pas le loisir d’une installation. Bossuet nous enseigne ce qu’il y a, dans notre destinée, de permanent. Regardez-y : ce qu’il y a de permanent, c’est, dans notre destinée, le principal.
ANDRÉ BEAUNIER
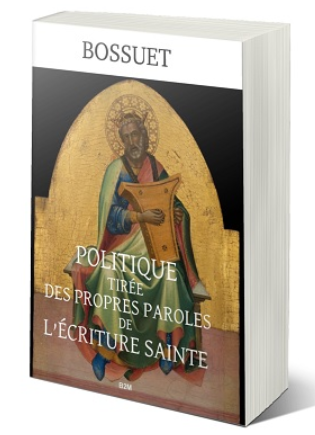
Nombre de pages : 556
Prix (frais de port inclus) : 31 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net











