
« CHRONIQUE DES LIVRES » : L’UTILISATION DE BOSSUET

Un des derniers numéros de la Revue Hebdomadaire contenait un article plein d’enseignements de M. Gustave Fagniez, de l’Académie des Sciences Morales et Politiques sur l’Utilisation de Bossuet dans le temps présent. C’est le livre de Louis Dimier sur Bossuet qui a inspiré cette étude ; M. Fagniez remarque, en effet, que la. pensée de Dimier tend, vers un but pratique bien défini : propager Bossuet non comme le sujet d’une vaine admiration littéraire, mais comme un exemple et comme un guide à consulter et à suivre.
Au premier abord, cette vue ne laissera pas d’étonner le grand nombre des lecteurs mal informés. M. Fagniez en note très finement les raisons : c’est qu’il y a, dit-il, deux opinions sur Bossuet : celle des gens qui ne l’ont point lu, qui ne le connaissent que sur sa réputation d’orateur ; et celle des esprits très rares qui ont embrassé dans son ensemble l’œuvre et la pensée du grand évêque, théologien, historien, philosophe, orateur, moraliste, politique et polémiste. Les premiers sont de loin les plus nombreux ; pour eux, Bossuet demeure l’orateur des oraisons funèbres : comment penserait-on à aller cher cher des leçons dans ce genre conventionnel, qui ne développe que des lieux communs ? Ainsi pense-t-on, et Bossuet, ainsi jugé et diminué, est victime du discrédit qui frappe aujourd’hui avec quelque raison l’éloquence et les orateurs. Puis .il y a autre chose, que M. Fagniez exprime ainsi :
Bossuet a eu encore contre lui quelque chose de plus grave que cette prévention sur l’incompatibilité entre l’éloquence et l’originalité de la pensée. Le siècle dont ses yeux, au moment de se fermer, ont vu le début, a inauguré une longue réaction contre le régime de discipline morale et sociale dont la société française, au sortir des guerres civiles, avait senti le besoin et que des hommes comme Richelieu et Louis XIV avaient fondé. L’esprit humain avait cru s’émanciper en se plaisant à relâcher et à rompre les liens sociaux, les contraintes morales, à exalter et à faire prévaloir, sous le nom de liberté, la légitimité des instincts, la caractère contractuel des devoirs, l’égoïsme des intérêts et finalement le règne de la force. Bossuet ne pouvait manquer d’être victime de ce développement et de ce triomphe de l’individualisme dont l’esprit français. malgré les dures leçons et des moments de clairvoyance, est encore loin d’être désabusé. Il y eut donc parmi les dupes et les profiteurs du libéralisme, autant dire chez presque tout le monde, un mot d’ordre pour ignorer et méconnaître Bossuet, pour se donner le droit, en célébrant son éloquence, de lui refuser tout le reste.
En un mot, malgré les travaux des Lebarq, des Gandar, des Floquet, des Rebelliau, Bossuet n’était pas à la mode. M. Jérôme Coigniard déclarait tout net que « Bossuet n’a pas de philosophie », cependant que le doctoral et fol M. Brunetière prouvait, par raison démonstrative, qu’il n’était qu’un poète lyrique. Entre cet imprudent, ami et ce sage ennemi, Bossuet n’avait pas grand chose à gager de quelque côté qu’il se tournât.
Comment, en effet, son dogmatisme, inséparable de son orthodoxie, n’eût-il pas effrayé ces esprits, que peint M. Fagniez :
… Qui se dissimulaient à eux-mêmes, sous le nom de libéralisme, leur indifférence et leur impuissance à distinguer la vérité et et l’erreur, leur incapacité à attribuer à l’une et à l’autre ! une valeur objective et une valeur morale, l’une et l’autre restant si légitimes et si voisines, qu’il serait puéril de risquer, pour ou contre elles, sa sécurité et même son repos.
Cependant aujourd’hui, à travers bien des flottements et bien des brouillards, les générations nouvelles prennent leur tâche plus au sérieux ; elles acceptent bravement ce que cette tâche a de tragique, et M. Fagniez les montre sollicitées par un dogmatisme pragmatique qui distinguerait la valeur des idées suivant le bien et le mal qu’elles peuvent faire à la communauté nationale. M. Fagniez a raison, et plus d’un d’entre nous a passé par ces voies avant de pouvoir dire, comme notre maître Jules Lemaître : inveni portum.
Mais alors, comment ne pas remarquer que 1e dogmatisme de Bossuet s’accorde spontanément avec de tels points de vue, encore qu’il les domine de bien haut ? Il disait, parlant de lui-même : « S’il a quelque autorité, il ne la doit qu’à ce qu’il a toujours marché dans la créance commune » (Relation avec la querelle du quiétisme.)
N’est-il pas vrai, dit alors M. Fagniez, qu’aujourd’hui, dans les sciences morales et sociales, on incline à tenir moins de compte des théories originales des nouvelles écoles philosophiques et sociologiques que des principes fondamentaux éprouvés par l’expérience et adoptés par la raison universelle ? Et ces clartés nouvelles ne ramènent-elles pas, qu’on le sache ou non, à la façon dont Bossuet concevait les conditions de la certitude ?
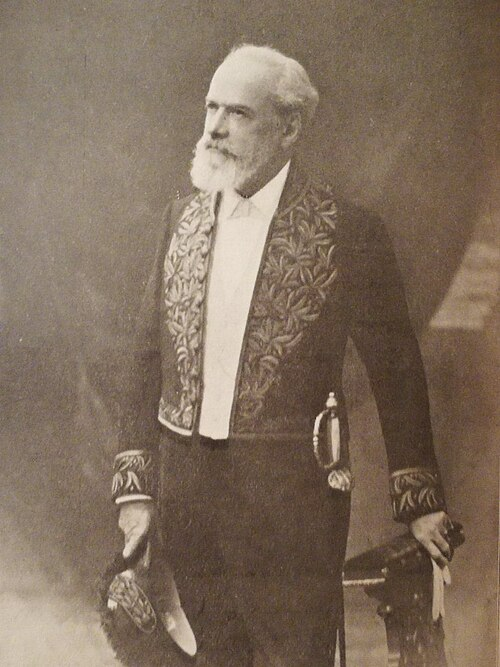
M. Fagniez examine ensuite rapidement l’œuvre de Bossuet et ne manque pas de faire ressortir de cet examen ce fait que chez l’évêque de Meaux tout concourt à l’action, tout y aboutit, tout est action. Pas un livre, pas un écrit qui ne vise à convaincre, à entraîner, à agir. Les sermons, les polémiques tendaient à faire des catholiques : les faits sont là pour dire s’il a réussi : 30 000 conversions, tout un faubourg de sa ville épiscopale, des noms comme celui de Turenne, tels furent les résultats de ses prédications. En visant à l’éducation d’un prince, d’autres ouvrages n’eurent pas une moindre utilité : le Discours sur l’Histoire universelle, le Traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même, la Politique tirée de l’Écriture sainte, la lettre à Innocent XI. M. Fagniez ne manque pas de noter la valeur pédagogique, la délicattesse d’analyse, la clarté d’exposition de ces ouvrages, que leurs conclusions ont fait follement écarter des programmes d’enseignement. À ce propos, M. Fagniez est amené à parler de la politique de Bossuet. Il montre le grand évêque donnant toutes les raisons de sa préférence pour la monarchie pure, pour celle qu’il appelle la monarchie absolue. L’histoire universelle lui montrait la prospérité des États toujours liées à la monarchie ou à la république aristocratique, toujours incompatible avec le gouvernement de la démocratie, les sociétés conduites ou ramenées au premier de ces deux régimes par le second. Plus encore que dans la Politique de l’Écriture Sainte, il faut voir ces raisons démontrées par la voie empirique dans ce Cinquième avertissement aux protestants, où Bossuet réfute, contre le pasteur Jurieu, et par avance contre Rousseau, la doctrine de la souveraineté du peuple. M. Fagniez montre ici son auteur faisant et tendre des vérités de tous les temps et intervenant par là dans les débats du nôtre. Que d’erreurs, dans cet avertissement, prévues et condamnées : par exemple « l’illusion de pouvoir se renfermer dans l’action, morale et sociale sains s’occuper des institutions qui la rendent stérile ou même impossible ». Ou bien encore : « l’idée d’un soi-disant patriotisme idéal, étranger à toute attache matérielle, au patriotisme qui a ses racines dans la terre et que la démocratie chrétienne a flétri sous le nom de patriotisme territorial ».
Plus loin, M. Fagniez propose une maîtresse définition du pouvoir et du souverain tels que les comprenait Bossuet :
Maître absolu eu égard à la contrainte qu’il peut exercer et sans laquelle il serait impuissant mais qui ne peut exercer, que dans l’intérêt et avec l’aveu tacite de la communauté et enfin avec la garantie, plus efficace rue toutes les autres, de l’intérêt personnel et dynastique de celui qui en est investi. Barrières qui ne résisteront sans doute pas toujours à l’arbitraire, mais qui sont, sans préjudice d’ailleurs, des contrats, plus solides que tous les contrats parce qu’elles ont leur fondement dans la nature humaine, dans l’intérêt bien entendu des parties.

Vérités éternelles, s’écrie M. Fagniez, mais pendant si longtemps oubliées qu’on a pu, quand elles se produisent, les prendre pour des découvertes. M. Fagniez montre ensuite cet oubli favorisé par l’école des historiens du XIXe siècle, dans les œuvres desquels la vérité et le patriotisme souffrent également de l’esprit de système et de parti qui y règne : on ne leur demande plus aujourd’hui l’intelligence de notre passé ni le secret de notre avenir ; on se tourne au contraire vers Bossuet historien et vers cette légion de savants, religieux ou laïques, qui fondaient les sciences auxiliaires de l’histoire, mettaient au jour ses mouvements, appliquaient leur diligence érudite à ses sources et à ses origines : c’est dans ce milieu, parmi les frères Du Puy, les Lamoignon, les Launoy, les Mabillon, les Le Nain de Tillemont, qu’il faut se représenter Bossuet préparant son Histoire des Variations, étonnant chef-d’œuvre, où le scrupule de l’information, la sûreté de la science et de la raison se marient à l’allègre verdeur de sa verve polémique, à la souplesse d’une forme qui emprunte tous les tons, depuis, la raillerie familière jusqu’à la plus magnifique éloquence. Quel dommage qu’on ne lise plus aujourd’hui ce passionnant ouvrage, qui enchantait Madame de Sévigné !
Parlant d’un génie qu’il appelle, d’une formule heureuse, « aussi simple que grand », M. Fagniez assure qu’il faut soi-même rester simple. Ce sera la dernière leçon que nous tirerons ensemble de cette course rapide à travers une telle œuvre, si riche, si féconde, si amplement variée. Nous avons cru devoir suivre pas à pas l’étude de M. Fagniez, et la citer le plus largement possible : nous l’avons laissé parler et n’avons pas pensé pouvoir mieux faire.
LUCIEN DUBECH.
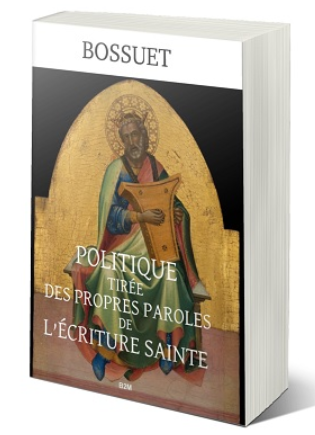
Nombre de pages : 556
Prix (frais de port inclus) : 31 €
Commander ou se renseigner à l’adresse ci-après : commande.b2m_edition@laposte.net











