Jean Sévillia présente La France sans identité, de Paul-François Paoli, dans Le Figaro Magazine du 14 février (1).
(1): La France sans identité, Pourquoi la République ne s’aime plus?, de Paul-François Paoli. Autres temps, 166 pages, 16 euros.
Sévillia, reprenant l’auteur, emploie l’expression, malheureusement fort juste, « haine de soi ». On pense en effet à Maurras (2) ou à Zemmour (« La gauche interdit au peuple français de défendre son identité mais encourage toutes les autres identités du monde à se défendre, qu’elles soient kosovares, palestiniennes, tibétaines ou baltes… »).
Puis il pose cette bonne question : Comment en sortir ?
« Accepter l’âme double de la France…-dit Paoli- …et réinstaurer un lien vivant des Français de toutes origines avec leur propre histoire ».
On ne peut bien sûr qu’approuver. En pointant du doigt le fait que la France est le seul grand pays d’Europe régi par un système qui se soit pensé et construit à ce point en dehors et contre son Histoire millénaire. En rupture radicale avec elle. Et l’on ne peut que constater que l’on ne voit cela nulle part ailleurs, en Europe.
On emploie souvent le terme, dans d’autres domaines, d’exception française. Dans le domaine politique, n’y a-t-il pas une exception républicaine, propre à la République française ?
Ce qui amène à une autre question : peut-il y avoir en France, pourra-t-il y avoir un jour, une bonne République ? Après tout les Allemands, les Suisses et bien d’autres sont gérés par une République, et ne s’en portent pas si mal. Qu’est-ce qui fait donc que, chez nous, deux cent vingt ans après la Révolution, nous persistons, nous, à contester le système qui en est issu ? Mais que d’autres, ici en l’occurrence Paul-François Paoli, s’interrogent sur ce qu’il faut bien appeler un mal, sinon ils n’en parleraient pas ?
A-t-on ce débat en Suisse ? en Allemagne ?…
(2) : Le titre de l’un de ses ouvrages n’est-il pas Quand les français ne s’aimaient pas ?…
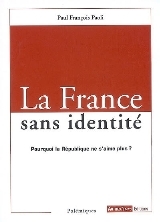













Dans la crise généralisée des institutions et des grands systèmes d’intégration sociale et de l’effondrement de l’Etat nation on voit réapparaître, sous forme de communautés et de réseaux, une formidable soif de réenracinement.
La société civile se restructure en recréant des groupes qui cherchent à remédier à l’indifférenciation croissante, au laminage systématique, en réintroduisant de l’altérité dans la vie quotidienne et locale, en recourant à la démocratie directe et au principe de subsidiarité.
Ce phénomène, par sa rapide extension, montre à lui seul que l’on est déjà sorti de la modernité.
Le désir d’égalité, fut la grande passion des temps modernes.
Celle des temps postmodernes sera le désir d’identité.
Si je comprends bien le dernier commentaire de Sebasto, les nations n’ont pas ou plus de capacité à être un facteur d’identité et d’enracinement, elles ne peuvent pas constituer un remède à « l’indifférenciation, au laminage systématique ». Le « désir d’identité » leur est interdit ou impossible.
La déchéance du politique et bien d’autres facteurs de dissolution, peuvent, en effet, accréditer cette opinion.
Il faudrait donc faire confiance à la « société civile », aux « communautés » qui la constituent, aux « réseaux » qu’elles génèrent, pour échapper au laminage et à l’indifférenciation …
Pourtant, sont-elles en meilleur état que les « institutions » et les Etats eux-mêmes ? Ne sont-elles pas tout aussi décomposées ?
Je crains fort, en fait, que les « identités » et l' »enracinement » dont elles sont, aujourd’hui, capables par elles-mêmes, ne vaillent pas mieux que tout le reste; et que leur capacité de résistance au « laminage » et à l' »indifférentiation » ne puisse être, en réalité, quelles que soient les apparences qu’elles prendront, que d’une extrême débilité.
Mon cher Reboul, je crois que la richesse d’un peuple ou d’une nation que l’on peut définir par son identité, n’est pas seulement la somme de son histoire, de ses moeurs et de ses caractères dominants mais aussi sa faculté d’adaptation face à l’évolution de son environnement.
Comme l’écrit Philippe Forget, » un pays peut apparaître, de prime abord, comme un ensemble de caractères déterminés par moeurs et coutumes, facteurs ethniques, géographiques, linguistiques, démographiques, etc. Pourtant, si ces facteurs peuvent apparemment décrire l’image ou la réalité sociale d’un peuple, ils ne rendent pas compte de ce qu’est l’identité d’un peuple comme présence originaire et pérenne.
C’est donc en terme d’ouverture du sens qu’il faut penser les fondations de l’identité, le sens n’étant autre que le lien constitutif d’un homme ou d’une population et de leur monde.
Il ne s’agit pas d’appréhender l’identité comme un contenu immuable et fixe, susceptible d’être codifié et de faire l’objet de canons.
A l’encontre d’une conception conservatrice de la tradition, qui la conçoit comme une somme de facteurs immuables et transhistoriques, la tradition, ou plutôt la traditionalité, doit être ici entendue comme une trame de différences qui se renouvellent et se régénèrent dans le terreau d’un patrimoine constitué d’un agrégat d’expériences passées, mis en jeu dans son propre dépassement.
En ce sens, la défense ne peut et ne doit pas être attachée à la protection de formes d’exister postulées comme intangibles ; elle doit bien plutôt s’attacher à protéger les forces de métamorphose d’une société à
partir d’elle-même ».
Lecture faite de la citation de Philippe Forget, que je ne peux m’empêcher de trouver écrite dans un style confus et alambiqué, il me semble que l’on a peu avancé.
Qu’est-ce donc qui rend compte de l’identité d’un peuple ? Est-ce que, même, cette identité existe, si elle est à ce point multiforme, floue, sans limite, que ses contours, en perpétuelle évolution et « dépassement » ne sont pas identifiables ?
Chacun sait que rien n’est absolument pérenne, immuable et fixe. Ce serait, en effet, une conception mortelle de la tradition.
Mais, si, à l’inverse, une société s’attache, avant tout, à « protéger les forces de métamorphose », il y a peut-être quelques chances qu’assez rapidement ce ne soit plus « à partir d’elle-même ». D’ailleurs, encore faudrait-il que cet « elle-même » ait un sens, si rien de pérenne ne la constitue …
Mon cher Reboul, défendre son identité, ce n’est pas se
contenter d’énumérer rituellement des points de repère historiques supposés fondateurs, ni chanter le passé pour mieux éviter de faire face au présent.
Mais c’est plutôt, à mon sens, comprendre l’identité comme ce qui se maintient dans la différence et comme la possibilité de changer – ou de ne pas changer.
Fort intéressant débat que ce dialogue entre Reboul et Sébasto. Il est vrai que nous avons eu tendance, par exemple avec Fustel de Coulanges, à imaginer un Ancien Régime où l’équilibre entre pouvoirs aboutissait à une paix sociale harmonieuse sans détruire les corps, alors que ceux-ci étaient en fait en lutte permanente, une lutte qui les faisait disparaître ou les exaltait. En somme, la tradition, c’est la vie, qui se continue et se termine par la transformation et quelquefois la mort. Cela dit, entre la nation et les communautés, faut-il choisir? Je ne le pense pas. Tout combat identitaire est bon, du moment qu’il combat le modèle indifférentialiste ; encore faut-il faire preuve, à cet égard, de volonté. Or la volonté est, par principe, étrangère aux moteurs de la tradition.
Tout à fait d’accord mon cher Antiquus.
Comme le constate René Girard » ce dont les hommes ont peur, c’est de l’indifférenciation, et cela parce que l’indifférenciation est toujours le signe et le produit de la désintégration sociale ».
Les idéologies dominantes issues des lumières croient que l’homogénéisation du monde ne pourrait avoir qu’une fonction pacifiante parce qu’elle permettrait une meilleure « compréhension « .
On voit au contraire comment, partout, elle suscite en retour des crispations identitaires, réveille des irrédentismes et des nationalismes séculaires.