
PAR MATHIEU BOCK-CÔTÉ.
 Cette chronique est parue dans Le Figaro de ce matin du 2 juillet. Dans sa bonne tradition, toute littérature, tout effort intellectuel ou esthétique, est « antimoderne ». Molière l’était lorsqu’il critiquait le ridicule des précieux, le sordide des faux dévots, l’idolâtrie de l’Argent des avares, ou le « grand seigneur méchant homme » défini comme « grand malheur ». En ce sens, comme Baudelaire ou Boutang, il nous est toujours apparu que Mathieu Bock-Côté doit être classé parmi les antimodernes de cette lignée-là. On le verra ici où se mesure jusqu’à quelles conséquences personnelles, sociales et anthropologiques, il pousse peu à peu sa critique foncière du débraillé. Remarquable !
Cette chronique est parue dans Le Figaro de ce matin du 2 juillet. Dans sa bonne tradition, toute littérature, tout effort intellectuel ou esthétique, est « antimoderne ». Molière l’était lorsqu’il critiquait le ridicule des précieux, le sordide des faux dévots, l’idolâtrie de l’Argent des avares, ou le « grand seigneur méchant homme » défini comme « grand malheur ». En ce sens, comme Baudelaire ou Boutang, il nous est toujours apparu que Mathieu Bock-Côté doit être classé parmi les antimodernes de cette lignée-là. On le verra ici où se mesure jusqu’à quelles conséquences personnelles, sociales et anthropologiques, il pousse peu à peu sa critique foncière du débraillé. Remarquable ! ![]()
CHRONIQUE – Selon le sociologue québécois, le refus volontaire de l’élégance et la goujaterie dans lequel s’abîment plusieurs députés Nupes traduit leur vision du monde.
La grâce n’est pas donnée à tous, et la plupart d’entre nous avons besoin de la tradition pour nous apprendre à vivre.
Ces derniers jours, deux groupes de députés qui ne refusent pas nécessairement de se faire appeler populistes sont entrés à l’Assemblée nationale. Mais s’ils se réclament tous les deux du peuple, ils ne s’en font pas la même idée.
On l’a d’abord vu chez les députés du RN, qui avaient reçu la consigne de se vêtir correctement, les hommes devant s’y présenter en costume cravate, les femmes en tailleur ou autre tenue semblable. Il fallait se plier aux codes de l’institution, en respecter les usages, ce qui pour le commun des mortels va de soi. On ne se présente pas en tongs et bermuda à un entretien d’embauche. Et on ne se présente pas à l’Assemblée nationale en bras de chemise. Hélas, ces évidences de bon sens n’en sont pas pour une bonne partie du contingent parlementaire de La France insoumise, qui ne voit rien de solennel dans le fait d’entrer à l’Assemblée, et qui s’y est présentée de la manière la plus débraillée qui soit – on a tout de suite compris qu’il s’agissait d’un débraillé militant, qui consiste à faire un pied de nez à l’institution où on met les pieds, manière comme une autre de la soumettre et d’en prendre possession.
Certains osent même dire qu’ils arrivent à l’Assemblée en s’habillant comme le peuple. Ils oublient que le peuple sait respecter les usages et distingue une tenue de soirée d’une tenue de barbecue. Ils témoignent ici surtout d’une conception plébéienne du peuple. N’en soyons pas surpris : la gauche idéologique a autrefois critiqué la culture humaniste en la réduisant à une culture bourgeoise, qu’il fallait pour cela déconstruire parce qu’elle biaisait la société à l’avantage des privilégiés. C’est pour la même raison qu’elle marque son mépris de l’élégance.
L’élégance est un souci de l’autre
Cette petite polémique moins superficielle qu’il n’y paraît cache une grande querelle. Appelons-la la querelle de l’authenticité. Elle pose la question de notre rapport aux normes sociales. Ces dernières sont-elles civilisatrices, ou oppressives ? La civilisation est-elle une œuvre patiente, qui évolue, mais prétend chaque fois imposer une forme à l’informe, tirer vers le haut l’être humain, en le forçant à se tenir droit, ou n’est-elle finalement qu’une conspiration contre notre liberté originelle ?
Le progressisme des dernières décennies a rompu avec cette exigence de tenue, au nom d’une éthique de l’authenticité qui renverse le rapport à la norme sociale. L’enfer, c’est les autres, affirme notre contemporain, et c’est en m’arrachant aux normes sociales que je pourrai, en plongeant au fond de moi-même, trouver ma vérité intérieure, renouer avec elle, et revenir au cœur de la cité enfin émancipé, délivré. Il croit même pouvoir congédier la part de la nature en lui.
On oublie pourtant que l’homme qui n’est plus que lui-même, renonçant à l’héritage comme aux usages, et se croyant maître et créateur de son monde, n’est souvent plus grand-chose: un petit tas de ressentiment obsédé par sa singularité introuvable. La grâce n’est pas donnée à tous, et la plupart d’entre nous avons besoin de la tradition pour nous apprendre à vivre. Ignorant qu’on se construit à partir de ce que la civilisation nous offre, naturellement à partir de ses dispositions personnelles, l’homme contemporain ne se construit pas.
Je ne serai que moi, mais je serai absolument moi : telle est la conviction de notre contemporain, qui consent ainsi, derrière un vernis philosophique, à un relâchement fainéant, et qui se donne aussi le droit de verser ainsi dans la pire goujaterie, par exemple, en refusant de serrer la main à un adversaire. Un homme qui se comporterait ainsi nous rappellerait qu’il n’est pas un homme mais un individu en crise d’adolescence. La goujaterie aime s’anoblir en fanatisme grossier.
La tenue n’est pas une affaire de coquets. L’élégance est un souci pour l’autre. Qui porte la cravate à l’Assemblée ou même en société envoie le signal qu’il respecte les codes mais aussi qu’il sait distinguer l’intime du public. Il n’est demandé à personne d’être un dandy : il est demandé à tous de faire un effort. Et chacun saura ensuite, en jouant avec ces normes, ajouter sa touche personnelle, comme il en a toujours été.
Il n’est pas interdit de croire qu’au-delà de la mouvance insoumise certains commencent à le ressentir. Ce qu’on appelle aujourd’hui le renouveau de l’art sartorial, autrement dit, le souci de l’élégance masculine, témoigne toutefois peut-être d’une prise de conscience qui dépasse simplement le désir de s’habiller adéquatement. S’il demeure minoritaire, on peut croire qu’il rejoint une exigence intérieure qui n’a rien de frivole.
Quoi qu’on en pense, le vêtement est un langage, un signal envoyé à la société, et nul besoin d’être un partisan du « c’était mieux avant » pour constater, en regardant une photo d’époque, que les hommes d’hier savaient se tenir et que ceux d’aujourd’hui sont, comme on dit, déconstruits. ■
Mathieu Bock-Côté
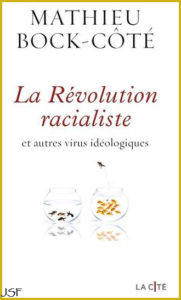 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l’auteur d’Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois(éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Ses derniers livres : Le multiculturalisme comme religion politique, aux éditions du Cerf [2016] – le Le Nouveau Régime(Boréal, 2017) – Et La Révolution racialiste et autres virus idéologiques, Presses de la Cité, avril 2021, 240 p., 20 €.
Sélection photos © JSF













Cette tendance qui consiste à ne pas faire l’effort d’être propre et habillé avec élégance dans le but de « faire peuple » est en fait méprisante et insultante. Lorsqu’on atteint certaines fonctions patronales ou politiques il est indispensable d’honorer sa position par une tenue appropriée. Chaque profession à la sienne et on n’entre pas dans un bloc opératoire en bleu de travail . Idem à l’Assemblée Nationale où par respect pour le lieu et la profession une tenue négligée est une insulte qui ne touche que son auteur.
Le débraillé est un phénomène typique de la civilisation démocratique où règnent narcissisme et soi-mêmisme pour reprendre l’expression forgée par Renaud Camus. Je pense d’abord à moi, j’ai chaud, je vais faire cours en bermuda, j’ai mal aux pieds, je vais plaider au tribunal en baskets, j’ai soif, je me promène en ville avec une bouteille d’eau vissée à la main. La correction vestimentaire et même l’élégance manifestent non pas seulement des codes sociaux » de classe » comme le dit la pensée progressiste, mais le souci d’autrui comme le dit justement Bock-Côté. On ne se vêt pas pour soi, mais pour les autres, ce que ne comprend plus l’homme moderne. Ce débraillé se manifeste aujourd’hui par un phénomène remarquable : la prolifération du tatouage et l’on voit des péronnelles dont la seule ambition paraît être de ressembler à un membre de gang latino de Los Angeles, les bras et les jambes couverts de ces hideuses décorations dont on n’ose même pas imaginer l’aspect lorsque ces dindes seront septuagénaires. Mais homo democraticus ne se caractérise pas seulement par le débraillé vestimentaire, mais aussi par le débraillé langagier, il suffit d’écouter le premier magistrat de la cité dire qu’il a très envie … d’emmerder les non-vaccinés, ou ces journalistes peinant à construire des phrases dans un français correct, on ces universitaires qui dans des interviews paraissent considérer la langue de la racaille de banlieue comme un modèle. Débraillé des moeurs, qui nous vient d’Amérique, où on s’appelle par son prénom dès la première rencontre, où on se tape sur l’épaule pour se saluer. Le philosophe Adorno, chassé d’Allemagne par le nazisme et réfugié en Californie notait avec un certain effroi la violence qui sous-tendait cette familiarité. Les terroristes de 93 ne disaient-ils pas que la politesse était aristocrate ? Tutoiement obligatoire et sans-culotisme vont de pair. Débraillé de la pensée lorsqu’on entend des débats où plus personne ne paraît savoir ce qu’est une argumentation et où l’invective remplace l’idée réfléchie. Un philosophe par ailleurs peu fréquentable disait d’une façon assez amusante que ce n’était pas un hasard si le sport favori en civilisation démocratique était le ski : quand on skie, on est sûr d’aller vers le bas. Nous sommes dans le monde de l’avachissement généralisé, et la rencontre d’une femme élégante dans la rue nous rappelle avec émotion un monde qui s’enfuit. Ces députés de la France mal mise, pardon, de la France insoumise ne sont que l’expression la plus fidèle de nos moeurs.