
XVIII.
Le lendemain matin, quand Platonida entra dans la chambre, elle le trouva dans la même position. Sa faiblesse n’avait pas diminué, et il préféra rester au lit. La pâleur de son visage déplaisait surtout à Platonida.
– Mon Dieu, Seigneur ! pensa-t-elle, pas une goutte de sang aux joues, et il refuse du bouillon ; le voilà là, couché, il ne fait que sourire et assurer qu’il se porte tout à fait bien ! Mon Dieu, qu’est-ce que cela signifie ?
Aratov refusa également de déjeuner.
– Qu’est-ce, Yacha ? demanda Platonida. As-tu l’intention de rester couché comme ça tout le jour ?
– Pourquoi pas ? répondit Aratov d’un air caressant.
Cet air caressant déplut encore à Platonida. Aratov avait l’air d’un homme qui vient d’apprendre un grand secret, très heureux pour lui et qu’il cache avec un soin jaloux. Il attendait la nuit, non avec impatience, avec curiosité.
– Quoi encore ?… se demandait-il. Qu’est-ce qui peut encore arriver ?
Il avait complètement cessé de s’étonner ; il ne doutait plus qu’il fût entré en communication avec l’âme de Clara. Il doutait aussi peu de leur amour mutuel… Mais quel peut être le résultat d’un pareil amour ? Il se rappelait ce baiser, et une sorte de froid rapide et doux lui parcourait tous les membres.
Roméo et Juliette n’ont pas échangé un plus beau baiser, pensait-il. Mais, une autre fois, je saurai mieux résister. Elle viendra à moi avec une couronne de petites roses sur ses cheveux noirs…
Mais, plus loin, ensuite ?
Nous ne pouvons cependant pas vivre ensemble !… Il faudra donc que je meure pour être avec elle ! N’est-ce pas pour cela qu’elle est venue, et n’est-ce pas ainsi qu’elle veut me prendre ?
Eh bien, quoi ! mourir ? la mort ne m’effraye nullement. Elle ne peut pas me détruire. « Où est, Mort, ton aiguillon ? » Au contraire, ce n’est que comme cela, et là, que je serai heureux, comme je ne l’ai jamais été dans ma vie, comme elle non plus ne l’a jamais été !… Car nous sommes vierges tous les deux !…Oh ! ce baiser !
Il y a des gens, pensait-il encore, qui, s’ils apprenaient tout ceci, me prendraient pour un fou. Si ces gens savaient quelle sérénité règne à présent dans mon esprit !
Et il souriait de nouveau.
Platonida entrait sans cesse dans la chambre d’Aratov, ne le tourmentait pas par des questions, le regardait, murmurait, soupirait, et s’en allait bien vite pour revenir aussitôt. Mais le voilà qui refuse aussi de dîner… Cela devenait grave ! Elle alla chercher le médecin du quartier, en qui on avait confiance par la seule raison qu’il ne buvait pas d’eau-de-vie et qu’il avait épousé une Allemande. Aratov fut étonné lorsqu’elle le lui amena ; mais Platonida se mit à supplier si instamment son Yachinka de permettre à Paramon Paramonitch, – ainsi se nommait le médecin, – de le visiter, ne fût-ce que pour elle, qu’Aratov consentit. Paramon Paramonitch lui tâta le pouls, lui regarda la langue, posa quelques questions, et finit par déclarer qu’il était nécessaire de procéder à une auscultation. Aratov était dans une disposition d’humeur si conciliante, qu’il y consentit également. Paramon Paramonitch lui découvrit avec délicatesse la poitrine, la frappa, y appliqua son oreille, fit deux hum ! hum ! bien sentis, et prescrivit des gouttes et une potion ; il conseilla surtout au malade de rester tranquille et de se garder de toute émotion forte.
« Tu t’y prends trop tard, mon bon », pensa Aratov.
– Voyons, qu’a Yacha ? demanda Platonida sur le seuil de la porte, en fourrant un assignat de trois roubles dans la main de Paramon Paramonitch.
Le médecin du quartier qui, comme tous nos docteurs d’aujourd’hui, surtout ceux qui portent l’uniforme, aimait à briller par des termes scientifiques, lui déclara que le neveu offrait tous les symptômes dioptriques d’une névrose cardialgique, et que, en outre, il y avait de la fébrilité.
– Parle plus simplement, petit père, dit Platonida avec sévérité. Ne nous effraye pas avec ton latin, tu n’es pas chez un apothicaire.
– Le cœur n’est pas en ordre, se hâta d’expliquer le médecin, et il y a aussi un peu de fièvre.
Puis il répéta sa recommandation de modération et de tranquillité.
– Mais il n’y a pas de danger ? demanda avec la même sévérité Platonida. Et ne te refourre pas dans ton latin !
– Jusqu’à présent, il n’y en a pas.
Platonida resta tout interdite. Elle envoya chercher les médicaments, mais, malgré toutes ses prières, Aratov refusa de les prendre. Il refusa même le thé pectoral !
– Pourquoi vous agitez-vous ainsi, ma petite colombe ? lui disait-il. Je vous jure que je suis à présent l’homme le plus heureux et le mieux portant de toute la terre.
Platonida ne faisait que hocher la tête. Vers le soir, il eut un peu de chaleur, mais il exigea qu’elle ne restât pas dans la chambre et qu’elle allât dormir chez elle. Platonida obéit, mais ne se déshabilla ni ne se coucha. Assise dans son fauteuil, elle tendait l’oreille et murmurait ses prières.
Elle allait pourtant s’endormir, quand un cri terrible, un cri déchirant, la réveilla en sursaut. Elle se précipita dans la chambre d’Aratov, et, comme la veille, le trouva par terre, évanoui.
Mais il ne revint pas à lui comme la veille, quoi qu’on fit. Un transport au cerveau se déclara, compliqué d’une inflammation du cœur. Quelques jours plus tard, il était mort.
Une circonstance étrange accompagna ce second évanouissement. Quand on le coucha dans son lit, on trouva dans sa main droite fermée une petite boucle de cheveux noirs de femme. D’où venait cette boucle de cheveux ? Anna Séméonovna avait bien une pareille boucle qui lui était restée de Clara, mais pourquoi aurait-elle donné à Aratov une chose qui lui était si précieuse ? L’avait-elle mise par mégarde dans le journal de sa sœur, et l’y avait-elle oubliée ?
Dans son délire, Aratov se donnait le nom de Roméo après l’empoisonnement ; il parlait de son mariage accompli et réalisé, de la jouissance suprême qu’il connaissait à présent…
Bien affreux fut pour la pauvre Platocha le moment où Aratov, revenu à lui pour un instant et l’ayant aperçue auprès de son lit, lui dit :
– Tante, pourquoi pleures-tu ? De ce que je dois mourir ? Ne sais-tu donc pas que l’amour est plus fort que la mort ? Ce n’est pas pleurer, c’est se réjouir qu’il faut… se réjouir comme je le fais maintenant.
Et, de nouveau, sur le visage du mourant rayonna ce sourire de béatitude qui resserrait si douloureusement le cœur de la pauvre vieille. ■ (FIN).
Ivan TOURGUENIEV, Après la mort.
Paru dans La Nouvelle Revue en 1883.
Textes et images rassemblés par Rémi Hugues.
Nouvelle à paraître à l’automne 2022 éditée chez B2M.
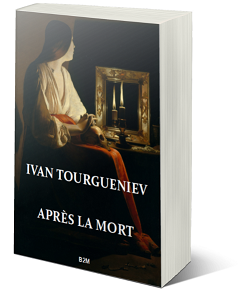
Commande ou renseignement : B2M – Belle-de-Mai Éditions commande.b2m_edition@laposte.net











