Il faut être reconnaissants à Jean-François MATTEI, avons-nous dit, d’avoir écrit « Le regard vide – Essai sur l’épuisement de la culture européenne ». Et, en effet, il faut lire et relire ce livre, le méditer, en faire un objet de réflexion et de discussions entre nous. Il dit, un grand nombre de choses tout à fait essentielles sur la crise qui affecte notre civilisation – et, bien-sûr, pas seulement la France – dans ce qu’elle a de plus profond.
Ce livre nous paraît tout à fait essentiel, car il serait illusoire et vain de tenter une quelconque restauration du Politique, en France, si la Civilisation qui est la nôtre était condamnée à s’éteindre et si ce que Jean-François MATTEI a justement nommé la barbarie du monde moderne devait l’emporter pour longtemps.
Le regard vide – Essai sur l’épuisement de la culture européenne, de Jean-François Mattéi. Flammarion, 302 pages, 19 euros.

La perversion du mouvement
(Chapitre intégral, pages 158/159/160/161/162/163/164).
La translatio imperii devenue translatio studii, puis sur le plan mondial translatio belli, constitue à l’évidence le modèle mythique et rationnel du développement de l’Europe. Pourtant, de translations en translations, emportée par son culte du mouvement, la civilisation européenne a fini par dévoyer l’élan qui haussait son regard à la hauteur de l’Idée pour le rabattre sur l’horizon de l’histoire. Et cet horizon s’est trouvé paradoxalement bouché par une ouverture qui ne donnait sur rien sinon sur « un formidable champ de ruines » selon l’expression de Nietzsche (1). Cet effondrement ne concerne pas seulement la religion chrétienne, le dernier édifice romain désormais veuf de fidèles, mais la culture européenne emportée dans un tourbillon dénué de toute fin. Un projet de préface pour La Volonté de puissance, consacré à l’avènement du nihilisme, témoigne de ce courant déchaîné qui emporte l’Europe, et le monde avec elle, vers le néant.
« Notre culture européenne toute entière se meurt depuis longtemps déjà, avec une torturante tension qui croît de décennies en décennies, comme portée vers une catastrophe : inquiète, violente, précipitée : comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche plus à revenir à soi, qui craint de revenir à soi » (2).
La perversion de son mouvement est la perversion d’un regard qui, privé de but, se perd dans le vide et ne parvient plus à surmonter son épuisement. Il devient alors étranger à ses propres principes dans cette fuite désespérée en avant qui portera le nom trompeur de progrès. Tocqueville a le premier attiré l’attention sur « le mouvement perpétuel » qui règne au sein des démocraties et qui tend à modifier sans cesse la forme de la langue comme le contenu des pensées. Il dépeint à son époque, certes, la démocratie américaine, mais il généralise ses analyses à toutes les sociétés démocratiques qui, insiste-t-il, « aiment le mouvement pour lui-même », comme le montrent l’état de la langue et celui de la politique. Cette « agitation générale » renforcée par le développement de formules abstraites qui utilisent des termes génériques pour dire plus rapidement les choses – « la force des choses veut que les capacités gouvernent », note-t-il avec ironie (3) – précipite la marche vers l’égalité des peuples européens. Toutes les révolutions et contre-révolutions qui ont bouleversé l’Europe, « tous ces mouvements », qui ont détruit les pouvoirs intermédiaires traditionnels ont contribué à renforcer les Etats en égalisant les conditions sociales de sorte que « chaque pas que (les nations, ndlr) font vers l’égalité les rapproche du despotisme » (4). Contrainte par la puissance du mouvement d’égalité, de plus en plus rapide et de plus en plus uniforme, l’évolution de l’histoire a paradoxalement pris appui sur un foyer de centralisation qui a été « le seul point immobile au milieu de la mobilité singulière » des existences et des pensées des hommes.
Je voudrais vérifier la justesse des analyses de Tocqueville en revenant à la description qu’Edgar Poe donnait de l’homme moderne dans sa nouvelle The man of the crowd. Elle illustre le destin de l’homme des foules, dans une cité comme Londres, lorsque la population s’accroît à la tombée du jour et s’écoule dans les rues selon des courants contraires et anonymes. Le narrateur, ou Poe lui-même, se trouve dans la position traditionnelle de l’homme européen dont le regard examine avec recul le spectacle qui s’offre à lui. « Mes pensées prirent d’abord un tour abstrait et généralisateur. Je regardais les passants par masse et ma pensée ne les considérait que dans leurs rapports collectifs » (6). Parmi cette multitude d’hommes d’affaires, de commis, de marchands, de filous ou de joueurs de profession, de colporteurs et d’invalides, la foule se fondant en une masse amorphe et indistincte, le narrateur est soudain saisi par la physionomie étrange d’un vieillard qui passe devant la fenêtre du café où il est assis. Il se précipite dehors et se met à le suivre. L’homme traverse un lacis de rue, revient sur ses pas, tourne et retourne sans but apparent, et erre sans dire un mot parmi les groupes de passants de plus en plus rares à mesure de l’avancée de la nuit. « Il entrait successivement dans toutes les boutiques, ne marchandait rien, ne disait pas un mot, et jetait sur tous les objets un regard fixe, effaré, vide » (7). Jusqu’au point du jour, dans des cohues de plus en plus lointaines et de plus en plus rares, le vieillard arpentera les ruelles et les artères, courant d’un air désespéré jusqu’à ce qu’il retrouve un embryon de foule. Poe voit dans cet homme absorbé dans un mouvement sans commencement ni fin, qui reprend sans espoir chaque jour, l’homme qui a peur de rester seul et qui n’existe que dans la proximité des autres. On peut y déceler aussi la métaphore du regard de l’homme européen, incarné par le narrateur, qui cherche à donner un sens à cette fuite aveugle de l’homme démocratique. Il est prêt à se fondre dans ce que Tocqueville nomme « une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et de vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme ». Et Tocqueville d’ajouter, à la fin de son ouvrage, ces phrases qui auraient pu être écrites par Poe :
« Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d’êtres pareils, ou rien ne s’élève ni ne s’abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m’attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n’est plus » (8).
Nous sommes en présence, sous une double forme sociale et politique, de la pathologie européenne du mouvement intellectuel. Chesterton pensait que le monde moderne était envahi par « de vieilles vertus chrétiennes devenues folles » (9) ; on en dira autant de l’élan de pensée qui les avait apportées. Ce que Sloterdijk a analysé sous la forme de la « mobilisation infinie » et de la « mytho-motricité de l’Europe », dans l’optique de la « mobilisation universelle » de Jünger, Mobilmachung, et du « dispositif » technique de Heidegger, Gestell, qui se sont emparés du monde est la déformation tardive de l’auto-motricité de l’âme platonicienne. Cette âme était toujours en mouvement parce qu’elle était vouée au processus infini de la connaissance ; mais elle gardait son regard fixé sur les Formes en un ancrage supérieur qui interdisait toute dérive. L’ancre retirée, le mouvement pris pour lui-même devient fou et débouche sur la destruction systématique de la réalité. Dans sa Logique du sens, Gilles Deleuze a théorisé un tel mouvement de la modernité en appelant explicitement, contre Platon et son éloge du peras et du metrion, à choisir « un pur devenir sans mesure, véritable devenir fou qui ne s’arrête jamais », et il a attribué ce devenir illimité, qui évite le présent pour confondre le futur et le passé à « la manière du simulacre en tant qu’il esquive l’action de l’Idée » (10). C’est un semblable flux nihiliste et chaotique, dont la forme métaphysique avait été annoncée par Nietzsche, qui a emporté l’Europe politique dans la logique de mort des deux conflits mondiaux. On le retrouve dans le flux de destruction des guerres européennes, et ses dizaines de millions de morts qui n’étaient pas des simulacres, mais aussi dans le courant des discours révolutionnaires qui soutenaient, selon le mot d’Edouard Bernstein, que « le but final, quel qu’il soit, n’est rien ; le mouvement est tout » (11). C’est ce vertige de démesure qui a emporté les deux grands mouvements totalitaires que l’Europe a produits au XXème siècle sur les renoncements de la démocratie.
L’idée européenne de l’homme, issue du platonisme et du christianisme, a bien été pervertie par les mouvements de pensée rivaux qui ont détruit les fins mêmes qu’ils se proposaient d’atteindre, l’édification d’un homme nouveau et celle d’un monde meilleur. Lévinas s’est interrogé sur « la décision originelle » (12) qui a permis, avec l’avènement de l’hitlérisme, la régression de l’Europe dans la barbarie. Cette décision originelle, qui rompait avec toute la tradition humaniste, peut s’appliquer également au communisme. Les deux idéologies, en dévoyant l’idée platonicienne d’âme en un simulacre de sujet, ont obéi à la loi impitoyable du mouvement qui voit dans l’être humain l’effet de l’évolution biologique de la race ou de l’évolution historique de la classe. Si le monde n’est qu’un processus, et les actions humaines des procédures, sans qu’aucune fin soit assignée au cycle biologique comme au mouvement historique, le regard porté sur la race ou sur la classe, abandonnant tout exigence de reconnaissance spirituelle, ne décèle plus dans l’homme qu’une donnée matérielle. L’individu réel, fondé dans l’espèce sous la forme grossière de la Race et de la Classe, se trouve effectivement détruit par la force aveugle d’un devenir-fou. Quand la politique totalitaire élimine les fins au profit des processus, la solution qu’elle impose ne peut être qu’une solution finale. Je renvoie ici aux analyses classiques de Hannah Arendt dans Le Système totalitaire. Elle montre que la Terreur qui a frappé le monde était « la réalisation de la loi du mouvement » parce que son principe revenait à ce que « la force de la Nature ou de l’Histoire puisse emporter le genre humain tout entier dans son déchaînement » (13). La fureur de l’universel, pour le communisme, et la démence du particulier, pour le nazisme, ont constitué tous deux, sur les ruines de l’esprit européen, des lois du mouvement qui déniaient toute fin et toute stabilité aux actions des hommes. Tout devient effectivement insensé quand la nature et l’Histoire ne sont plus garantes de la stabilité de la vie humaine, mais sont en elles-mêmes des forces aveugles qui emportent et détruisent la masse indifférenciée des individus, non plus par un appareil répressif d’Etat, mais par « un mouvement constamment en mouvement ».
(1) : F. Nietzsche, Le Gai Savoir, op. cit., livre V, § 358, page 250.
(2) : F. Nietzsche, Fragments posthumes. Automne 1887 –mars 1888, tome XIII, Paris, Gallimard, 1976, 11 (411), page 362. Souligné par Nietzsche.
(3) : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, I, XVI, Œuvres II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1992, page 557. Souligné par l’auteur.
(4) : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ibid, II, IV, V, page 821.
(5) : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ibid, II, IV, V, page 832.
(6) : E.A. Poe, « L’homme des foules », E.A Poe. Contes. Essais. Poèmes, édition de Claude Richard, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1989, page 506.
(7) : E.A Poe, « L’homme des foules », ibid, page 510.
(8) : A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., page 836 et page 851.
(9) : G.K. Chesterton, Orthodoxie (1908), Paris, Gallimard, 1984, page 44.
(10) : G. Deleuze, Logique du sens, « Du pur devenir », Paris, Minuit , 10/18, 1968, pages 8 et 9.
(11) : E. Bernstein, Die neue Zeit : le mot est rapporté et critiqué par Rosa Luxembourg au Congrès de Stuttgart du parti social-démocrate allemand le 4 octobre 1898.
(12) : E. Lévinas, Quelques réflexions sur l’hitlérisme (1934), Paris, Payot-Rivages, 1997, page 8.
(13) : Hannah Arendt, Le Système totalitaire (1951), Paris, Editions du Seuil, 1972, page 210.



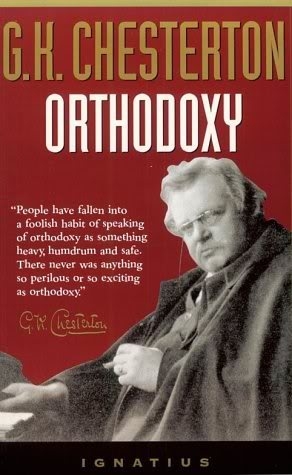
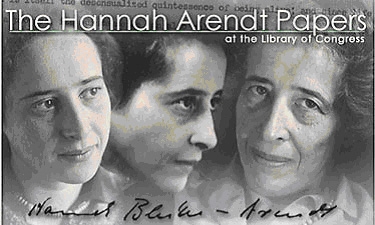












« De nos jours seulement dit Nietzsche,……..on a commencé à envisager sous son vrai jour l’histoire de l’humanité : et la première constatation a été qu’il n’ya jamais eu de plan, ni pour l’homme, ni pour un peuple quelconque ».
La philosophie nietzschéenne démystifie et montre que l’univers n’est soumis à aucune toute-puissance qui lui imposerait une fin et que les hommes font eux-mêmes l’histoire.
En fait la critique fondamentale de Nietzsche atteint la valeur de l' »Etre » platonicien et du Dieu chrétien, qui sont décrits comme les processus de décadence de la civilisation européenne.
En revanche, par la pensée non consolante de l’éternel retour, Nietzsche nous propose de prendre en main notre destin et, contrairement à ceux qui pleurnichent, regarder la réalité en face et la vivre.
La citation de Nietzsche que livre le commentaire de Sébasto ne peut prétendre être davantage qu’une affirmation sans preuve. Elle constitue, en elle-même, une croyance plus qu’autre chose.
Lorsqu’il avance que « de nos jours seulement on a commencé à envisager sous son vrai jour l’histoire de l’humanité », s’agit-il d’un espoir ou d’une constatation ? Les jours qui ont suivi les siens jusqu’aux nôtres ne me semblent nullement confirmer son hypothèse, qui, avec le recul du temps et l’observation de la période moderne, semble une espérance plutôt vaine et, d’une certaine façon, naïve …
En fait, si l’on quitte le seul arrière-monde des concepts, en quoi d’ailleurs l’on s’en tient à un certain platonisme,
il y a un réel paradoxe à affirmer que « l' »Etre » platonicien et le Dieu chrétien sont à l’origine du processus de décadence de la civilisation européenne ». L’un et l’autre ont en effet fondé les deux civilisations les plus abouties et les plus merveilleuses que l’humanité ait connues.
Que l’un et l’autre aient eu, comme le dit Thibon, de très mauvaises retombées ne les disqualifie en aucune façon.
La pensée non consolante de l’éternel retour – si elle a eu quelque influence sur le monde moderne – aboutit au contraire de ce dont Nietzsche avait rêvé …
Ma chère LORI, la dureté extrême de la pensée de l’éternel retour, consiste en ce qu’elle confirme le non-sens de la vie, désespérant par la même ceux qui ont encore besoin d’un absolu.
Eliminant les arrières-mondes elle exige la reconnaissance de la réalité en sa totalité, non par résignation, ni par servilité, mais par force.
L’individu normalement constitué, au lieu d’anathémiser le monde et de s’en détourner, est en effet capable d’approuver la réalité entière. » Les forces les plus hautes, dit Nietzsche, et les plus basses, les choses les plus douces , les plus légères, les plus terribles….. ».
« Représentons-nous, écrit Nietzsche, cette pensée sous sa forme la plus redoutable : l’existence telle qu’elle est, n’ayant ni de sens ni de fin…. ».
Il s’agit d’adhérer à cette pensée sans contrainte aucune et par delà le bien et le mal.
Je persiste dans mon désaccord avec le cher Sébasto.
Paradoxalement, peut-être, je ne crois pas que ce qu’il appelle « la pensée de l’éternel retour », fût-ce dans « sa dureté extrême », soit, elle-même, autre chose qu’un autre absolu, autre chose, elle aussi, quoiqu’elle en dise, qu’un autre arrière-monde consolateur, dispensant les bonheurs qu’elle espère trouver dans les valeurs qu’elle prône, autre chose, en fait, qu’un idéalisme.
C’est pourquoi cette pensée, ce qui, d’ailleurs n’ôte rien à sa valeur, ne confirme rien du tout. Simplement, elle affirme – tout en posant d’ailleurs de hautes ambitions pour l’homme – sa croyance dans le non-sens de la vie.
Qu’on le veuille ou non, ce n’est pas sur cette croyance que se sont fondées et ont duré 25 ou 30 siècles, les civilisations dont nous sommes issus. C’est pourquoi elle me paraît tout à fait idéaliste et a-historique.
Quant à considérer que cette pensée remplacerait les croyances anciennes et viendrait fonder un homme nouveau, une ère nouvelle, il n’est que de considérer le monde tel qu’il s’est développé après Nietzsche, tel qu’il est aujourd’hui, – dont Nietzsche serait sans nul doute fort éloigné – pour se persuader de l’irréalisme d’une telle vision d’avenir.
Ce serait vraiment faire injure à la grande figure de Nietzsche que de lui en attribuer la honteuse paternité.
Ma chère LORI, cette pensée préexistait déjà chez les Grecs, pour lesquels seule l’éternité est réelle. L’être authentique est immuable : le mouvement circulaire qui assure l’éternel retour du même dans une série de cycles successifs est l’expression la plus parfaite du divin.
S’il y a progrès et déclin, c’est à l’intérieur d’un cycle auquel ne peut qu’en succéder un autre.
Avec la Bible, l’histoire devient une dynamique de progrès qui vise, dans une perspective messianique, à l’avènement d’un monde meilleur.
La Genèse assigne à l’homme la mission de « dominer la Terre ». La temporalité est en outre orientée vers le futur, de la Création à la Parousie, du Jardin d’Eden au Jugement dernier. L’âge d’or n’est plus dans le passé, mais à la fin des temps : l’histoire finira, et elle finira bien, au moins pour les élus.
Cette temporalité linéaire exclut tout éternel retour, toute conception cyclique de l’histoire, à l’image de l’alternance des âges et des saisons. Depuis Adam et Eve, l’histoire du salut se déroule selon une nécessité arrêtée de toute éternité, chemine avec l’ancienne Alliance et culmine dans le christianisme.
Je répondrai simplement à Sébasto que nous ne nous sommes pas situés sur le même terrain.
Le sien, en l’occurrence, c’est (selon sa vision) « l’histoire du salut ».
Le mien c’était celui de l’Histoire, tout court. Concrètement l’histoire de la civilisation à laquelle nous appartenons ou appartenions car l’état actuel du monde n’en conserve pas grand chose.