
Par Sacha Cornuel-Merveille
![]() Philit, site qui s’occupe excellemment de philosophie, littérature et cinéma, a publié le 11 décembre ce fort intéressant entretien avec Rémi Soulié à propos de L’Enthousiasme son dernier livre. Les suiveurs de Je Suis Français liront cet entretien avec intérêt et sympathie. De la belle ouvrage !
Philit, site qui s’occupe excellemment de philosophie, littérature et cinéma, a publié le 11 décembre ce fort intéressant entretien avec Rémi Soulié à propos de L’Enthousiasme son dernier livre. Les suiveurs de Je Suis Français liront cet entretien avec intérêt et sympathie. De la belle ouvrage ! ![]()
Essayiste et critique littéraire, Rémi Soulié publie L’Enthousiasme (Éditions de la Nouvelle Librairie, 2024), troisième volume d’une trilogie philosophique commencée avec Racination (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2018) et prolongée avec L’Éther (Éditions de la Nouvelle Librairie, 2022). Ici, l’auteur explore une modalité spirituelle oubliée et, contre les prétentions rationalistes du monde moderne, cherche à montrer qu’elle est une voie d’accès à la réalité la plus authentique.
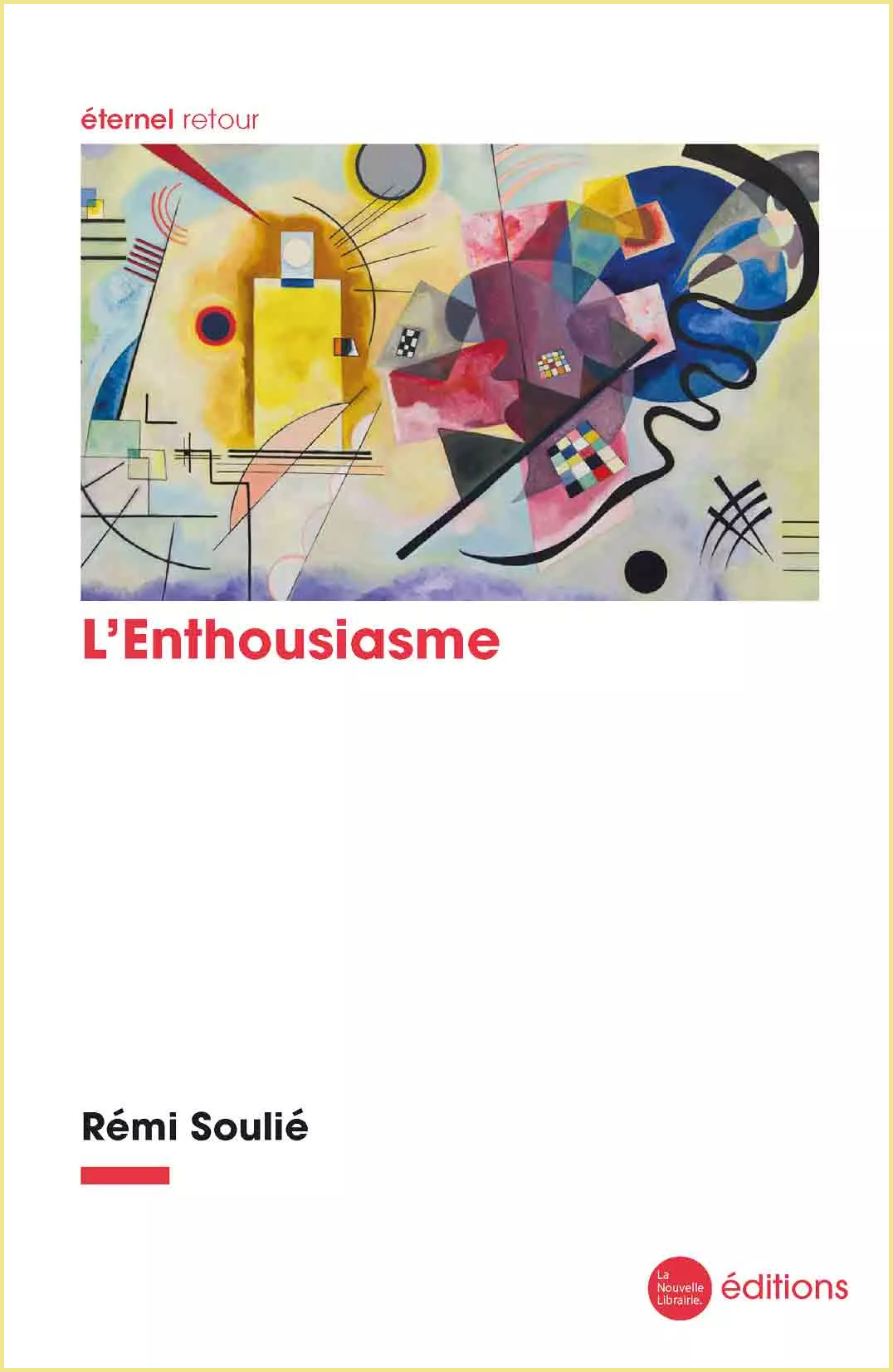 PHILITT : Le terme d’ « enthousiasme » est très largement galvaudé par son emploi actuel. Pourriez-vous revenir sur son étymologie et ce qu’il implique pour vous ?
PHILITT : Le terme d’ « enthousiasme » est très largement galvaudé par son emploi actuel. Pourriez-vous revenir sur son étymologie et ce qu’il implique pour vous ?
Rémi Soulié : L’enthousiasme, en grec, désigne la possession par le dieu, le fait que le dieu soit en soi ou que l’on soit dans le dieu. Qui est dans cet état « vaticine », devient vate, ou scalde, file, aède…poète. L’inspiration du dieu confine avec la folie, la mania, la divine folie, qui excède la raison par le haut – et non par le bas, comme dans la psychose. On pourrait même y voir le signe d’une « grande santé », au sens nietzschéen, Nietzsche ayant connu les deux types de folie, dithyrambique et pathologique.
Aux Modernes, cette façon d’être et de penser paraît doublement surannée : l’inspiration relève de l’illusion idéaliste, classique ou romantique ; l’enthousiasme, de la pensée archaïque, magique, pré-logique, primitive, sauvage, etc. Le progressiste n’a que faire de ces enfantillages, qui relèvent d’une forme d’immaturité neurologique. N’étant pas un dévot des superstitions contemporaines, j’expérimente, je dis bien, j’expérimente – sans concession aucune à l’empirisme – ce que suppose l’enthousiasme : la très grande proximité de l’homme et du dieu (ou de l’ange, dirait-on en langue chrétienne : le métaphysicien, au sens guénonien, est polyglotte). Tel est le sens de ce que Rolland de Renéville, admirable poète et essayiste du Grand Jeu, appelle L’Expérience poétique. Je témoigne de ce que « l’homme passe infiniment l’homme » (Pascal) et que les dualités superposées, dont celle qui sépare l’homme et le dieu, ne sont que de très faibles intensités, malgré les apparences. Je m’empresse d’ajouter que parler, ici, de prométhéisme, serait un contresens total : il ne s’agit pas, pour l’homme, de se faire ou de se croire dieu – avec la démesure que cela implique – mais de s’ouvrir à la métamorphose goethéenne, comme la chenille s’ouvre au papillon.
Contrairement à ce que l’on croit d’ordinaire, les poètes sont les plus grands réalistes : ils voient le monde comme il est, dans sa splendeur et ses ténèbres. L’homme prosaïque, son contraire, mon « homme théorique », espèce pullulante, habite flat land et non la terre, fût-elle « waste », vaine, gaste. Le carmen demeure un puissant moyen de résistance au désenchantement nihiliste. Il est puissance de magie blanche contre les magiciens noirs, les Saruman, qui sont légion. Incantons et contre-incantons à temps et à contre-temps !
Le moraliste Gómez Dávila décrivait le monde moderne comme un « soulèvement contre Platon ». En quoi la poésie du fondateur de l’Académie peut-elle résister à un tel assaut ?
En excédant le temps et ce qu’Eliade appelait la « terreur de l’histoire », dont les Modernes se font une religion. Si l’on pense le temps comme il doit l’être, c’est-à-dire l’image mobile de l’éternité immobile, le monde moderne est épiphénoménal. Certes, il faut faire preuve d’une certaine ascèse pour s’en rendre compte, mais la « grande santé » est à ce prix, cathartique et purgatif (prohibitif, aussi, mais le monde moderne est invasif). Il faut veiller à se maintenir au centre de la roue. Les Dialogues du « divin Platon » relèvent de l’exercice spirituel, de l’itinéraire d’une âme, voire de la prophétie. C’est ainsi, pour rejoindre à nouveau Gómez Dávila, que l’on devient un « traqueur des ombres sacrées sur les collines éternelles », dont La Colline inspirée barrésienne : c’est bien toujours d’inspiration et, même, de spiration enthousiaste qu’il s’agit. Platon ne transige pas sur le « souverain Bien », malgré les sophistes, dont l’engeance démocratique est hélas temporellement…souveraine. Il nous donne certes des arguments dialectiques (parfois socratiquement fastidieux, il faut bien le reconnaître) mais, surtout, il mobilise l’intuition intellective et la réminiscence, l’une et l’autre niées par les Modernes (d’abord amputés de l’esprit, puis de l’âme, puis du corps, selon un processus somme toute logique), afin de maintenir ou de rétablir l’immanence du divin en nous. Platon est le mémorial de l’intellectualité occidentale, d’où l’oubli ou l’assaut.

La figure d’Hermès semble habiter votre œuvre. Qu’a-t-elle à nous dire ?
L’herméneutique du héraut : elle nous délivre les messages des dieux et elle nous en livre les clés interprétatives. Hermès se situe significativement dans la plus grande proximité avec les hommes. Il est le dieu des signes, des correspondances et des analogies, le lieu du lien entre les célestes et les terrestres, le fil d’or qui les relie. La pratique de l’Art royal alchimique, dont il est en quelque sorte le saint patron, autorise notre transmutation, la recouvrance de ce que nous sommes vraiment (chenille et papillon, pour filer la métaphore précédente – Céline insiste beaucoup sur l’Œuvre au noir de la chenille, de la larve, du caniche, non sans raison compte tenu de notre temps). Sa mobilité pourrait sembler contredire ce que j’ai dit précédemment à propos de l’immobilité mais ce n’est pas le cas, pas plus que le temps ne contredit l’éternité : la circulation hermésienne est analogue à la circulation sanguine ; elle tourne, en vase clos (en creuset) dans l’organisme vivant, sur le mode ouroborique (du serpent qui se mord la queue), mais pour mieux désigner le centre immuable, le cœur, et y retourner. Mieux, son centre est partout et sa circonférence nulle part. Comme j’ai parfois l’occasion de le dire, le paradoxe est la forme la plus haute de la pensée.
La mode technicienne est au transhumanisme. Pourriez-vous évoquer la provenance littéraire de ce concept et en quoi celle-ci est l’inverse d’un progrès purement mécanique ?
Je ne me montrerai peut-être pas très bon généalogiste mais je songe au Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Mary Shelley. Le transhumanisme relève de l’électrification de cadavre. Pure parodie, il inverse le rassemblement des membres d’Osiris par Ezra Pound et la métamorphose goethéenne de la chenille en papillon. Il contrefait, avec l’exactitude du calcul – dont il est seulement capable – le trasumanar de Dante, car l’homme n’est augmenté que par le dieu, c’est-à-dire par l’Esprit. Comparativement aux hommes de l’Âge d’or, ceux de l’Âge de fer sont particulièrement diminués et compensent mécaniquement leurs amputations et handicaps spirituels. Je suis frappé du reflux de l’organicité : l’ablation de l’intellect entraîne inéluctablement, à terme, celle du corps. Que reste-t-il ? La raison raisonnante, calculante, soit, la machine (l’ordinateur ordonnateur). Nous y sommes. Heidegger, qui fut l’analyste le plus aigu du phénomène de la machination, ne disait-il pas que la raison est l’ennemie la plus acharnée de la pensée ? J’entends déjà le procès en irrationalisme fascisant que ne manqueront pas de réitérer les Lumineux, mais enfin, de ce point de vue, l’illuminisme et Illuminations me paraissent autrement plus justes.
Un chapitre de votre ouvrage porte sur les « hauts lieux ». Quelle est cette géographie sacrée dont nos contemporains ont perdu la trace ?
L’écriture même du monde orienté, sensé, pourvu d’un sens jamais construit ni provisoire mais qui nous précède et que nous devons percevoir pour nous y accorder. Le Liber mundi est la révélation dévoilante, l’alètheia, non la veritas de l’adéquation entre l’esprit et la chose, dont la visée, incapable de contemplation, se limite à l’emprise. « Il est des lieux où souffle l’esprit », écrit Barrès. C’est bien de cela qu’il s’agit, encore et toujours. Au terme du cheminement, il est d’ailleurs probable que chaque lieu nous apparaisse comme « haut », comme omphalos (le centre partout), ce que traduit William Blake lorsqu’il voit un univers dans un grain de sable. Les Modernes, eux, se réjouissent de leurs périphériques ; ils n’orientent pas mais balisent, fascinés qu’ils sont par le contrôle utilitaire total et, surtout, les myriades d’interdictions qui vont avec : le sens interdit, voilà toute la Loi et les prophètes actuels. C’est ce qui arrive lorsque l’on nie le symbole et qu’on le remplace par la signalétique. Déchéance du Dasein. Ils « sanctuarisent » sur le mode Natura 2000 et de la norme ISO (Organisation internationale de normalisation : ils ne se cachent même pas), après avoir détruit l’idée même de sanctuaire et chassé les nymphes et les fées.
Votre conclusion se place sous la trinité Europe-Occident-Hespérie. Que nous apprend-elle concernant l’avenir ?
Que l’Hespérie virgilienne, les Hespérides de l’ouest, à la différence de l’Europe et de l’Occident, ne passeront pas, qu’elles sont notre terre céleste (l’oxymore est l’allié substantiel du paradoxe), à l’image de ce que furent l’ « État poétique » pour Novalis, l’« Allemagne secrète » pour Stefan George ou l’« Empire du soleil » pour Mistral. Je ne superpose pas ainsi une réalité tangible à une idéalité spirituelle : je les perçois dans leur unité. Nous savons fort bien que « les civilisations sont mortelles » et nous ne connaissons que trop Le Déclin de l’Occident, dont nous assistons à la longue agonie – de surcroît dans le divertissement festif, parmi les décombres. Je partage la « conception lazaréenne de la patrie » de Renaud Camus mais je ne l’entends sans doute pas exactement comme lui : la résurrection est toujours déjà accomplie par et dans l’Ange des nations. Ce qui a été est et sera. La puissance de l’Être est formidable et l’éternité englobe le temps. « Que de merveilles et de quelles merveilles doivent venir ces merveilles ! », s’exclame Plotin, que l’on présente parfois, mille fois hélas, comme un contempteur du monde. Eh bien, l’Idée, la forme divine, rassemblent ou récapitulent tout. Les poètes, qui en sont les réceptacles, les répètent en échos musicaux ; leurs vers sont autant de rayons ou de répons reliant le centre à la périphérie, les barreaux d’une échelle de Jacob que montent et descendent les anges. Je consacre d’ailleurs plusieurs pages à ceux de Rilke et de La Tour du Pin. Cette architectonique fera sourire de commisération les déconstructeurs, c’est-à-dire, les destructeurs, pour lesquels il n’y a ni haut ni bas, ni Orient ni Occident, ni droite ni gauche, hors conventions sémantiques vides, mais peu importe. Hors de question de résister aux Charmes de La Pythie :
Honneur des Hommes, Saint LANGAGE,
Discours prophétique et paré,
Belles chaînes en qui s’engage
Le dieu dans la chair égaré,
Illumination, largesse !
Voici parler une Sagesse
Et sonner cette auguste Voix
Qui se connaît quand elle sonne
N’être plus la voix de personne
Tant que des ondes et des bois ! ■ SACHA CORNUEL-MERVEILLE
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.













