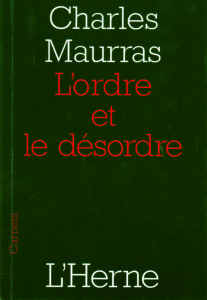Les « Grands Textes » réunis par JSF ont, quelle que soit leur taille, quelque chose de fondamental sur quoi il nous paraît convenir de revenir souvent, qui nous parle dans les circonstances que nous vivons et qu’il est bon de « partager » largement ! En quoi consiste – ou ne consiste pas – l’engagement maurrassien, cela nous est dit ici.
![]() Le grand texte de Charles Maurras que JSF vous propose aujourd’hui, traite avec une impressionnante logique de sujets essentiels. Il s’agit, selon la remarque de l’éditeur, d’une réflexion tardive de Maurras, écrite à Clairvaux vers 1950, à l’écart des polémiques et des turbulences du siècle. Passées les passions de la Libération. Et dans le contexte des balbutiements de l’idée européenne, naissante ou renaissante. L’expression y est celle d’un philosophe de la Politique à la hauteur des plus grands, sans que, pour autant, il cesse d’être passionné de l’avenir français. Il voit peser sur ce dernier d’immenses menaces. Sans désespoir aucun, selon son naturel inchangé.*
Le grand texte de Charles Maurras que JSF vous propose aujourd’hui, traite avec une impressionnante logique de sujets essentiels. Il s’agit, selon la remarque de l’éditeur, d’une réflexion tardive de Maurras, écrite à Clairvaux vers 1950, à l’écart des polémiques et des turbulences du siècle. Passées les passions de la Libération. Et dans le contexte des balbutiements de l’idée européenne, naissante ou renaissante. L’expression y est celle d’un philosophe de la Politique à la hauteur des plus grands, sans que, pour autant, il cesse d’être passionné de l’avenir français. Il voit peser sur ce dernier d’immenses menaces. Sans désespoir aucun, selon son naturel inchangé.* ![]()
* Charles Maurras, L’ordre et le désordre, L’Herne, Paris, 2007-2011-2015
L’AVENIR DU NATIONALISME FRANÇAIS
Il est beaucoup question d’abandonner en tout ou en partie la souveraineté nationale. Ce sont des mots. Laissons-les aux professeurs de Droit. Ces messieurs ont si bien fait respecter leur rubrique, intus et in cute , ces dernières années, qu’on peut compter sur eux pour ajouter du nouveau à tous les plus glorieux gâchis de l’intelligence. Les trésors du réel et ses évidences sont plus forts qu’eux. Ce qu’ils déclarent périmé, ce qu’ils affectent de jeter par-dessus bord ne subira pas plutôt l’effleurement d’une égratignure ou d’une menace un peu concrète, vous verrez l’éclat de la réaction ! […] Preuve que rien ne vit comme le sens de la nation dans le monde présent. Ceux qui voudront en abandonner une part ne feront rien gagner à Cosmopolis : ils engraisseront de notre héritage des nationalités déjà monstrueuses.
Les plus grands faits dont nous soyons contemporains sont des faits nationaux
Les plus grands faits dont nous soyons contemporains sont des faits nationaux : la prodigieuse persévérance de l’Angleterre dans l’être anglais aux années 1940-1945, l’évolution panslaviste ou plutôt panrusse des Soviets, la résistance que la Russie rencontre chez les nations qu’elle a cru s’annexer sous un double vocable de race et de secte, l’éclosion de la vaste conscience américaine, le retour à la vie du nazisme allemand, sont tous des cas de nationalisme suraigu. Tous ne sont pas recommandables. Nous aurions été fous de les imiter ou de les désirer tous. Nous serions plus insensés de ne pas les voir, qui déposent de la tendance universelle. […]
L’humble Bien positif ne sera point l’absolu, mais celui du peuple français, sur ce degré de Politique où se traite ce que Platon appelle l’Art royal.
 Un mouvement de nationalisme français ne sera complet que par le retour du roi. En l’attendant, les partis se seront relâchés de leur primatie et, par l’effet de leurs abus, les mœurs auront repris tendance à devenir françaises, l’instinct et l’intérêt français auront reparu à leur rang.
Un mouvement de nationalisme français ne sera complet que par le retour du roi. En l’attendant, les partis se seront relâchés de leur primatie et, par l’effet de leurs abus, les mœurs auront repris tendance à devenir françaises, l’instinct et l’intérêt français auront reparu à leur rang.
Il ne faut pas se récrier à ce mot d’intérêt. Fût-il disgracieux, c’est le mot juste. Ce mot est plein de force pour nous épargner une grave erreur qui peut tout ruiner.
Si au lieu d’apaiser les oppositions et de les composer sur ce principe d’intérêt, on a honte, on hésite et qu’on se mette à rechercher des critères plus nobles, dans la sphère des principes moraux et sacrés propres aux Morales et aux Religions, il arrivera ceci : comme en matière sociale et politique les antagonismes réels de la conscience moderne sont nombreux et profonds, comme les faux dogmes individualistes sur l’essentiel, famille, mariage, association contredisent à angle droit les bonnes coutumes et les bonnes traditions des peuples prospères qui sont aussi les dogmes moraux du catholicisme, il deviendra particulièrement difficile, il sera impossible de faire de l’unité ou même de l’union dans cet ordre et sur ce plan-là. Ou si on l’entreprend, on essuiera une contradiction dans les termes dont l’expérience peut déjà témoigner (…).
Ces principes de conciliation ne sont pas nombreux. Je n’en connais même qu’un.
Quand, sur le divorce, la famille, l’association, vous aurez épuisé tous les arguments intrinsèques pour ou contre tirés de la raison et de la morale, sans avoir découvert l’ombre d’un accord, il vous restera un seul thème neutre à examiner, celui de savoir ce que vaut tout cela au point de vue pratique de l’intérêt public. Je ne dis pas que cet examen soit facile, limpide ou qu’il ne laisse aucune incertitude. Il pourra apporter un facteur de lumière et de paix. Mais si, venu à ce point-là, vous diffamez la notion d’intérêt public, si vous désavouez, humiliez, rejetez ce vulgaire compromis de salut public, vous perdez la précieuse union positive qui peut en naître et, vous vous en étant ainsi privés, vous vous retrouvez de nouveau en présence de toutes les aigreurs qui naîtront du retour aux violentes disputes que l’intérêt de la paix sociale aurait amorties.
On a beau accuser l’intérêt national et civique de tendre sournoisement à éliminer ce que l’on appelle, non sans hypocrisie, le Spirituel : ce n’est pas vrai. […] La vérité est autre. Nous avons appelé et salué au premier rang des Lois et des Idées protectrices toutes les formes de la Spiritualité, en particulier catholique, en leur ouvrant la Cité, en les priant de la pénétrer, de la purifier, de la pacifier, de l’exalter et de la bénir. En demandant ainsi les prières de chacune, en honorant et saluant leurs bienfaits, nous avons rendu grâces à tous les actes précieux d’émulation sociale et internationale que ces Esprits pouvaient provoquer. Si, en plus, nous ne leur avons pas demandé de nous donner eux-mêmes l’accord désirable et désiré, c’est qu’ils ne le possèdent pas, étant opposés entre eux : le Spirituel, à moins d’être réduit à un minimum verbal, est un article de discussion. Le dieu de Robespierre et de Jean-Jacques n’est pas le Dieu de Clotilde et de saint Rémy. Le moral et le social romains ne sont pas ceux de Londres et de Moscou. Vouloir les fondre, en masquant ce qu’ils ont de contraire, commence par les mutiler et finit par les supprimer. Dès que l’unité de conscience a disparu comme de chez nous, la seule façon de respecter le Spirituel est celle qui en accueille toutes les manifestations nobles, sous leurs noms vrais, leurs formes pures, dans leurs larges divergences, sans altérer le sens des mots, sans adopter de faux accords en paroles. Un Spirituel qui ne serait ni catholique ni protestant ni juif n’aurait ni saveur ni vertu. Mais il doit être l’un ou l’autre. Ainsi seront sauvés la fécondité des féconds et le bienfait des bons ; ainsi le vrai cœur des grandes choses humaines et surhumaines […]. Il existe une Religion et une Morale naturelles. C’est un fait. Mais c’est un autre fait que leurs principes cardinaux, tels qu’ils sont définis par le catholicisme, ne sont pas avoués par d’autres confessions. Je n’y puis rien. Je ne peux pas faire que la morale réformée ne soit pas individualiste ou que les calvinistes aient une idée juste de la congrégation religieuse. On peut bien refuser de voir ce qui est, mais ce qui est, dans l’ordre social, met en présence d’options tranchées que l’on n’évite pas.
De l’abondance, de la variété et de la contrariété des idées morales en présence, on peut tout attendre, excepté la production de leur contraire. Il ne sera donc pas possible à chacun, catholique, juif, huguenot, franc-maçon, d’imposer son mètre distinct pour mesure commune de la Cité. Ce mètre est distinct alors que la mesure doit être la même pour tous. Voilà les citoyens contraints de chercher pour cet office quelque chose d’autre, identique chez tous et capable de faire entre eux de l’union. Quelle chose ? L’on n’en voit toujours qu’une : celle qui les fait vivre en commun avec ses exigences, ses urgences, ses simples convenances.
 En d’autres termes, il faudra, là encore, quitter la dispute du Vrai et du Beau pour la connaissance de l’humble Bien positif. Car ce Bien ne sera point l’absolu, mais celui du peuple français, sur ce degré de Politique où se traite ce que Platon appelle l’Art royal, abstraction faite de toute école, église ou secte, le divorce, par exemple, étant considéré non plus par rapport à tel droit ou telle obligation, à telle permission ou prohibition divine, mais relativement à l’intérêt civil de la famille et au bien de la Cité. Tant mieux pour eux si tels ou tels, comme les catholiques, sont d’avance d’accord avec ce bien-là. Ils seront sages de n’en point parler trop dédaigneusement. Car enfin nous n’offrons pas au travail de la pensée et de l’action une matière trop inférieure ou trop indigne d’eux quand nous rappelons que la paix est une belle chose ; la prospérité sociale d’une nation, l’intérêt matériel et moral de sa conservation touche et adhère aux sphères hautes d’une activité fière et belle. La « tranquillité de l’ordre » est un bel objet. Qui l’étudie et la médite ne quitte pas un plan humain positif et néanmoins supérieur. Sortir de l’Éthique n’est pas déroger si l’on avance dans la Politique vraie. On ne se diminue pas lorsque, jeune conscrit de la vertu patriotique, on élève son cœur à la France éternelle ou, vieux légiste d’un royaume qu’un pape du VIe siècle mettait déjà au-dessus de tous les royaumes, on professe que le roi de France ne meurt pas. Tout cela est une partie de notre trésor, qui joint où elle doit les sommets élevés de l’Être.
En d’autres termes, il faudra, là encore, quitter la dispute du Vrai et du Beau pour la connaissance de l’humble Bien positif. Car ce Bien ne sera point l’absolu, mais celui du peuple français, sur ce degré de Politique où se traite ce que Platon appelle l’Art royal, abstraction faite de toute école, église ou secte, le divorce, par exemple, étant considéré non plus par rapport à tel droit ou telle obligation, à telle permission ou prohibition divine, mais relativement à l’intérêt civil de la famille et au bien de la Cité. Tant mieux pour eux si tels ou tels, comme les catholiques, sont d’avance d’accord avec ce bien-là. Ils seront sages de n’en point parler trop dédaigneusement. Car enfin nous n’offrons pas au travail de la pensée et de l’action une matière trop inférieure ou trop indigne d’eux quand nous rappelons que la paix est une belle chose ; la prospérité sociale d’une nation, l’intérêt matériel et moral de sa conservation touche et adhère aux sphères hautes d’une activité fière et belle. La « tranquillité de l’ordre » est un bel objet. Qui l’étudie et la médite ne quitte pas un plan humain positif et néanmoins supérieur. Sortir de l’Éthique n’est pas déroger si l’on avance dans la Politique vraie. On ne se diminue pas lorsque, jeune conscrit de la vertu patriotique, on élève son cœur à la France éternelle ou, vieux légiste d’un royaume qu’un pape du VIe siècle mettait déjà au-dessus de tous les royaumes, on professe que le roi de France ne meurt pas. Tout cela est une partie de notre trésor, qui joint où elle doit les sommets élevés de l’Être.
L’ORDRE ET LE DÉSORDRE
Nous sommes partis de ce principe que les Français se sont trompés, tous, longtemps, persévéramment ! Nulle famille, nulle région, nul parti ne peut se déclarer exempt de fautes. Tout le monde a participé, plus ou moins, tantôt activement, tantôt par inertie, faiblesse ou ineptie, à une longue suite de crimes contre la patrie. Non personne n’est pur en France. Mais c’est une raison pour faciliter l’examen en commun des fautes communes, des causes de ces fautes et des moyens de les réparer.
Dans la mesure du réel, l’humanité, c’est la nation
 La saine politique se subordonne à l’intérêt de la communauté politique réelle la plus étendue et la plus résistante, hier la chrétienté, aujourd’hui la nation. Nous disons réelle car il s’agit d’intérêts déjà existants ; nous ne parlons pas de l’humanité par exemple, car l’humanité n’a jamais existé en soi et nous ne savons si elle pourra être : elle a failli se réaliser dans l’unité romaine, puis dans l’unité chrétienne, et elle est réduite aujourd’hui au cadre de la nation. Dans la mesure du réel, l’humanité, c’est la nation. Nous disons la plus étendue, parce qu’il s’agit de trouver une loi applicable au plus grand nombre des cas. Mais nous ajoutons cette condition : la plus résistante, pour bien spécifier de quelle sorte de réalités il s’agit ; une coalition, une alliance, souvent même une confédération ne sont pas’ e ces réalités politiques supérieures dont nous parlons. Elles ne conditionnent pas, car elles sont conditionnées. Elles ne sont pas la cause ou le principe, ni la loi des nations qui les forment, car elles sont, bien au contraire, formées de ces nations.
La saine politique se subordonne à l’intérêt de la communauté politique réelle la plus étendue et la plus résistante, hier la chrétienté, aujourd’hui la nation. Nous disons réelle car il s’agit d’intérêts déjà existants ; nous ne parlons pas de l’humanité par exemple, car l’humanité n’a jamais existé en soi et nous ne savons si elle pourra être : elle a failli se réaliser dans l’unité romaine, puis dans l’unité chrétienne, et elle est réduite aujourd’hui au cadre de la nation. Dans la mesure du réel, l’humanité, c’est la nation. Nous disons la plus étendue, parce qu’il s’agit de trouver une loi applicable au plus grand nombre des cas. Mais nous ajoutons cette condition : la plus résistante, pour bien spécifier de quelle sorte de réalités il s’agit ; une coalition, une alliance, souvent même une confédération ne sont pas’ e ces réalités politiques supérieures dont nous parlons. Elles ne conditionnent pas, car elles sont conditionnées. Elles ne sont pas la cause ou le principe, ni la loi des nations qui les forment, car elles sont, bien au contraire, formées de ces nations.
Ce principe, en ses termes abstraits, ne varie pas. Sans être métaphysique, il participe de la constance des lois physiques les plus hautes. Il dure ce que dure la société des humains. La diversité de ses applications dépend de la diversité des cas que le mouvement de l’histoire lui soumettra.
Le principe du patriotisme sans conditions est un de ceux auxquels tout esprit juste doit adhérer. Chacun de nous peut charger la statue du patriotisme de tous les ornements intellectuels qui lui semblent justes et beaux. Mais la patrie d’abord : voilà le principe. La France sans mais, sans si, sans condition.
Est-il permis aux collectivités quelles qu’elles soient d’être généreuses les unes envers les autres ? C’est une grande question. L’égoïsme n’est-il pas leur destinée ?
Cela est vrai de monastère à monastère, de chapelle à chapelle, de sacristie à sacristie : comment serait-ce faux de nation à nation ? Il n’est que les Français, et les stupides Français de la Révolution et de l’Empire, pour régler leur politique étrangère sur des amitiés. Nos rois n’ont fait de sentiment que dans la ure où cela coïncidait avec l’intérêt national de la couronne.
En paix comme en guerre, il est vrai et bon de sentir et de pratiquer le Prius vivere deinde philosophari. Qu’on soit en paix, qu’on soit en guerre, la vie politique d’un peuple n’est pas la spéculation d’un philosophe. La théorie qu’on en doit faire, c’est la théorie des conditions de la vie ou, pour mieux dire, des moyens les plus sûrs de se défendre contre d’innombrables causes de mort. [….]
 C’est une erreur d’avoir inscrit les Droits de l’homme sur le socle d’un monument au génie latin. Ce que le génie latin a enseigné et pratiqué, ce par quoi il s’est élevé entre les races humaines, c’est le devoir, c’est le savoir, c’est le pouvoir, leurs harmonies et leur discipline profondes, c’est la cité et l’esprit humain, c’est le primat de la loi pour la paix. Que le bonheur et la liberté en résultent, c’est une conséquence, ce n’est pas un principe. Mais, si l’on renverse cet ordre, si l’on essaie de transformer un effet en cause, un résultat en but principal, l’inévitable arrive qui est la décadence ou la rétrogradation des peuples qui ont reçu naïvement et pratiqué sincèrement de telles erreurs…
C’est une erreur d’avoir inscrit les Droits de l’homme sur le socle d’un monument au génie latin. Ce que le génie latin a enseigné et pratiqué, ce par quoi il s’est élevé entre les races humaines, c’est le devoir, c’est le savoir, c’est le pouvoir, leurs harmonies et leur discipline profondes, c’est la cité et l’esprit humain, c’est le primat de la loi pour la paix. Que le bonheur et la liberté en résultent, c’est une conséquence, ce n’est pas un principe. Mais, si l’on renverse cet ordre, si l’on essaie de transformer un effet en cause, un résultat en but principal, l’inévitable arrive qui est la décadence ou la rétrogradation des peuples qui ont reçu naïvement et pratiqué sincèrement de telles erreurs…
Notre phase des nationalités ouverte par la Réforme et la Révolution, est une décadence. Il n’y a pas à se faire d’illusions, le genre humain n’est pas en progrès depuis qu’il est resserré dans les cadres strictement nationaux.
Au siècle des nationalités où nous sommes
L’humanité civilisée avait jadis pour limite et pour garantie, la chrétienté catholique : un esprit religieux aussi vaste que le monde. Cette garantie et cette frontière se sont rétrécies à la mesure des nationalités. C’est une perte, mais on aurait une perte plus grande si les nationalités venaient à être détruites. L’humanité y perdrait ses dernières défenses, et voilà tout. Si vous en doutez, vous pouvez vous rappeler ce qu’était devenue l’humanité en Belgique et dans la France envahie, quand elle n’était plus soutenue par des magistrats et des lois autochtones. L’esclavage africain y est rétabli, ni plus ni moins, par la nation victorieuse aux dépens des nations vaincues.
Au siècle des nationalités où nous sommes, notre devoir premier est de renforcer, d’armer et de cuirasser la nôtre : ou nous serons mangés, digérés, consommés.
L’histoire ne se refait pas ? Mais d’abord, elle s’apprend. Ensuite, elle se comprend, et ce n’est pas un mauvais moyen de la comprendre que poser la question : que serait-il arrivé si telle ou telle cause avait joué autrement ? Et d’essayer de la résoudre par approximation. Tout ce que nous voyons du triomphe de la Révolution montre que le succès de la contre-Révolution eût certainement abouti à plus de paix, à moins de massacres, à des rapports internationaux plus étroits et plus cordiaux, à une évolution générale mieux soumise aux idées et plus complètement soustraite aux lois de la force.
« La fraternité des races européennes n’y a rien gagné » …
 Un intéressant petit volume du très républicain Albert Mathiez sur la Révolution et les étrangers, montre ce qu’a été avant la Révolution le degré de fusion des Européens sous le signe de la raison et de la langue françaises.
Un intéressant petit volume du très républicain Albert Mathiez sur la Révolution et les étrangers, montre ce qu’a été avant la Révolution le degré de fusion des Européens sous le signe de la raison et de la langue françaises.
La valeur modératrice de l’influence française a évidemment déchu avec la France même. mais la fraternité des races européennes n’y a rien gagné, les nations ne sont pas devenues plus voisines par le cœur et par la pensée depuis qu’elles sont moins touchées du génie de la France. ■
Première publication : 25.02.2021