
En ce temps post-pascal et de vacance du siège de la papauté, il est l’occasion de revenir sur un texte publié il y a tout pile 120 ans dans le journal Gil Blas, soit le 27 avril 1905 ; texte composé par l’Irlandais Oscar Wilde autre titre le suivant : « Essai de Psychologie du Christ ».
M. Marc Legrand nous communique les bonnes pages de la traduction d’un très curieux extrait de l’ouvrage posthume d’Oscar Wilde, De profundis, que va publier la Revue du Bien.
Notre distingué confrère a voulu expliquer lui-même comment il a pu ouvrir à un écrivain dont le nom rappelle de fâcheux souvenirs les colonnes d’une Revue destinée aux œuvres de la plus haute moralité.
« Le monde, dit-il, ne connaît de la vie de cet homme, mort avant la cinquantaine, qu’un scandaleux épisode, suivi d’un lourd châtiment. On peut aujourd’hui imaginer qu’il était dans les voies de la Destinée qu’un tel malheur échût à cet homme pour qu’il eût à le racheter magnifiquement par des pages où la contrition du cœur n’enlève rien à la vivacité de l’intelligence.
Condamné à une peine infamante, ce prince du bel esprit, ce maître ès-jeux subtils de la pensée, à qui l’on doit le Portrait de Dorian Gray et l’Éventail de lady Windermere, fut touché d’un autre rayon que ceux dont s’auréolait sa gloire passée et flétrie.
Il écrivait alors de son cachot à l’un de ses amis restés fidèles, M. Robert Ross, une sorte « d’Essai psychologique » que ce dernier vient de faire paraître à Londres et où se révèle, en termes d’une puissance et d’une élégance rares, la pleine résonance d’une âme exceptionnelle sous le coup du malheur.
De profundis n’exprime pas la touchante mansuétude la résignation attendrie et sublime des Prisons de Silvio Pellico. C’est un monologue varié, une confession morale et intellectuelle sans restrictions, lucide, et comme emportée par la soif d’humilité d’un pécheur aussi extraordinairement floué pour se retremper dans l’épreuve qu’il l’avait été pour s’exalter dans la perversité des passions.
« Le jour de ma mise en liberté, dit-il dans la préface, je ne ferai que passer d’une prison dans une autre, et par moments l’univers entier ne me semble pas être plus grand que ma cellule, mais il me remplit de terreur au même degré. Et cependant, j’arrive à croire qu’à l’origine des origines, Dieu a dû créer un monde pour chaque homme séparément, et que c’est dans ce monde, situé au dedans de nous-mêmes, qu’il nous faut chercher à vivre… »
Et encore : « La vie de prison vous fait voir les gens tels qu’ils sont réellement et c’est ce qui vous change en pierre. Ceux qui sont au dehors, eux, sont déçus par les illusions d’une vie en perpétuel mouvement. Ils évoluent avec la vie et contribuent à son irréalité. Nous autres, qui restons immobiles, nous voyons et nous savons… »
Le De Profundis s’ouvre sur des considérations louchant diverses circonstances de son existence en prison. Puis d’autres réflexions :
« Les pauvres sont sages, plus charitables, animés de plus de bonté, ils se montrent plus sensibles que nous. À leurs yeux, la prison est un drame dans la vie d’un homme, un malheur, un accident, quelque chose, en un mot, qui appelle la sympathie chez les autres. Ils parlent de celui qui se trouve en prison comme de quelqu’un qui a simplement des ennuis. C’est là l’expression dont ils se servent toujours et elle porte en elle la sagesse parfaite de l’amour.
Plutôt que quitter cette prison avec l’amertume dans mon cœur contre le monde, j’irais délibérément et avec joie mendier mon pain de porte en porte… »
Dans la détresse où il se trouve, ni religion, ni morale, ni raison ne viennent à son aide. Il lui faut sortir tout de lui-même. Tenté un instant par le suicide, il décide qu’il vivra « pour porter sa tristesse comme un monarque sa pourpre. »
Au milieu des confidences écrites dans la solitude de sa prison, se trouvent quelques pages de haute poésie et de pure philosophie, tout à fait remarquables, par la hardiesse et la nouveauté des idées. Elles La lecture de ces pages merveilleuses vaudra quelque indulgence à la mémoire d’Oscar Wilde ont trait à la grande figure du Christ.

Le Christ, en vérité, a sa place marquée parmi les poètes. Son entière conception de l’Humanité naquit soudain de l’imagination qui seule le fait comprendre. Ce que Dieu était aux Panthéistes, l’Homme l’était pour lui. Il fut le premier à concevoir en unité les races divisées. Avant lui, il y avait eu des dieux et des hommes, et, sentant, au travers du mysticisme de la sympathie, qu’en Lui tous deux se trouvaient incarnés, il s’intitule lui-même Fils de Dieu ou Fils de l’Homme, suivant son humeur. Plus que tout autre dans l’histoire, il éveille en nous ce sentiment du merveilleux auquel s’adresse toujours le roman. Malgré tout, il y a toujours à mes yeux quelque chose d’incroyable, quand je songe à ce jeune paysan de Galilée, s’imaginant pouvoir porter sur ses épaules le fardeau du monde entier : tout ce qui avait jusqu’alors été fait, été souffert, et tout ce qu’il y avait encore à faire et à souffrir : les crimes de Néron, de César Borgia, d’Alexandre VI et de celui qui était Empereur de Rome et Prêtre du Soleil ; les souffrances de ceux dont les noms sont légion et dont la demeure est parmi les tombes : peuples opprimés, enfants des usines, voleurs, prisonniers, déclassés, ceux qui restent muets sous l’oppression et dont le silence n’est entendu que de Dieu seul ; et non seulement il se l’imaginait, mais il l’accomplit réellement, puisqu’à l’heure présente, tous ceux qui entrent en contact avec sa personnalité, sans même se prosterner devant son autel ou s’agenouiller devant son prêtre, ceux-là mêmes trouvent de façon quelconque qu’on leur enlève Sa laideur de leurs fautes et qu’on leur révèle la beauté de leurs chagrins.
J’ai dit du Christ qu’il a son rang parmi les poètes. C’est la vérité. Shelley et Sophocle lui sont de compagnie. Mais sa vie tout entière est aussi le plus merveilleux poème. Comme « pitié et terreur », il n’est rien dans tout le cycle de la tragédie grecque qui l’approche. La pureté absolue du protagoniste élève le schéma tout entier vers des sommets d’art romantique, dont sont exclues les souffrances de Thèbes et de la lignée de Pélops, en raison même de leur horreur, et montre combien Aristote était erroné quand il dit, dans son traité du drame, qu’il serait impossible de souffrir le spectacle d’un être sans tache dans le malheur. Pas plus chez Eschyle que chez Dante, ces sévères maîtres de tendresse, chez Shakespeare non plus, le plus purement humain de tous les grands artistes, ni dans l’ensemble des légendes celtiques, où la beauté de l’univers apparaît comme à travers un brouillard de larmes, et où la vie d’un homme n’est guère plus que celle d’une fleur, nulle part on ne rencontre rien qui, par une pure simplicité de pathétique, mariée au sublime de l’effet tragique et ne faisant plus qu’un avec lui, puisse rivaliser ou même s’élever jusqu’au dernier acte de la Passion du Christ. Le léger repas pris avec ses compagnons, dont l’un d’entre eux l’avait déjà vendu pour un prix débattu ; l’angoisse dans la paix du jardin qu’éclairait la lune ; le faux ami s’approchant de lui, pour le trahir d’un baiser ; l’ami qui croyait encore en lui, sur lequel, comme sur une pierre il avait fondé l’espoir de bâtir un lieu de refuge pour l’Homme et qui devait le renier au chant du coq, à l’aube naissante ; le complet isolement dans lequel il se trouvait, sa soumission, son acceptation de tout, et cet ensemble environné de scènes comme celles où le grand prêtre de l’orthodoxie, dans son courroux, déchire ses vêtements, et où le magistrat de la justice civile demande de l’eau dans le vain espoir de se laver de cette tache de sang innocent qui en fait le personnage s’élevant tout rouge, d’un rouge écarlate, dans l’histoire ; la cérémonie du couronnement des douleurs, qui est l’une des choses les plus merveilleuses de tous les temps connus ; le crucifiement de Celui qui était innocent sous les regards de sa mère et du disciple qu’il aimait ; les soldats jetant les dés pour tirer ses vêtements au jeu ; la mort terrible par laquelle il donna au monde son plus éternel symbole ; et l’ensevelissement final dans la tombe du riche, le corps enfermé dans des bandelettes de riche, d’Égypte, enduites d’épices et de parfums coûteux, tel un fils de Roi ; quand on contemple tout cela au seul point de vue de l’art, on ne saurait être que reconnaissant au suprême office de l’Église de représenter le drame, sans l’effusion de sang ; la présentation mystique, par la voie du dialogue, du costume, des gestes même de la Passion de son Seigneur ; et c’est toujours pour moi une source de plaisir et de crainte respectueuse, quand je me souviens que la survivance ultime du chœur Grec, perdu partout ailleurs dans l’art, se retrouve dans le serviteur qui répond au prêtre à la messe.
Et cependant, la vie entière du Christ tant il est que le chagrin et la beauté peuvent ne faire qu’un dans leur signification et leur manifestation — est une idylle en réalité, bien qu’elle se termine par le déchirement du voile du Temple, l’obscurité qui couvre la face du monde, et la pierre qui ferme la porte du sépulcre.

On se le figure toujours comme un jeune fiancé entouré de ses compagnons, ainsi qu’il se décrit lui-même quelque part, comme un berger perdu avec son troupeau : dans quelque vallée, en quête d’une verte prairie ou d’un ruisseau d’eau fraîche, comme un chanteur qui tente d’élever, au moyen de la musique, les murailles de la Cité de Dieu, ou bien encore comme un amant pour l’amour de qui l’Univers entier n’était point assez vaste. Ses miracles m’apparaissent aussi exquis que le printemps naissant et tout aussi naturels. Je n’éprouve aucune difficulté à croire que telle était le charme de sa personne que sa seule présence pouvait porter la paix aux âmes angoissées, et que ceux qui touchaient ses vêtements ou ses mains oubliaient leurs peines, qu’en le voyant passer par les grand’routes de la vie, ceux qui étaient restés aveugles devant le mystère de l’existence, le voyaient alors clairement, tandis que d’autres, demeurés sourds à toute voix autre que celle du plaisir, percevaient pour la première fois la voix de l’amour et la trouvaient aussi « musicale que le luth d’Apollon », ou bien encore que les passions mauvaises s’enfuyaient à son approche, et que les hommes dont la vie monotone privée de tout sens imaginatif n’avait été qu’une variante de la mort, se soient levés de leur tombe à son appel. Je ne voyais, dis-je, aucune difficulté enfin de croire que lorsqu’il prêchait sur la montagne, les foules oubliaient la faim, la soif et les soucis de ce bas-monde, tandis qu’à ses amis, assis à table à l’écouter, les mets grossiers semblaient délicats, l’eau paraissait avoir le bouquet de bons vins, tout comme la maison dans tout son intérieur tendait à s’emplir du doux parfum du nard.
Renan, dans sa Vie de Jésus — ce cinquième Évangile si plein de grâce, cet Évangile selon saint Thomas, comme on pourrait l’appeler — dit quelque part que le grand œuvre du Christ fut de se faire autant aimer après sa mort qu’il fut aimé pendant sa vie. Et, sans contredit, si sa place est marquée parmi les poètes, il est aussi le chef de file de tous les amants. Il vit que l’amour était le premier secret du monde, recherché par les sages, et que, grâce à l’amour seul, on pouvait approcher le cœur du lépreux ou les pieds de la Divinité.
Et par-dessus tout, Christ est la plus suprême des individualités. L’humilité, en tant que la plus artistique acceptation de toutes les épreuves, n’est qu’un mode de manifestation. C’est l’âme de l’homme dont le Christ est toujours en quête. Il l’appelle « le Royaume de Dieu » et la trouve dans chacun de nous. Il la compare à des objets minimes, au grain tout petit, à une poignée de feuilles, à la perle. Et cela parce que nous n’avons conscience de notre âme qu’après nous être défaits de toute passion étrangère, de toute culture acquise, de toute possession extérieure, qu’elles aient été bonnes ou mauvaises.
J’ai fait face à tout avec une obstination de volonté et une grande révolte de nature, jusqu’à ce qu’il ne me restât plus rien au monde, rien qu’une seule chose. J’avais perdu mon nom, ma position, mon bonheur, ma liberté, ma fortune. J’étais un prisonnier, un indigent. Mais il me restait mes enfants. Soudain, de par la loi, on me les retira. Le coup me fut si dur, que je ne sus que faire : je me jetai à genoux, baissai la tête et pleurai, en m’écriant : « Le corps d’un enfant est semblable au corps du Seigneur, je ne suis digne ni de l’un ni de l’autre ! » Cet instant sembla me sauver. J’entrevis alors que la seule chose qui me restait à faire était de tout accepter. Depuis lors — aussi curieux que cela puisse sembler, sans doute — je me suis senti plus heureux. C’était évidemment mon âme dans sa dernière essence que j’avais atteinte. De bien des façons, j’avais été son ennemi, mais je la trouvai, m’attendant comme une amie. Lorsqu’on entre en contact avec l’âme, on devient simple comme l’enfant, ainsi que le Christ disait que nous devons être.
Combien il est dramatique que si peu de personnes « soient en possession de leur âme » avant de passer à trépas !
« Rien n’est plus rare chez l’homme, dit Emerson, qu’un acte de sa propre initiative. »
C’est parfaitement vrai. La plupart des êtres sont d’autres êtres. Leurs pensées sont les opinions de quelque autre, leurs vies une mimique, leurs passions une citation.
Le Christ n’a point seulement été l’individualiste suprême ; mais il a été aussi le premier individualiste de l’histoire.
On a tenté d’en faire un philanthrope ordinaire, en le mettant au rang d’un altruiste parmi les ignorants et les sensitifs. Mais il n’était ni l’un ni l’autre, en toute vérité. Il avait, évidemment, de la pitié pour les malheureux, pour ceux qu’enferment les prisons, pour les humbles, pour les misérables ; mais il éprouvait une pitié bien plus grande encore pour le riche, pour ceux qui dilapident leur liberté et deviennent esclaves des choses, pour ceux qui sont revêtus de beaux atours et vivent dans des. demeures royales. Les richesses et les plaisirs lui semblaient être drames plus terribles que la misère ou le chagrin.
Et, en fait d’altruisme, qui donc mieux que lui savait que c’est la vocation et non la volition qui nous détermine ? Peut-on cueillir les grappes sur les épines ou les figues sur des chardons ?
Vivre pour d’autres comme un but défini de la conscience de soi-même n’était point son Symbole. Ce n’était pas la base de sa croyance.
Quand il dit : « Pardonnez à vos ennemis » ce n’est pas, pour le bien de l’ennemi, mais pour vous-même qu’il le dit, et parce que l’amour est autrement beau que la haine. Quand il conjure le jeune homme de « vendre tout ce qu’il possède et de le donner au pauvre » ce n’est point à l’état d’indigence du pauvre qu’il songe, mais à l’âme du jeune homme, cette âme que corrompt la richesse.
Dans sa conception de l’existence, il ne fait qu’un avec l’artiste qui sait que par l’inévitable loi de perfection, de soi-même, le poète doit chanter, le sculpteur penser en bronze et le peintre faire du monde un miroir reflétant son génie, et tout cela de façon aussi sûre, aussi certaine que l’aubépine devra fleurir au printemps, le blé, tourner à l’or à l’époque des récoltes, et la lune, dans sa course régulière, passer du bouclier à la faucille et de la faucille au bouclier.
Mais bien qu’il n’eût pas dit aux hommes de « Vivre pour les autres » le Christ leur fit sentir qu’il n’y avait point de différence entre la vie des autres et la leur propre. Il donnait ainsi de l’extension à la personnalité de l’homme, il la faisait devenir titanesque. Depuis sa venue, l’histoire de chaque individu séparé est ou peut devenir l’histoire du monde. La culture a, évidemment, intensifié la personnalité de l’homme. L’art nous a donné des myriades de penseurs. Ceux qui ont un tempérament d’artiste suivent Dante en exil et apprennent combien le pain des autres est salé, combien raides les échelons qu’ils ont à gravir ; ils atteignent par moment la sérénité et le calme de Gœthe, et savent trop bien le cri de Baudelaire à Dieu :
Ô Seigneur, donnez-moi la force et le courage !
De contempler mon corps et mon cœur sans dégoût.
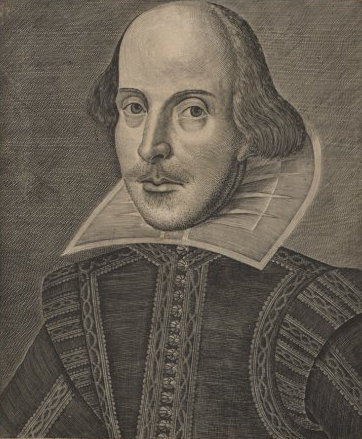
Ils extraient des sonnets de Shakespeare, au risque d’en être blessés eux-mêmes, le secret de son amour et en font le leur ; ils voient d’un autre œil la vie moderne, car ils ont prêté l’oreille à l’un des Nocturnes de Chopin, tenu dans leurs mains quelque objet grec ou lu le récit de la passion de quelque homme disparu pour quelque dame qui n’est plus, aux cheveux pareils à des fils d’or, aux lèvres semblables à la grenade. Mais la sympathie du tempérament artistique se porte nécessairement vers ce qui a trouvé l’expression. En mots ou en couleurs, en musique ou en marbre, derrière les masques peints d’une pièce d’Eschyle, ou bien au travers des roseaux percés et joints de quelque pâtre de Sicile, l’homme et son message doivent s’être révélés.
Pour l’artiste, l’expression est la seule façon dont il puisse concevoir la vie. Pour lui, ce qui est muet est mort. Mais il n’en était point ainsi pour le Christ. Avec une largeur d’imagination prodigieuse, il fit du monde entier de la douleur sans voix et qui ne sait rien articuler, son royaume, et lui servit de bouche. De ceux dont j’ai parlé, muets sous l’oppression et que Dieu seul entend dans leur silence, il fit ses frères. Il choisit de devenir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds et le son sur les lèvres de ceux dont les langues étaient liées. Il souhaitait d’être pour les multitudes qui ne savaient point émettre de sons, la trompette au moyen de laquelle ils feraient leur appel aux cieux.
Et sentant, avec la nature artistique d’un être pour qui la souffrance et le chagrin étaient façons de réaliser ses conceptions n du beau, sentant qu’une idée reste sans valeur jusqu’à ce qu’elle s’incarne et soit transformée en image, il fit de lui-même l’image de l’Homme des chagrins et, comme tel, il a fasciné et dominé l’art ainsi qu’aucun dieu des Grecs n’est jamais parvenu à le faire.
Car les dieux des Grecs, en dépit du blanc et du rouge de leurs membres beaux et agiles, n’étaient point en réalité ce qu’ils paraissaient. Le sourcil arqué d’Apollon était semblable au disque du soleil à l’aube au-dessus des collines, et ses pieds étaient pareils aux ailes du matin, mais il s’était montré cruel envers Marsyas et avait rendu Niobé stérile. Dans le bouclier d’acier des yeux d’Athénè point n’était de pitié pour Arachné ; la pompe et les paons d’Hera étaient toute la noblesse qui résidait en elle ; et le Père des dieux lui-même s’était montré trop épris des filles des hommes. Les deux figures le plus profondément suggestives dans toute la mythologie grecque étaient, en fait de religion, Mémêter, une déesse terrestre et non pas olympienne, et en fait l’art, Dionysos, fils d’une mortelle pour qui le moment de la naissance de son enfant devint aussi l’instant de sa mort.
Mais la vie elle-même dans sa sphère la plus humble et la plus basse produisit un être beaucoup plus merveilleux que la mère de Proserpine ou le fils de Sémélé. De la boutique du charpentier, à Nazareth, était sortie une personnalité infiniment plus grande qu’aucune de celles que créèrent le mythe et la légende, et un être, qui, curieusement., se trouvait destiné à révéler au monde la signification mystique du vin et les beautés réelles des lis des champs, comme nul ne l’avait jamais fait sur le Cithéron ou à Enna.
Le chant d’Isaïe : « Il est méprisé et rejeté par tous, c’est un homme de chagrins et qui connaît la douleur : et nous cachâmes nos faces devant lui », avait semblé le préfigurer lui-même, et en lui la prophétie se trouva accomplie. Il ne faudrait point nous effrayer de cette phrase. Toute œuvre d’art séparée est l’accomplissement d’une prophétie : car toute œuvre d’art est la conversion d’une idée en une image. Tout être humain pris séparément devrait être l’accomplissement d’une prophétie ; car tout être humain devrait être la réalisation d’un idéal quelconque, soit dans la pensée de Dieu soit dans l’esprit de l’homme. Le Christ trouva ce type et le fixa, et le rêve d’un poète virgilien, à Jérusalemen ou à Babylone, devait dans la longue suite des siècles s’incarner dans celui que l’Univers « attendait ».
OSCAR WILDE. Traduit de l’anglais, par H.-R. WŒSTYN.











