(Voici l’analyse économique de François Reloujac parue dans le numéro d’été de Politique magazine (juillet/août 2011, n° 98)
Depuis que la crise économique a explosé dans l’actualité médiatique, on met souvent en cause le rôle joué par « les banques ». Peu d’informations qui ne fassent allusion à la responsabilité des banques. Mais, au-delà des dénonciations qui font mouche, peu d’explications réelles sur ce qui leur est reproché, aucune nuance dans les responsabilités des unes et des autres.
Les banques sont coupables, c’est entendu ! Oui ; mais quelles banques ? Car il existe de nombreuses différences entre les banques d’investissement et les banques de détail, les banques d’entreprises et les banques de particuliers, les banques régionales et les banques internationales, les banques commerciales classiques et les banques coopératives, etc. Sans entrer ici dans un détail qui risquerait d’entraîner très loin, il est important, pour bien comprendre ce qui se passe, de soulever un coin du voile sous lequel on dissimule habituellement les turpitudes économiques et financières.

Le Hong-Kong Stock Exchange… : désormais, des logiciels informatiques permettent de passer des ordres fianciers en seulement quelques nanosecondes. Permettant une frénésie encore plus importante pour la spéculation sur ese titres. Et de gagner de l’argent encore plus vite…
Le métier traditionnel des banques est d’accorder des crédits. On leur demande ainsi d’octroyer aux particuliers des crédits à la consommation pour permettre à chacun – dont le pouvoir d’achat résultant du travail est en panne – d’acheter des produits venus du monde entier pour le plus grand profit des entreprises multinationales et de soutenir ainsi la consommation… mais si l’un des consommateurs ne peut plus rembourser, c’est que la banque a favorisé le surendettement ! On leur demande de soutenir les petites, les moyennes et les grandes entreprises qui assurent le fonctionnement du système industriel et commercial et, si elles doutent de la réussite du projet économique qu’on leur demande de financer et de la solvabilité des entreprises, on les dénonce au médiateur du crédit. On leur demande de combler sans faille tous les besoins des gouvernements qui dépensent à tout va, mais on leur reproche ensuite d’être les principales responsables des dettes publiques.
En fait, la société actuelle ne repose que sur le crédit ; il en résulte inéluctablement que le volume des dettes publiques et privées explose. Sous prétexte d’assurer la sécurité économique du système on impose aux banques d’être « transparentes » et de respecter un rapport très strict entre le volume des crédits accordés et celui des fonds propres. Mais comme le volume des crédits est en croissance exponentielle, on a commencé par imaginer des « quasi-fonds propres », qui ne sont qu’une catégorie d’emprunts que l’on baptise fonds propres uniquement pour permettre aux banques de prêter plus. Comme ce mécanisme a des limites et qu’il faut pourtant faire baisser le niveau du ratio obligatoire, on a imaginé de permettre aux banques de sortir les crédits accordés de leur bilan par la technique de la titrisation.
On impose ainsi aux banques de respecter des ratios de plus en plus contraignants et, dans le même temps, on les autorise à manipuler aussi bien le numérateur que le dénominateur de ces rapports arithmétiques !
Des paradis administratifs
Cette technique permet aux banques de « céder » à d’autres les créances que représente le montant des crédits qu’elles ont accordés. De prêteurs, elles sont ainsi devenues de simples « arrangeurs ». Cela signifie que les crédits en question sont désormais inscrits dans le bilan d’entreprises non bancaires (fonds spéculatifs, OPCVM, organismes de retraite) ou dans des contrats d’assurance-vie « vendus » aux épargnants. Nombre de ces opérations ayant lieu sur des marchés non organisés, non régulés, et souvent dans des « paradis administratifs », comme disait l’ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, plus personne ne sait désormais quel est le créancier en dernier ressort. Quand un débiteur fait faillite, personne ne sait qui va se trouver en bout de chaîne, avec le Mistigri.
Pour que les marchés financiers fonctionnent à peu près convenablement, on a imaginé des contrats d’assurance, les CDS, qui sont censés couvrir les créanciers en dernier ressort contre la défaillance de tel ou tel débiteur clairement identifié. Mais, comme il n’est pas toujours facile de savoir qui est créancier de qui, les CDS peuvent être vendus à des agents économiques qui ne détiennent en fait aucune créance sur l’agent économique en qui ils n’ont pas confiance. Dès lors, ces acquéreurs de CDS ont intérêt à voir les débiteurs des actifs assurés faire défaut : ils ne supportent aucune perte, puisqu’ils n’ont aucune créance sur le débiteur défaillant, mais ils gagnent beaucoup d’argent puisque le montant de l’assurance leur est versé, non en fonction de la créance compromise qu’ils détiennent, mais du montant qu’ils ont souscrit. Aujourd’hui près de 80 % des CDS ont été vendus par des banques américaines qui ne veulent surtout pas qu’un débiteur dont les créances ont été ainsi garanties – la Grèce – soit déclaré en faillite… Elles seraient obligées d’honorer leurs engagements !
Pour que le système fonctionne, il faut que les marchés financiers soient « profonds et liquides », c’est-à-dire que les transactions quotidiennes y soient les plus nombreuses possibles. Du coup les « investisseurs » qui y sont actifs surveillent en permanence l’évolution des cours pour se dégager au moindre risque ou augmenter le volume de leurs investissements dès qu’ils pensent que les cours sont susceptibles de monter. Pour ne pas risquer de passer à côté d’une bonne affaire ou, pire, de se laisser piéger avec des titres en baisse, les gros « investisseurs » ont développé des systèmes informatiques qui surveillent en permanence l’évolution des cours et déclenchent des ordres d’achat ou de vente en quelques nanosecondes. Des systèmes aussi puissants ne sont pas à la portée du premier venu et l’on estime aujourd’hui en France que 80 % des ordres de Bourse émanent de seulement trois agents économiques. Nombre de titres changent ainsi de main plusieurs fois par jour. Les prétendus « investisseurs » ne sont plus, en fait, que de simples spéculateurs qui n’ont aucun intérêt dans les entreprises qu’ils financent mais cherchent uniquement à gagner de l’argent sur les variations de cours, même si cet argent n’est que virtuel et ne correspond à aucune richesse vive réelle. Le seul but est de gagner le plus possible dans le temps le plus bref. Les entreprises financées ne sont plus que les supports des jeux financiers et leurs titres la matérialisation des tickets de loterie.
« …Se contenter de crier haro sur le baudet et de désigner les banques comme les responsables de la situation économique actuelle, c’est les transformer en boucs émissaires de la société et les charger de tous les maux découlant de quarante ans d’égoïsme collectif… »
Des vues court-termistes
Les entreprises sont peu à peu devenues des personnes morales sans maître – ayant une vision à long terme et assumant une certaine responsabilité, y compris morale –, livrées à de simples gestionnaires dont l’horizon se réduit à présenter le meilleur résultat financier possible à la plus prochaine assemblée générale. Votent désormais à ces assemblées les gestionnaires des fonds qui n’ont pas à se préoccuper des résultats espérés à long terme par les entreprises mais uniquement des dividendes qu’elles serviront et qu’ils pourront redistribuer à leurs mandants. Les entreprises cotées ne sont ainsi plus portées par un projet économique à long terme mais par un simple objectif de versement de dividendes à court terme. Les banques cotées sont des sociétés anonymes gérées selon les mêmes principes et répondant aux mêmes lois. Les « managers » n’engagent pas leur argent personnel pour soutenir leurs clients ; ils jouent l’argent des fonds de pension et autres organismes de placement collectif pour distribuer des « produits » dont ils n’assument pas la responsabilité. Et ils le font contre une rémunération qui n’a aucun lien ni avec l’utilité économique dudit « produit » ni avec le risque encouru par la banque.
En cette année 2011, l’essentiel des opérations financières se déroule en dehors des banques car si les banques sont soumises à des réglementations draconiennes et sont contrôlées par des autorités de tutelle multiples et tatillonnes, il n’en est pas de même de ce que les anglo-saxons appellent poétiquement le « shadow banking ». Au-delà des abus individuels réels, ce qui est en cause c’est d’abord le système lui-même ; ce sont les lois auxquelles les banques sont soumises et qui exemptent soigneusement les acteurs du « shadow banking », pour permettre au système de survivre encore dans une fuite en avant de plus en plus rapide, qui n’est plus qu’une vaste opération de cavalerie.
Se contenter de crier haro sur le baudet et de désigner les banques comme les responsables de la situation économique actuelle, c’est les transformer en boucs émissaires de la société et les charger de tous les maux découlant de quarante ans d’égoïsme collectif. Les banques ne sont pas pour autant innocentes de ce qui se passe, mais elles n’ont joué, au mieux, que le rôle de cause instrumentale. Il ne faut pas en rester à cette vue superficielle des choses mais, derrière ces causes instrumentales, aller chercher la cause première qui est essentiellement politique. ■
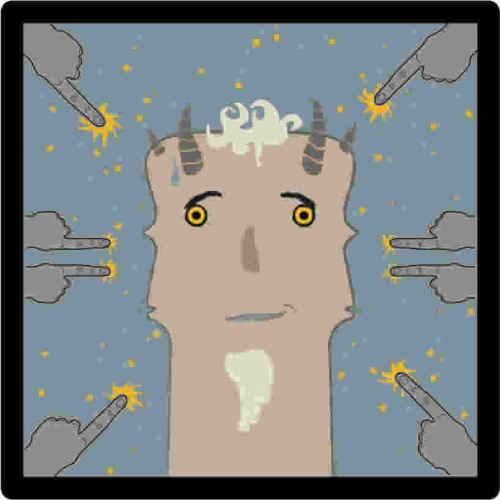












David Gattegno sur Le 14 juin 2025, rencontres royalistes…
“En effet, comme dit NOEL, «le Roi ne devra pas être “un chef”» – dans le…”