
Par Pierre Builly.
Alamo de John Wayne (1960).
Le pays de l’Étoile solitaire.
Les États-Unis (dits d’Amérique) ont toujours eu le chic (l’habileté, la roublardise) d’imposer au monde entier leur légende historique et d’en emplir les cerveaux naïfs jusqu’à imposer une vision univoque qui devient alors une vérité de foi révérée. Ainsi la baliverne qu’ils ont été les vainqueurs exclusifs du National-socialisme alors que c’est l’Union soviétique qui a porté les coups les plus durs à l’Allemagne hitlérienne. Ainsi les billevesées sur la défense du Monde libre en Corée, en Indochine ou à Cuba alors qu’ils ont à peu près à eux seuls salopé tout l’équilibre mondial et méprisé l’identité des nations. Ce qui leur retombe régulièrement sur le nez, comme on le voit aujourd’hui en Afghanistan, jadis au Vietnam.
 Quel rapport ce premier paragraphe a-t-il avec la geste d’Alamo, pourra-t-on me dire ? Un film qui a exalté mon adolescence et donné une si belle image du patriotisme sans calcul, des vertus guerrières, de l’amitié virile, du courage et du sacrifice ?
Quel rapport ce premier paragraphe a-t-il avec la geste d’Alamo, pourra-t-on me dire ? Un film qui a exalté mon adolescence et donné une si belle image du patriotisme sans calcul, des vertus guerrières, de l’amitié virile, du courage et du sacrifice ?
Eh bien tout simplement le rapport c’est que dans la véritable histoire, ce ne sont pas les Mexicains qui étaient les vilains, mais plutôt (au moins tout autant, si on est indulgent) les colons. Venus de tous les États de l’Union, s’installant sur ces immenses terres vides (les autochtones en ayant été soigneusement éliminés), ils s’imposaient peu à peu sur le territoire et refusaient d’accepter les lois mexicaines qui leur déplaisaient ; par exemple l’abolition de l’esclavage, décidée au Mexique en 1829.
 Donc, à l’époque, rien n’est si noir, ni si blanc. Et la révolte des colons anglo-saxons ne s’explique que parce que le général Santa-Anna a décidé, en 1835, de revenir sur la Constitution de 1824 qui accordait une large autonomie aux États fédérés et de centraliser le pays. Voilà qui gêne les profits et les trafics d’un type comme David Bowie (dans le film Richard Widmark), riche propriétaire esclavagiste.
Donc, à l’époque, rien n’est si noir, ni si blanc. Et la révolte des colons anglo-saxons ne s’explique que parce que le général Santa-Anna a décidé, en 1835, de revenir sur la Constitution de 1824 qui accordait une large autonomie aux États fédérés et de centraliser le pays. Voilà qui gêne les profits et les trafics d’un type comme David Bowie (dans le film Richard Widmark), riche propriétaire esclavagiste.
Cela étant posé et les prémisses admises que nous avons affaire à des héros immaculés opposés à des brutes obtuses, le film de John Wayne, qui y tient d’ailleurs la part du lion, est une très agréable et forte saga qui n’a le défaut que d’être un peu longue. Plus de 3 heures et seulement la dernière demi-heure consacrée au combat et à la prise du fortin, admirablement filmée au demeurant. Mais après avoir écrit cela, je me dis que tout ce qui précède ne manque pas du tout d’intérêt ni de pertinence ; seulement aurait-on pu grappiller quelques secondes sur de nombreuses séquences et raboter ici et là des minutes qui, à la fin, s’accumulent. Peut-être le montage aurait-il pu être plus vigoureux, plus agressif, plus vif. Le film n’y aurait rien perdu.
 Mais tel qu’il est, il a l’immense qualité de présenter, en prenant son temps, les principaux acteurs, et les édifier en figures archétypiques et légendaires : le rigide héroïque colonel Travis (Laurence Harvey), l’aventurier bagarreur, agressif, opulent James Bowie (Richard Widmark, donc) et le héros magnifique, clairvoyant, bienveillant Davy Crockett (John Wayne. himself, évidemment). Trois hommes de qualité qui ne s’entendent pas forcément mais qui vont être conduits par la constance des évidences à se battre les uns à côté des autres et à mourir ensemble.
Mais tel qu’il est, il a l’immense qualité de présenter, en prenant son temps, les principaux acteurs, et les édifier en figures archétypiques et légendaires : le rigide héroïque colonel Travis (Laurence Harvey), l’aventurier bagarreur, agressif, opulent James Bowie (Richard Widmark, donc) et le héros magnifique, clairvoyant, bienveillant Davy Crockett (John Wayne. himself, évidemment). Trois hommes de qualité qui ne s’entendent pas forcément mais qui vont être conduits par la constance des évidences à se battre les uns à côté des autres et à mourir ensemble.
 Alamo n’a pas manqué de moyens : grande quantité de figurants, beau spectacle des combats, ciels magnifiques filmés avec amour, musique très réussie de Dimitri Tiomkin, juste ce qu’il faut de séquences émouvantes et de propos héroïques, sauvageries spectaculaires et acteurs éclatés par les obus, fusillés, cloués par des baïonnettes contre les murs. Tout cela est très bien, très conforme à l’esprit des temps où l’on était fier de se sacrifier pour une cause.
Alamo n’a pas manqué de moyens : grande quantité de figurants, beau spectacle des combats, ciels magnifiques filmés avec amour, musique très réussie de Dimitri Tiomkin, juste ce qu’il faut de séquences émouvantes et de propos héroïques, sauvageries spectaculaires et acteurs éclatés par les obus, fusillés, cloués par des baïonnettes contre les murs. Tout cela est très bien, très conforme à l’esprit des temps où l’on était fier de se sacrifier pour une cause.
 Voilà un vrai film d’hommes : les quelques femmes qui y paraissent, si séduisantes qu’elles sont, n’y figurent qu’en faire-valoir des vertus viriles. Pour soutenir, par exemple le courage de ceux qui n’en n’ont pas assez et qui ne pensent pas qu’avant tout, ce qui compte, c’est le Devoir.
Voilà un vrai film d’hommes : les quelques femmes qui y paraissent, si séduisantes qu’elles sont, n’y figurent qu’en faire-valoir des vertus viriles. Pour soutenir, par exemple le courage de ceux qui n’en n’ont pas assez et qui ne pensent pas qu’avant tout, ce qui compte, c’est le Devoir.
Autrement dit, c’est un film antédiluvien, sûrement incompréhensible pour presque tous nos jeunes contemporains. Raison de plus pour l’apprécier, n’est-ce pas ? ■
DVD autour de 15 €…
Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

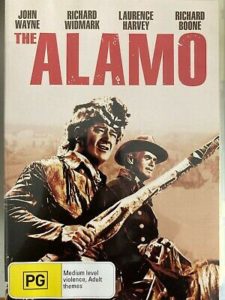












Jim BOWIE et sa légendaire « maitresse de fer » son coutelas à l’écran Richard WIDMARK et aussi son admirable vieil esclave
Pour moi ce film reste LE film par excellence, scènes de combat, humour, émotion le départ des 3 survivants: la veuve du capitaine DICKINSON sa fille, le petit esclave
DOMMAGE que la France n’ait pas su réaliser un film sur une base presque identique à Alamo,
CAMEERONE le 30 avril 1863, le capitaine DANJOU vaut bien Davy CROCKETT
Certes, Setadire, on aimerait bien un film sur les héros de Camerone ; mais c’est un peu complexe puisque nos chers légionnaires combattaient dans un pays où nous n’avions rien à faire, à la suite d’idiotes orientations de Napoléon III.
L’héroïsme de Danjou et de ses hommes est admirable, mais il est politiquement sans intérêt ; comme les morts scandaleuses de nos soldats en Afghanistan, voire au Mali.
La France en 1938 faisait des films patriotiques. Je me souviens d’avoir vu en 1940 « Trois de Saint-Cyr » avec Jean Chevrier (Acteur), Jean Mercanton (Acteur), Jean-Paul Paulin (Réalisateur) ou encore « Michel Strogoff » de Jacques de Baroncelli, Richard Eichberg
Avec Charles Vanel, Adolf Wohlbruck, Fernand Charpin; A l’époque, aller au cinéma était exceptionnel et souvent c’était au cinéma paroissial ( exemple: « le Poumon d’Acier arrive à Lourdes » premier film que j’ai vu en 39 ).
« Trois de Saint-Cyr » n’était effectivement pas un mauvais film (mais valait surtout pour sa première partie) ; JSF pourrait publier vite ce que j’en ai écrit…
Il ne faut tout de même pas non plus oublier les films guerriers de Pierre Schoendoerffer (qui sont tous sur JSF)
JSF publiera donc très volontiers, dès demain matin (mardi 5 octobre) ce que Pierre Builly a écrit sur « Trois de Saint-Cyr ».
Au hasard de mon exploration de ce site, je tombe sur cette critique d’un film cher à mon cœur. Je me permets d’observer qu’il est moins manichéen qu’il n’y paraît. Il est ainsi parsemé de passages où les Mexicains, même ennemis, sont traités avec respect. Je pense, en vrac, à cette scène où Bowie fait l’éloge de ce peuple (« Ils n’ont pas peur de mourir et, ce qui est encore mieux, ils n’ont pas peur de vivre »), à cette jeune femme mexicaine sans doute amoureuse de Crockett, à l’attitude des Texans devant les morts et les blessés mexicains, à la noblesse de Santa Anna à l’issue de la bataille, etc.
Bon, cela n’empêche pas que les Texans sont du bon côté et Santa Anna du mauvais. Mais pour 1960, ce n’est tout de même pas si mal.